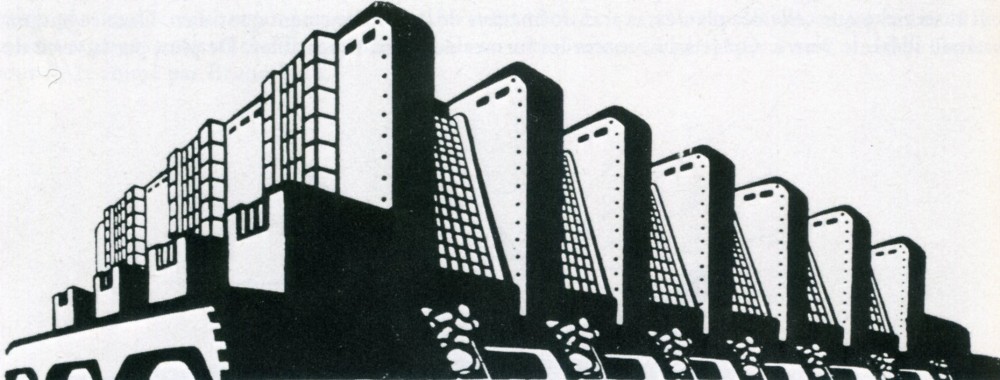Quelques compagnons anarchistes m’ont dit qu’ils trouvaient bon Le Cauchemar de Don Quichotte. À mon goût il n’est bon qu’à mettre aux cabinets. Ainsi va la vie ! Si nous n’avons rien de mieux à faire, nous discuterons peut-être un soir autour d’un bock de ce que j’aime et n’aime pas dans ce livre. Rien ne presse. Chacun ses goûts. On me dit aussi qu’Amiech et Mattern sont des compagnons de lutte, et sympathiques, intelligents (il se trouve que je ne les connais pas : notre petit milieu anticapitaliste et révolutionnaire, à Paris, n’est pas si petit). Admettons ! La lutte n’attend pas que nous écrivions tous de bons livres : c’est si difficile ! Quelque chose cependant m’inquiète : croiriez-vous que c’est un bon livre de lutte ? Je préfèrerais alors en parler tout de suite et sans bock. Je préfère publier ce texte.
Le coût des vies
Je voudrais essayer d’expliquer ce que j’appelle un bon livre de lutte, en prenant deux exemples. D’abord un livre antitechnologique : Le Coût de la vie, d’Arundhati Roy (1). Ce court texte fut publié en 1999 dans deux revues, peu après que Roy fut devenue romancière célèbre. Il s’inscrit expressément dans la lutte menée en Inde depuis le milieu des années 1980 contre une technologie, celle des grands barrages, en tant qu’intervention de cette lutte dans le champ médiatique, rendue possible par la célébrité de son auteure. En Inde, troisième constructeur mondial de grands barrages, quelque chose a changé dans l’opinion à leur sujet grâce à la lutte, commencée en 1986, de petits paysans de la vallée de la Narmada contre la construction du gigantesque barrage de Sardar Sarovar. En janvier 1991, notamment, date d’une longue, tenace et rude action, les médias ont fini par faire du sujet un sujet important, et depuis la politique des grands barrages est devenue objet de débats récurrents, un peu comme, en France, Saint-Bernard est venu perturber le consensus sur la politique de fermeture des frontières (2).
Roy commence par expliquer que la sortie médiatique de l’ombre fut certes en elle-même, et plus encore par ses répercussions, une importante victoire, mais que la façon dont la lutte apparut immédiatement et continue d’apparaître au public fut par contre une défaite.
Elle apparaît comme le dernier avatar d’une opposition structurelle depuis l’indépendance entre deux entités abstraites antagoniques : progrès industriel de la nation d’un côté (incarné symboliquement par Nehru), archaïsme artisanal des régions de l’autre (incarné symboliquement par Gandhi). Or, explique Roy, « pour les gens de la vallée, que les enjeux aient monté à ce point a eu pour effet, en raison de l’élargissement du débat autour des seuls ‘‘grands’’ problèmes, d’émousser leur arme la plus efficace : des faits précis concernant spécifiquement les problèmes de cette vallée en particulier, à l’exclusion de toute autre » (p.20). C’est précisément de cette arme, mais pas émoussée, que Roy entend faire usage dans et par son texte, à un moment crucial de la lutte (la Cour suprême vient d’autoriser la reprise des travaux). S’adressant à un public de classes moyennes urbaines et cultivées dont l’opinion s’est formée à partir des informations partiellement diffusées par les médias et de leurs commentaires, elle lui dit d’abord qu’il s’interdira de comprendre les enjeux de cette lutte tant que, comme l’y invitent les médias, il n’y voit qu’une « …guerre entre les forces progressistes modernes, rationnelles, du développement et une sorte de mouvement néo-luddite, caractérisé par une résistance irrationnelle à ce même développement … » (p.21). Lorsqu’on tombe sur cette phrase peu de temps après avoir lu Le Cauchemar de Don Quichotte, on est immanquablement frappé par une curieuse impression de déjà-vu. Le fait est qu’elle pourrait se trouver telle quelle dans Le Cauchemar, à l’exception toutefois des qualificatifs « rationnelles » et « irrationnelles ». En effet, ce sont exactement les termes – « forces progressistes modernes » contre « mouvement néo-luddite », « développement » contre « résistance à ce développement » – de l’antagonisme social et politique principal selon Amiech et Mattern. C’est à cette guerre qu’il est urgent d’après eux que nous participions activement,– dans le bon camp, bien entendu. Le Cauchemar de Don Quichotte est très parcimonieux en faits précis concernant des problèmes particuliers, et singulièrement en faits précis se rapportant aux problèmes particuliers posés par la lutte qui lui donna son impulsion : la lutte de 2003 contre la loi Fillon. Il est vrai qu’Amiech et Mattern n’ont aucune raison d’utiliser l’arme que Roy tient pour la plus efficace dans la lutte, puisqu’ils ne s’inscrivent plus dans cette lutte : ils adoptent au contraire une posture de juges, extérieurs et supérieurs à elle et à ses acteurs et actrices, en posant non pas la question de comment la poursuivre minoritairement alors qu’elle est en reflux, mais celle des raisons de son échec présumé définitif. Pour eux, d’ailleurs, les problèmes ne sont pas posés par la lutte, mais à l’occasion de la lutte ; on ne saurait s’étonner alors que celle-ci soit présentée comme la rencontre par une subjectivité encline aux vastes questions existentielles d’un événement qui la porte à réactiver l’interrogation socratique sur la valeur des différents genres de vie : « Pour tous ceux qui (…) n’entendent pas se résoudre à une soumission complète, ce conflit était à nouveau l’occasion de poser un certain nombre de problèmes fondamentaux, au premier rang desquels celui de savoir quelle sorte de vie nous voulons mener » (p.14). Roy, elle, suppose seulement que nous admettrons que personne ne souhaite être brutalement contraint à un genre de vie totalement nouveau que non seulement il ou elle n’a pas choisi, mais que personne ne choisirait : en l’occurrence une vie d’extrême misère dans les bidonvilles périurbains. Elle décrit donc minutieusement et sans pathos superflu la situation dans laquelle se trouvent les familles déjà expulsées du terrain qu’elles occupaient, mettant en œuvre ses talents d’écrivain pour faire franchir à ses lecteurs la distance qui les sépare des habitants de la vallée inondable, lesquels, en plus d’être paysans ou pêcheurs dans une région lointaine, ont le double défaut supplémentaire d’appartenir pour beaucoup à la plus basse caste et pour la plupart à une ethnie au moins aussi méprisée en Inde que les Tziganes chez nous. Mais il ne faut pas seulement faire percevoir que ces dalits (la caste en question, dite chez nous des « intouchables ») et ces adivasis (l’ethnie en question) sont des êtres humains, sensibles et rationnels. Leur mouvement, du moins lorsqu’il est emporté par les plus militants et les plus radicaux, tels ceux et celles qui ont fait l’action de janvier 1991, n’est pas pour une expulsion et un relogement décents ; il est pour l’arrêt immédiat de la construction du barrage et la destruction de ce qui est déjà construit.
Or, tout le monde sait que les dommages collatéraux sur les oeufs sont nécessaires à l’omelette, et qu’il y a des omelettes nécessaires au bien commun. Tout le monde voit – et si ces Adivasis étaient pleinement rationnels ils devraient le voir eux aussi – que lorsque les œufs, par malheur, sont des êtres humains, il n’y a hélas rien de mieux à faire que de limiter autant que possible les dommages qu’on leur inflige, bien entendu tout à fait à contre-coeur. Roy attaque cet argument sous différents angles, et le réfute toujours grâce à son arme : les faits précis, l’examen attentif et informé des questions que la lutte contraint à poser. Que coûte, financièrement, le barrage à l’État ? Combien de personnes sont-elles touchées par sa construction ? Combien en pâtiront-elles, combien en bénéficieront-elles ? En quoi consistent exactement ses avantages, s’il y en a ? S’ils sont à long terme, quel est le terme ?
Y a-t-il des investissements qui, à coût financier égal, apporteraient moins de dégâts à moins de gens ou plus d’avantages à plus de gens ? L’essentiel du livre est consacré à donner à ces questions les réponses qui montrent que le projet n’est pas raisonnable. Roy admet donc, lorsqu’elle s’en tient à cette ligne argumentative, qu’il pourrait être raisonnable si les réponses étaient différentes : si vraiment les besoins vitaux d’un très grand nombre de gens ne pouvaient être satisfaits qu’aux dépens d’un nombre significativement plus petit, alors oui le barrage serait un progrès et pourrait être justifié en tant que tel, aussi pharaonnique fût-il, aussi grands fussent les malheurs de ceux qu’il chasse de leurs terres.
Qu’on ne croie pas que je veuille reprocher à Amiech et Mattern de ne pas avoir admis un tel présupposé.
Moi non plus je ne voudrais pas écrire un livre qui l’admette sans recul, serait-ce même pour contrer l’adversaire. Roy ne l’admet d’ailleurs pas toujours. Elle dit à un moment : « Dans de telles circonstances, ne serait-ce qu’envisager un débat sur le relogement et la réadaptation, c’est bafouer les principes élémentaires de la justice. Transplanter 200 000 personnes de manière à donner (ou à prétendre donner) de l’eau potable à 40 millions : il y a quelque chose qui ne va pas dans l’énormité même de ces chiffres. C’est une arithmétique fasciste. Qui étouffe toutes les histoires. Ecrase le détail. Et réussit à aveugler les gens les plus raisonnables grâce à son éclat visionnaire mais totalement fallacieux » (p. 82). Le « dans de telles circonstances » et le « mais totalement fallacieux » ressortissent à la ligne principale d’argumentation ; mais la formule « arithmétique fasciste » détruit le fondement même de cette argumentation. Ici, Roy rejette d’emblée toute politique de gestion des populations : c’est l’attitude dont pour ma part je ne souhaite pas me départir. Cela dit, j’apprécie que d’autres, impliquées dans la lutte contre une politique, soient à l’occasion moins scrupuleuses que moi quant aux compromissions avec la politique en elle-même. Par exemple, L’Injustifiable, de Monique Chemillier-Gendreau, qui – selon une conception utilitariste de la rationalité tout à fait semblable à celle que Roy suppose dans son argumentation principale – montre l’irrationalité de la politique dite de fermeture des frontières, est selon moi un bon livre pour la lutte, même si son auteure est une militante que j’ai combattue lors de la lutte de Saint-Bernard, où elle prit une position débectable (elle appartenait au « collège des médiateurs ») en conformité à l’idée débectable que supposent le titre et tout le raisonnement de son livre, à savoir qu’une autre politique migratoire pourrait être justifiable. Me fais-je comprendre ? Je ne dis pas que le livre d’Amiech et Mattern est un mauvais livre pour la lutte parce qu’il n’est pas de la même veine que ceux de Roy ou Chemillier-Gendreau. Je dis seulement qu’il peut être bon de poser la question des armes. Et je ne vois pas comment on pourrait écrire un bon livre de lutte sans avoir une idée claire de quelle sorte d’arme on veut que ce livre soit dans cette lutte. Le combat de géants entre le froid Progrès rationnel – quantitatif, abstrait et déraciné – et la chaleureuse Vie sensible – qualitative, respectueuse des particularités et communautaire – est rarement la meilleure arme. Peut-être certains peuvent-ils en faire quelque chose d’intéressant, mais je ne connais pas beaucoup d’exemples. Weil ? – il paraît ; Heidegger ? – j’en suis convaincu ; Debord ? – sans doute. Amiech et Mattern savent qu’ils n’ont pas leur talent, mais ils ignorent, semble-t-il, qu’il faudrait l’avoir pour écrire un bon livre tout en restant constamment à ce haut degré d’abstraction – mais peu importe, je l’ai déjà dit : libre à chacun d’écrire de mauvais livres. Je veux juste montrer que le leur n’est pas un bon livre de lutte. Il ne l’est pas, en tout cas, à la façon de celui de Roy.
Le coût des vivres
Prenons maintenant une œuvre, cette fois, protechnologique : La Conquête du pain, de Pierre Kropotkine. Quel livre de lutte, celui-là ! Et de quelle lutte ! On est en France, en 1891 : non seulement, dit Kropotkine, tout le monde « sent la nécessité d’une révolution sociale », mais, à nouveau, 20 ans après la défaite de la Commune, « les riches comme les pauvres ne se dissimulent pas que cette révolution est proche, qu’elle peut éclater du jour au lendemain » (II, 2, p.33) (3). L’insurrection prochaine ne risque-t-elle pas de subir le même sort que la précédente ? Ce problème demande que l’on considère des faits précis (si précis que Kropotkine écrira quelques années plus tard, en anglais cette fois, Champs, usines et ateliers, qui traite du même problème et défend la même solution politique ; mais les faits ne sont plus exactement les mêmes alors, et ne sont pas exactement les mêmes à Londres qu’à Paris). Comme Roy, Kropotkine fourbit l’arme du problème bien posé et de la connaissance des faits précis. Mais pas dans la perspective d’une résistance : dans celle, autrement exaltante, d’une conquête. Le problème est de stratégie et de logistique. Je ne peux faire mieux que de citer presque entièrement les pages où Kropotkine le pose – pages lumineuses, questions des femmes et de la centralité du travail mises à part. À la lumière de 1792-93, 8 et la Commune, on peut déjà savoir ce qui se passera lorsque, après la débandade de leurs flics, les capitalistes et les politiques apeurés auront fui Paris :
« Des milliers d’hommes sont dans les rues et accourent le soir dans des clubs improvisés en se demandant : ‘‘que faire ?’’, discutant avec ardeur les affaires publiques. Tout le monde s’y intéresse ; les indifférents de la veille sont peut-être les plus zélés. Partout beaucoup de bonne volonté, un vif désir d’assurer la victoire. Les grands dévouements se produisent. Le peuple ne demande pas mieux que de marcher en avant. Tout cela c’est beau, c’est sublime. Mais ce n’est pas encore la révolution. Au contraire, c’est maintenant que va commencer la besogne du révolutionnaire.(…) Les socialistes gouvernementaux, les radicaux, les génies méconnus du journalisme, les orateurs à effets – bourgeois et ex-travailleurs – courront à l’Hôtel de Ville, aux ministères, prendre possession des fauteuils délaissés. Ils s’admireront dans les glaces ministérielles et s’étudieront à donner des ordres avec un air de gravité à la hauteur de leur nouvelle position (…) Élus ou acclamés, ils se rassembleront en parlements ou en Conseils de la Commune. Là, se rencontreront des hommes appartenant à dix, vingt écoles différentes qui ne sont pas des chapelles personnelles, comme on le dit souvent, mais qui répondent à des manières particulières de concevoir l’étendue, la portée, le devoir de la révolution. Alternativistes, anars, post-léninistes de la vraie gauche, autonomes, forcément réunis… [Pardon ! Kropotkine écrit en fait :] Possibilistes, collectivistes, radicaux, jacobins, blanquistes, forcément réunis, perdant leur temps à discuter. Les honnêtes gens se confondant avec les ambitieux qui ne rêvent que domination et méprisent la foule dont ils sont sortis. Tous arrivant avec des idées diamétralement opposées, forcés de conclure des alliances fictives pour constituer des majorités qui ne dureront qu’un jour ; se disputant, se traitant les uns les autres de réactionnaires, d’autoritaires, de coquins ; incapables de s’entendre sur des mesures sérieuses et entraînés à discutailler sur des bêtises ; ne parvenant à mettre au jour que des proclamations ronflantes ; tous se prenant au sérieux, tandis que la vraie force du mouvement sera dans la rue.Tout cela peut amuser ceux qui aiment le théâtre. Mais ce n’est pas encore la révolution ; il n’y a rien de fait !Pendant ce temps-là le peuple souffre. Les usines chôment, les ateliers sont fermés ; le commerce ne va pas. Le travailleur ne touche même plus le salaire minime qu’il touchait auparavant ; le prix des denrées monte !
Avec ce dévouement héroïque qui a toujours caractérisé le peuple et qui va au sublime lors des grandes époques, il patiente. (…) avec la bonhomie de la masse qui croit en ses meneurs, il attend que là-haut, à la Chambre, à l’Hôtel de Ville, au Comité de salut public – on s’occupe de lui.
Mais là-haut on pense à toutes sortes de choses, excepté aux souffrances de la foule. Lorsque la famine ronge la France en 1793 et compromet la révolution ; lorsque le peuple est réduit à la dernière misère, tandis que les Champs-Elysées sont sillonnés de phaétons superbes où les femmes étalent leurs parures luxueuses, Robespierre insiste devant les jacobins pour faire discuter son mémoire sur la Constitution anglaise ! Lorsque le travailleur souffre en 1848 de l’arrêt général de l’industrie, le Gouvernement provisoire et la Chambre disputaillent sur les pensions militaires et le travail des prisons, sans se demander de quoi vit le peuple pendant cette époque de crise. Et si l’on doit adresser un reproche à la Commune de Paris, née sous les canons des prussiens et ne durant que soixante-dix jours, c’est encore de ne pas avoir compris que la révolution communale ne pouvait triompher sans combattants bien nourris, et qu’avec trente sous par jour, on ne saurait à la fois se battre sur les remparts et entretenir sa famille. » (4)
Le problème est si bien posé que sa solution immédiate est évidente : la besogne du révolutionnaire, c’est l’expropriation des biens disponibles ; c’est de « prendre possession, au nom du peuple révolté, des dépôts de blé, des magasins qui regorgent de vêtements, des maisons habitables. »
« Faire en sorte que, dès le premier jour de la révolution, le travailleur sache qu’une ère nouvelle s’ouvre devant lui : que désormais personne ne sera forcé de coucher sous les ponts, à côté des palais ; de rester à jeun tant qu’il y aura de la nourriture ;
de grelotter de froid auprès des magasins de fourrures. Que tout soit à tous, en réalité comme en principe, et qu’enfin dans l’histoire il se produise une révolution qui songe aux besoins du peuple avant de lui faire la leçon sur ses devoirs. Ceci ne pourra s’accomplir par décrets, mais uniquement par la prise de possession immédiate, effective, de tout ce qui est nécessaire pour assurer la vie de tous. » (5)
Mais cela ne suffit pas. Après avoir soigneusement montré aux léninistes de son temps – celles et ceux qui feignent d’ignorer la capacité d’organisation spontanée d’un peuple en émeute permanente – qu’aucune des difficultés pratiques prétendument insurmontables (sans la dictature du parti) qu’ils opposent à cette solution n’est réelle, Kropotkine pose le seul problème qu’elle soulève vraiment, celui de sa durée :
« ‘‘Mais les vivres manqueront au bout d’un mois !’’ nous crient déjà les critiques. Tant mieux ! répondons-nous, cela prouvera que pour la première fois le prolétaire aura mangé à sa faim. Quant aux moyens de remplacer ce qui aura été consommé – c’est précisément cette question que nous allons aborder. » (6)
Nous sommes au premier quart du livre. Tout le reste est consacré à la question désormais posée : comment produire assez pour tenir ? Le problème de la mise à disposition des biens existants devient celui de la production de nouveaux biens. Kropotkine va montrer que la solution de ce second problème est en continuité avec la première : l’expropriation évitait les premières défaites militaires en réalisant la consommation immédiatement communiste ; ce qui permettra aux villes insurgées – y compris Paris, dont Kropotkine fait l’hypothèse qu’elle subirait un long état de siège – de remporter la victoire définitive, c’est la production immédiatement communiste. Le communisme n’est pas seulement possible, il est nécessaire. A la conquête du pain, le peuple se demandera par exemple si la terre des départements parisiens peut avoir rapidement une surface cultivable et un rendement suffisants pour leur population ; mais aussi, indissolublement, s’il faut, pour qu’elle les ait, instituer un procédé de contrainte au travail. Lisez si ça vous intéresse la rigoureuse démonstration à laquelle procède Kropotkine pour répondre « oui » à la première question et « non » à la seconde : le communisme n’est pas seulement possible et nécessaire, il est nécessairement anarchiste.
Ce qui m’intéresse ici n’est pas cette démonstration. Pour celles et ceux qui ont lu Amiech et Mattern et qui en gardent quelque souvenir, j’en extrais cependant ce bref passage, à titre d’exemple de la façon tout opposée dont, chez Kropotkine, se mêlent constamment les deux questions, se répondent science et jouissance, technique moderne et désaliénation, intensités productives et sentimentales :
« Les citoyens auront à se faire agriculteur. Non à la façon du paysan qui s’esquinte à la charrue pour recueillir à peine sa nourriture annuelle, mais en suivant les principes de l’agriculture intensive, maraîchère, appliquée en de vastes proportions au moyen des meilleures machines que l’homme a inventées, qu’il peut inventer. On cultivera, mais non comme la bête de somme du Cantal – le bijoutier du Temple s’y refuserait d’ailleurs – on réorganisera l’agriculture, non pas dans dix ans, mais sur-le-champ, au milieu des luttes révolutionnaires, sous peine de succomber devant l’ennemi. Il faudra le faire comme des êtres intelligents, en s’aidant du savoir, en s’organisant en bandes joyeuses comme celles qui remuaient, il y a cent ans, le Champ de Mars, pour la fête de la Fédération : travail plein de jouissances quand il ne se prolonge pas outre mesure, quand il est scientifiquement organisé, quand l’homme améliore et invente ses outils, et qu’il a conscience d’être un membre utile de la communauté. » (7)
Mais ce qui m’intéresse, c’est, je dirais, l’esprit dans lequel cette démonstration est faite. Kropotkine défend fermement la thèse de son « école », l’une de ces « vingt écoles différentes (…) qui répondent à des manières particulières de concevoir l’étendue, la portée, le devoir de la révolution ». C’est donc, si vous voulez, l’exposition d’un programme, en ce sens que c’est ce que cette école conçoit quant à ce que la révolution devra faire. Dans le cas de l’école anarchiste, sa manière particulière de concevoir est que nul n’est mieux en situation de définir ses « devoirs » que le peuple insurgé lui-même. Ce n’est donc un programme qu’au sens où c’est ce pour quoi les anarchistes agiront, ce qu’ils soutiendront dans les « clubs improvisés discutant des affaires publiques ». Ce ne l’est pas au sens où ce serait ce pour quoi ils intrigueraient dans les instances substitutives du pouvoir déchu. Mais d’autres écoles pourraient écrire d’autres livres dans le même esprit : je n’ai pris qu’un exemple. Roy est d’une autre école, elle écrit cependant dans un esprit semblable : poser des questions et diffuser un savoir qui ont été produits par un mouvement. La Conquête du pain est bien autre chose que le programme d’action qu’une élite éclairée définit selon sa philosophie du « devoir de la révolution ». Elle est l’un des produits actuels d’un mouvement – en l’occurrence : le mouvement ouvrier – au sein d’une certaine école qui en fait partie. Elle est avant tout l’un des moyens par lesquels cette école met en circulation le savoir et l’intelligence du mouvement qui sont les siens. Savoir et intelligence du mouvement : au sens où ce sont une intelligence et un savoir que le mouvement produit, chez Roy comme chez Kropotkine, mais aussi, chez ce dernier, au sens où ils ont ce même mouvement comme objet. Cela en prévision des questions qu’il se posera. Ces questions, l’école anarchiste suppose qu’elles seront – dans une certaine conjoncture prévisible justement grâce à l’expérience et à l’intelligence des luttes antérieures – des questions relatives à la conquête du pain : d’où la nécessité pour elle d’écrire La Conquête du pain.
On m’a compris : je ne dis pas que le Cauchemar est d’une autre école que la mienne. Je dis qu’il n’est d’aucune école, d’aucun mouvement. Je ne sais pas s’il est possible qu’un mouvement produise un jour une école antimoderniste digne de ce nom. Mais si le Cauchemar m’a servi à quelque chose, c’est à me rassurer sur ce point : il m’a démontré par l’exemple que ce jour funeste n’était pas encore advenu.
—-
(1). Je citerai la traduction de Claude Demanuelli, éd. Gallimard, coll. « Arcades », 1999.
(2). Soit dit en passant cette action, dont Roy fait le récit pp. 57-59, fut l’œuvre de 6000 militants déterminés, dont 7 grévistes de la faim. Autrement dit, il s’agissait d’une action minoritaire : minoritaire à l’échelle de l’Inde et du projet, qui menace de déplacer un demi-million de personnes, mais aussi à l’échelle du mouvement : un an plus tôt, une manifestation avait rassemblé 50 000 personnes. Or, c’est cette action qui a conduit au plus grand succès enregistré par
le mouvement : le retrait de la Banque mondiale, financière du projet, et la suspension des travaux. Toujours en passant, et toujours dans le but de nous ravigoter, nous autres amateurs d’actions minoritaires, j’ajouterai que celle-ci abandonna en 1995 un projet de barrage géant au Népal qui ne faisait pourtant l’objet d’aucune lutte sur les lieux ; et l’on y répète depuis lors dans les séminaires de formation internes ce slogan : « Don’t get zapped by the Narmada effect, do your EIAs [EIA signifie : Environmental Impact Assesment] ! » (Cf. Michael Goldman, Imperial Nature, Yale University Press, 2005, pp. 151-153).
(3). Le 1er nombre renvoie aux chapitres, le second aux alinéas numérotés à l’intérieur de chaque chapitre. Le numéro de page est celui de l’édition
(mauvaise… mais c’est celle que j’ai sous la main) des Éditions du Sextant, 2006.
(4). II, 2, pp. 35-37.
(5). Ibid., p. 38.
(6). V, 4, p. 87.
(7). XVI, 3, pp. 250-251.