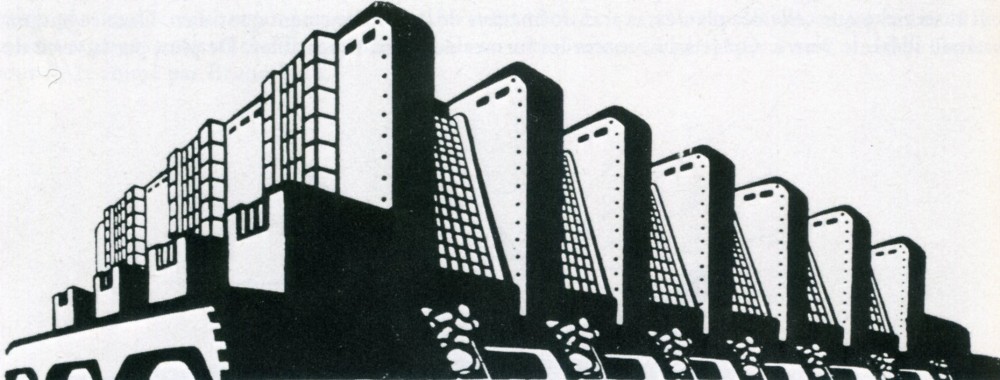Lecture critique du livre Le Cauchemar de Don Quichotte, sur l’impuissance de la jeunesse d’aujourd’hui de Matthieu Amiech et Julien Mattern, Editions Climats.
—
Le titre est accrocheur : Le Cauchemar de Don Quichotte. On savait que Don Quichotte avait des fantaisies magnifiques et dérisoires qui faisaient de lui un héros étrange, à la fois puissant et impuissant : l’hypothèse qu’il faudrait les comprendre comme des « cauchemars » semblait annoncer une éclairante réinterprétation du mythe. Mais la citation de Chesterton mise en exergue nous déçoit aussitôt : dans notre monde moderne, les cauchemars de Don Quichotte se sont réalisés, « les moulins sont effectivement devenus des géants ». Double appauvrissement de la fiction : appauvrissement de la fiction de Cervantès, appauvrissement des fantaisies de son personnage, qui, si elles sont des cauchemars, ne sont certainement pas vides de sens au point de n’être que la manifestation d’un effroi latent devant les signes prémonitoires d’une future société nucléaire. Faire de Don Quichotte un apologue moralisant, même juste comme un clin d’œil vendeur qui justifie une chouette illustration de couverture (le chevalier à la triste figure face à une centrale nucléaire), inviter à lire – ou plutôt ne pas lire – Cervantès comme si c’était du sous-Orwell, c’est déjà mal commencer. Qu’à cela ne tienne, il ne s’agit pas d’un essai littéraire… Le sous-titre nous avait prévenus : c’est un essai sur l’impuissance de la jeunesse d’aujourd’hui.
Il y a 30 ou 40 ans, la jeunesse était puissante car révolutionnaire ; aujourd’hui, fascinée par la technologie, elle n’aspire qu’à l’irresponsabilité à laquelle tout l’invite, devient donc incivile, ne peut accéder à la culture que lui proposent ses profs parce qu’elle est gavée de jeux vidéos, n’a pas de métier et ne croit donc plus en l’avenir, se gargarise d’échanges planétaires alors que seuls les échanges locaux sont épanouissants. Dépolitisée et soumise, elle laisse la maîtrise de son destin et du monde aux machines qui, telles le Léthé, lui font boire à longs traits l’oubli des horreurs qui les accompagnent. Séduite par les sirènes du progrès, elle est incapable de voir qu’il ne lui facilite la vie que pour mieux dévorer sa dignité morale et saper ainsi les bases de la démocratie. Preuve : l’échec du mouvement contre la loi Fillon en 2003, clair symptôme de ce que « si la génération de nos parents a pu être qualifiée de lyrique, nous sommes tentés de dire de la nôtre qu’elle est perdue (à la fois paumée, et sans rôle historique positif) » (p.11, souligné par les auteurs). Amiech et Mattern se garderont bien cependant d’être à nouveau lyriques : « Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle, mais on a tout à fait le droit d’étudier les lois de l’hydraulique » (citation de Chesterton, p.7). Les lois de l’hydraulique que les jeunes d’aujourd’hui doivent étudier pour être moins paumés et regagner un rôle historique positif sont heureusement consignées dans de vieux livres. « Il nous semble impossible de penser le monde contemporain sans revenir à ces références (…) qui avaient été au moins en partie à la source des troubles de 1968 » (p. 11 toujours – le mot « troubles » est bien dans le texte…) ; ces références vont « de Nietzsche à Marcuse, en passant par Weber, Arendt, Schmitt, Heidegger, Anders, Ernst Bloch, Benjamin, Adorno, Horkheimer, etc. » (p. 138), à quoi il faut ajouter, pour la France, Simone Weil, Guy Debord, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Baudoin de Bodinat et d’autres. Hélas, au lieu d’étudier ces bons auteurs les jeunes d’aujourd’hui – du moins ceux qui lisent : ils sont bien peu, mais puisqu’on écrit un livre, c’est forcément à eux qu’on s’adresse – lisent des économistes et sociologues marxistes tels que Alain Accardo, Michel Husson ou Jean-Marie Harribey.
D’où le plan du livre : première partie, critique de ces mauvais auteurs ; deuxième partie, analyse des raisons pour lesquelles les jeunes d’aujourd’hui ne lisent plus les bons auteurs ; troisième partie, brève présentation de ceux-ci.
Ainsi, après avoir dans la première partie démystifié ceux qui croient pouvoir penser le monde contemporain sans les bonnes références, Amiech et Mattern montrent par l’exemple dans la deuxième comment le penser – et plus spécialement ce qui leur semble son problème numéro 1 : l’impuissance de la jeunesse ; enfin, ils nous livrent modestement et généreusement des indications sur ces références qui leur ont permis d’avoir une pensée critique si rare dans ce contexte de « grande amnésie » (titre de leur troisième partie).
S’agissant de gens que nous rencontrons dans les luttes, et qui, dans ces luttes, ne font pas toujours apparaître bien clairement leurs positions politiques, nous apprécions qu’ils considèrent qu’« il est important de prendre à certains moments du recul et d’essayer d’identifier les forces profondes qui travaillent la réalité et nous empêchent de nous en saisir pour la maîtriser (un peu) collectivement » (p.7). Même si les questions « comment identifier les forces profondes qui travaillent la réalité ? » et « comment maîtriser (un peu) la réalité collectivement ? » ne nous semblent pas, telles quelles, très bien posées, nous ne pouvons qu’encourager ceux qui les posent à se lancer sans fausse pudeur dans le rude travail de faire une « mise au point quant à la situation politique présente » afin de clarifier leur position.
Cette position, nous nous sommes demandés, un peu bêtement peut-être, quel nom lui donner. Amiech et Mattern indiquent en passant qu’on ne peut la comprendre si l’on tente de la situer « …sur un unique continuum, qui mènerait du conservatisme le plus obtus et le plus ringard au socialisme le plus radical donc nécessairement le plus collectiviste, en passant par le prétendu pragmatisme social-démocrate » (p. 53, note 50). Selon eux, si nous ne nous trompons pas, un même postulat présiderait à la fois à la hiérarchisation qui valorise le socialisme aux dépens du conservatisme, et à l’assimilation du conservatisme à la ringardise d’une part, du meilleur socialisme au collectivisme d’autre part : le postulat que l’accumulation capitaliste est bonne en tant qu’accumulation, mauvaise seulement en tant que capitaliste. Appelons cela le postulat moderniste de la gauche.
Le propos dominant d’Amiech et Mattern étant de s’attaquer à ce postulat, ils ne verront sans doute pas d’inconvénient à ce qu’on les qualifie d’antimodernistes (1). S’ils acceptaient de se situer quelque part sur le continuum qu’ils récusent, ce devrait être du côté des conservateurs : rappelons que ce continuum va du moins (conservateurs) au plus progressiste et moderniste (les socialistes « collectivistes »). Une partie de leur stratégie pour détruire le postulat moderniste de la gauche consiste d’ailleurs logiquement à s’opposer au regrettable dénigrement dont certaines pensées ouvertement conservatrices et réactionnaires sont, d’après eux, victimes (2). Certes, les termes de « conservateur » et de « réactionnaire » sont associés à la droite, et eux sont de gauche ; mais pourquoi ne pas oser frapper les esprits en s’affirmant réactionnaires ou conservateurs de gauche ? Sans doute parce que ces qualifications laisseraient mal deviner qu’ils ne sont pas seulement de gauche : ils sont aussi révolutionnaires. Ils soutiennent en effet que seule est souhaitable une « Grande Transformation d’une ampleur comparable » à celle par laquelle « un monde entièrement soumis à la science, à l’industrie et à l’utilité économique (…) est en train de s’accomplir définitivement sous nos yeux », « mais dans un sens très différent et à bien des égards inverse » (p. 174, souligné par eux). Seulement, cette grande transformation – pardon : cette Grande Transformation – ils ne veulent pas qu’on l’appelle une révolution : « Le terme même de ‘‘révolutionnaire’’ a tendance à parasiter les débats. Il est totalement déplacé, à l’heure actuelle, de penser qu’une transformation radicale, et radicalement positive – quelque chose comme ce qu’on a longtemps entendu par ‘‘une révolution’’ –, puisse avoir lieu dans un proche avenir. L’heure n’est donc pas vraiment de reprocher aux ‘‘forces de gauche’’ (…) de ne faire que de petits pas (…). Ce qui importe avant toute chose, c’est de savoir ce qui vaut la peine d’être défendu et ce qui vaut la peine d’être exigé, et de savoir au nom de quoi on l’exige. Autrement dit, c’est d’abord de savoir si les petits pas vont dans la bonne direction ou non » (p. 52, souligné par les auteurs). Résumons : Amiech et Mattern sont des Grands Transformateurs petipatistes antimodernistes de gauche.
Mais laissons là ces vaines questions d’étiquette, et pour indiquer en quoi notre position se distingue de la leur, disons que nous sommes d’accord avec eux pour récuser le postulat moderniste de la gauche, mais pour une tout autre raison. Leur raison, c’est que l’accumulation en tant que telle, loin d’être bonne, est en fait mauvaise. Notre raison à nous, c’est qu’on ne peut séparer dans l’accumulation capitaliste deux aspects – l’un par lequel elle pourrait être dite bonne, l’autre par lequel elle devrait être dite mauvaise. Amiech et Mattern partagent cette idée avec ceux qu’ils critiquent, à ceci près que là où ceux-ci considèrent que l’un des côtés est bon et l’autre mauvais, il faudrait dire que les deux côtés sont mauvais, et que celui que les modernistes de gauche trouvent bon est en fait pire que l’autre.
On l’a vu, Amiech et Mattern aiment bien donner des conseils de lecture : la troisième partie de leur livre est tout entière une sorte de bibliographie raisonnée qu’ils donneraient à des étudiants en première année d’antitechnologie. Qu’ils nous permettent d’y ajouter le chapitre II, § 1er de Misère de la philosophie, où Marx critique la « méthode des bons et des mauvais côtés » de Proudhon : on pourra y trouver aussi bien de quoi s’interroger sur ce qu’on pourrait appeler la méthode des mauvais et des mauvais côtés d’Amiech et Mattern, par laquelle ils séparent au sein du capitalisme le moins pire du pire. Le moins pire, ce qui vaut la peine d’être défendu, ce sont par exemple les économistes critiques (p.17), l’État social (p.53), les petites entreprises (p.54), les « bases locales de l’éducation » (p. 75), c’est-à-dire semble-t-il la famille – peut-être aussi les scouts, la paroisse ? –, l’instruction et la « culture » scolaires (p.75 aussi, curieusement : n’ont-elles pas toujours eu comme premier objectif de détruire l’éducation familiale et la culture locale ?), et même… le fétichisme de la marchandise, «dernier rempart à la violence latente» (p.168), et le libéralisme qui, « dans un univers toujours plus façonné par la quête infinie de richesse abstraite (…) sera toujours le parti de la vie – aussi dégradante et prédatrice soit-elle dans ce cadre » (p.169, souligné par les auteurs). Le pire, ce dont il faut s’éloigner le plus vite possible à petits pas, ce sont, outre la quête infinie de richesse abstraite, « les gains de productivité » (p.37), « la course folle à la compétitivité » (p.45), ou encore « la marchandisation » (p.47), « l’économie » (p.59) et même « l’Économie » (p.169), « l’abstraction monétaire » (p.166), – liste nullement exhaustive des divers synonymes d’une même entité dont Amiech et Mattern ne nous livrent pas le nom propre, mais osent écrire le nom commun : le diable (p.118).
À titre d’exemple, arrêtons-nous un moment sur cette dernière page. L’honnêteté intellectuelle nous oblige à préciser que le diable est nommé dans une phrase écrite sans doute partiellement au style indirect libre. Le mouvement qui aboutit à cette phrase n’en est pas moins exemplaire de l’usage débridé de la réification des catégories en entités magiques auquel conduit la méthode des mauvais et des pires côtés. Il clôt une longue diatribe contre Internet.
Après avoir montré qu’il était idiot d’utiliser contre certaines dominations, celle par exemple des multinationales, une arme dont l’usage renforce une domination première dont les multinationales ne sont que de secondaires et piètres servantes, Amiech et Mattern concluent : « Finalement, on ne peut penser sérieusement que le réseau des réseaux est une arme dans la lutte contre l’Empire du Mal (les Méchantes Multinationales)… » : ici, ces expressions sont clairement ironiques. Mais essayons de dire clairement ce que masque l’ironie : qu’est-ce qui ne va pas dans l’idée selon laquelle les multinationales seraient l’Empire du Mal ?
Eh bien, ce qui ne va pas, ce n’est pas l’idée paranoïde qu’il y a un Empire du Mal, qu’une entité surpuissante dont le nom s’écrit en majuscules complote obstinément contre nous. Non, ce qui ne va pas, c’est que cette entité est mal identifiée par les naïfs prosélytes d’Internet. Ils n’ont peut-être pas tort, après tout, de croire qu’Internet soit une arme contre les Méchantes Multinationales ; mais quoi qu’il en soit ils ont tort de croire que l’Empire du Mal soit les Méchantes Multinationales. Car, en fait, c’est la Méchante Économie. C’est ce que dit la phrase interrompue, que nous citons maintenant en entier (vive le copier-coller !) :
« Finalement, on ne peut penser sérieusement que le réseau des réseaux est une arme dans la lutte contre l’Empire du Mal (les Méchantes Multinationales) que parce qu’on refuse de voir qu’il est en premier lieu un moyen d’approfondissement de l’emprise de l’Economie sur l’existence quotidienne, jusqu’à un point qui était difficilement imaginable il y a à peine trente ans. » Deux phrases plus loin l’Empire du Mal devient celui du diable : ce refus de voir dans toute sa profondeur le mal que fait Internet est « lié (…) au refus d’admettre que le diable de l’économie automatisée ne pourra être ramené dans sa boîte que sur la base d’échanges majoritairement locaux » (souligné par les auteurs). Certes, un diable qui sort d’une boîte n’est le plus souvent qu’une effigie ridicule du grand Belzébuth. Mais c’est bien par reprise du propos ironiquement prêté à leurs adversaires qu’Amiech et Mattern parlent maintenant du diable. Or, on vient de le voir, l’ironie ne dénonçait pas l’idée qu’il y a un diable, mais celle que le diable, ce sont les multinationales ; décidément peu cohérents dans leurs métaphores, Amiech et Mattern parlent maintenant de leur Empire du Mal à eux, le vrai diable, qu’ils appellent ici l’ « économie automatisée »…
Posons franchement la question : sommes-nous, oui ou non, des modernistes ? Eh bien, qu’on nous pardonne cette réponse de normand : nous pouvons l’être, et nous pouvons ne pas l’être. Si vous tenez absolument à ce qu’on réponde par oui ou par non, la réponse sera oui ou non selon que vous vous adresserez à l’un ou à l’autre d’entre nous, et au même ou à la même mais à propos de différents cas. Prenons l’un des objets d’horrification favori d’Amiech et Mattern : le téléphone portable. Nous serions tous partie prenante d’une résistance au portable, et encore plus d’une lutte collective contre lui, en tant que dispositif de traçabilité des individus (3). Pour le reste, chacun a sa sensibilité… Concernant ce gadget en tant que moyen de communication, qui est le seul aspect sous lequel Amiech et Mattern l’exècrent, quelques-uns (minoritaires) parmi nous pourraient reprendre ce propos de Giorgio Agamben : « Vivant (…) dans un pays oùles gestes et les comportements des individus ont été refaçonnés de fond en comble par les téléphones portables, j’ai fini par nourrir une haine implacable pour ce dispositif qui a rendu les rapports entre les personnes encore plus abstraits. » (4) Mais, à part l’évident mais dérisoire refus d’en posséder un, que faire ? Agamben poursuit comme ceci : « Même si je me suis surpris à me demander plusieurs fois comment détruire ou désactiver les téléphones portables, je ne crois pas qu’on puisse trouver là la bonne solution. » Nous ne le croyons pas non plus, du moins pour l’instant. Compte tenu du fait que le procédé technique qui permet aux portables de communiquer entre eux est aussi celui qui permet de les localiser, nous nous surprenons parfois à nous dire que dans le cadre (qu’on excuse cet horrible mot) d’une guerre révolutionnaire il faudra peut-être se poser la question en ces termes. Mais nous n’en sommes pas là. Si l’on s’effraie de l’abstraction que produit le portable, on ne peut aujourd’hui que s’efforcer d’imaginer quelle véritable résistance pourrait lui être opposée. Le Cauchemar de Don Quichotte n’est d’aucune aide, mais Agamben non plus. Il explique que ce ne pourrait être un usage nouveau du portable, et il cherche lequel ce pourrait être en méditant sur la notion de profanation (5). C’est très intéressant, mais n’étant pas plus avancés que lui dans l’imagination de ce que serait une profanation du portable, ceux qui parmi nous supportent mal l’abstraction des rapports personnels que selon eux il induit en restent à ne pas l’utiliser, et à tenir autant que possible leur perception éveillée pour repérer d’éventuelles profanations qu’inventeraient des gens plus imaginatifs qu’eux. Voilà ! Tirez-en s’il vous plaît la conclusion qu’en ce qui concerne au moins le portable nous ne sommes pas tous modernistes. Mais, surtout, comprenez pourquoi nous ne faisons des éventuelles sensibilités antimodernistes des uns ou des autres ni l’occasion d’un jugement moral, ni le principe du choix de nos alliés ou de nos ennemis politiques.
Libre à vous de penser que nous sommes donc tous en fait d’affreux modernistes, puisque les plus antimodernistes d’entre nous ne le sont, et reconnaissent ne l’être, que par goût. Et alors ? Que vous importe le degré d’authenticité ou d’intensité de notre antimodernisme pour mener un combat politique avec nous ? Admettons que celle qui ne mange pas de viandes uniquement parce qu’il se trouve qu’aucune n’est à son goût n’est pas une authentique végétarienne : est-ce une raison pour ne pas s’asseoir à sa table ? Le combat, pour revenir à l’exemple des portables, contre le contrôle par traçabilité ne mériterait-il pas quelque compromission avec des modernistes tels que nous ? Si ce genre de compromission est au-delà de vos forces, dans quelles luttes allez-vous lutter ? Que dites-vous des luttes qui mettent en mouvement des gens qui ont dans leur vie ordinaire de tout autres goûts ou dégoûts que les vôtres ? Il n’y en a d’ailleurs pas d’autres – à moins de croire qu’on lutte en fréquentant les bars alternatifs et les épiceries bio.
Lorsqu’on lit la partie centrale de leur livre – intitulée Une génération perdue ? – on s’aperçoit qu’Amiech et Mattern ne se donnent et ne nous donnent pas du tout les moyens théoriques de mener une quelconque lutte commune avec les jeunes dont ils déplorent l’impuissance. Annoncer en sous-titre une réflexion sur l’impuissance de la jeunesse pouvait être prometteur : les luttes de novembre 2005 et du printemps 2006 ont confirmé chacune à sa manière qu’il est sans doute temps d’en parler. Mais selon Amiech et Mattern, on s’en souvient, il faut « expliquer pourquoi notre génération, lorsqu’elle sort de son apathie, se révèle à ce point réceptive à leur [les intellectuels modernistes de gauche] optimisme déplacé et à leurs fausses solutions » (p.73) : il nous semble, à la lumière de ces derniers mouvements, que le problème n’est pas bien cerné…
Surtout, leur explication de l’impuissance se résume comme ceci : la société est divisée en deux grands groupes, les jeunes et les vieux ; les jeunes sont soit apathiques, soit non apathiques ; les jeunes non apathiques sont soit modernistes de gauche, soit sans références ; seule une infime minorité des jeunes non apathiques a des références, mais même elle n’est pas totalement libérée du modernisme – en témoignent les auteurs eux-mêmes dans le poignant mea culpa qui clôt leur avant-propos (6). Où est l’explication annoncée ? Ce résumé partial (ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas objectif) le montre : nous ne l’avons pas trouvée… Il nous semble qu’elle se réduit à : « Notre génération, lorsqu’elle est sortie de son apathie, en 2003, s’est révélée réceptive à l’optimisme déplacé et aux fausses solutions des modernistes de gauche… parce qu’elle n’avait pas lu notre bouquin. » Lequel, il est vrai, n’était pas encore écrit. Pourtant, sa lecture ne suscite guère le désir de reprendre le combat. On y apprend avant tout que la nécessaire prise de conscience de l’horreur de la modernité implique celle qu’on n’a rien à faire ni avec les vieux, ni avec les jeunes apathiques, c’est-à-dire l’immense majorité d’entre eux. Il ne reste plus grand monde…
Permettez-nous quelques mots sur les vieux. Amiech et Mattern supposent constamment qu’il n’y a rien à espérer d’eux ; et comme ils s’adressent (donc) aux jeunes, dont ils supposent (donc ?) qu’eux aussi supposeront la même chose, ils n’en parlent tout simplement pas. Peut-être avons-nous été parfois un peu distraits, mais nous n’avons repéré que deux très brefs passages où il en était question. Premier passage : parlant du déplorable manque de reconnaissance des vertus du travail de la part des jeunes qui vivent dans des quartiers de relégation sociale, les auteurs leur trouvent quelques circonstances atténuantes : n’oublions pas, en effet, qu’ « ils subissent de plein fouet l’effondrement des structures familiales, redoublé par la détérioration des formes d’encadrement informel des enfants et des adolescents (personnes âgées sur le pas des portes ou sur les bancs…) » (p. 74). Deuxième passage : parlant des étudiants et des lycéens qui ont laissé tomber les profs, en 2003, comme de veilles chaussettes, alors pourtant qu’elles n’étaient heureusement pas si veilles que ça (7), cette remarque : « On comprend qu’ils refusent de songer même un instant à vieillir, à les voir si soumis et si résignés, bref si vieux dans leur tête. Ils acceptent la définition de la jeunesse que leur donne L’Oréal (ne pas avoir de rides)…» (p. 80, souligné par les auteurs). Après sondage, nous n’avons en effet trouvé que fort peu de jeunes sachant dire précisément à quel moment ils avaient, dernièrement, même un instant, songé à vieillir. Mais, avouons-le, nous n’avons pas su quel sens exact donner à la mise en italique de l’expression « vieillir dans sa tête » : indique-t-elle que les auteurs souhaitent montrer qu’ils n’utilisent pas eux-mêmes ce langage ? Disons-le franchement : nous n’avons pas pu convaincre nos vieux – vous a-t-on dit que nous en avions parmi nous ? – qu’ils devaient vous remercier de ne pas les définir par leurs rides ; ils nous ont répondu qu’il n’est guère plus agréable de l’être par le contenu forcément soumis et résigné de sa tête. Certes, entre le gardien d’un écomusée et les pièces qui y sont exposées la distinction est parfois difficile à faire. Par égard pour nos vieux, nous eussions cependant apprécié qu’Amiech et Mattern la fissent, d’autant que l’encadrement, même informel, des jeunes n’est pas leur fort. Mais place aux jeunes, puisque c’est d’eux qu’il s’agit dans ce livre.
Dans la description qu’ils font des jeunes apathiques, Amiech et Mattern ne font pas expressément usage de la notion de classes. Les classes s’y trouvent cependant, on va le voir. Suivons le paragraphe où sont présentées « des explications à la franche indifférence des étudiants – voire à leur sourde hostilité – envers les mouvements sociaux » (pp. 77-78). D’une part, « il y a ceux qui maîtrisent allégrement leur sujet et trustent depuis longtemps les premières places des filières les plus prestigieuses… ». Ils ont leurs raisons pour rester apathiques : « Ils ont tellement intériorisé le fonctionnement du champ universitaire qu’ils s’interdiront toujours de faire quoi que ce soit de compromettant pour leur carrière. » D’autre part, « à l’opposé, il y a tous ceux qui doivent travailler pour s’assurer une relative sécurité matérielle, et sont contraints de perdre leur temps et leur santé dans des boulots précaires et nuisibles, sans aucune garantie sociale. » Ceux-ci aussi sont apathiques. Pourquoi ? D’abord, parce que « cela [les boulots précaires dont il vient d’être question] ne les aide pas à sortir d’un rapport de dominé à dominant avec les professeurs et le savoir dispensé. » Eux ne s’interdisent rien. Ils ne sauraient s’interdire ce dont leur maîtrise du champ leur conseillerait judicieusement de s’abstenir, puisque précisément ils n’en ont aucune maîtrise. C’est leur appartenance sociale à la classe des travailleurs pauvres qui leur interdit quelque chose – ou du moins, mais c’est manifestement une litote, elle ne les aide pas : elle les empêche de sortir d’un rapport de dominés avec leurs professeurs et avec le savoir. Leur apathie s’explique par cette domination. Pourquoi être contraint au travail salarié fait-il de son rapport avec le savoir un « rapport de dominé à dominant » ? Pourquoi être dans un rapport de dominé avec le savoir entraîne-t-il l’apathie ? Est-ce parce que tout rapport de dominé à dominant entraîne nécessairement l’apathie ? Amiech et Mattern s’attendent curieusement à ce que nous comprenions sans avoir besoin d’explications supplémentaires, puisqu’ils n’en donnent pas. L’explication s’arrête là. Nous sommes censés admettre comme allant de soi que si nous maîtrisons le savoir universitaire, nous avons de trop bonnes raisons de nous complaire dans l’apathie pour, sauf héroïsme moral rare, ne pas y céder ; et que si nous ne le maîtrisons pas, nous sommes ipso facto plongés dans une apathie dont, encore une fois, seule une grâce exceptionnelle pourrait nous faire sortir. Il faut remarquer que les deux branches de la tenaille dans laquelle nous coince ce raisonnement n’exercent pas une contrainte de même nature : pour s’en dégager, dans le premier cas il suffirait de décider de ne pas céder à des raisons ; mais dans le second nous n’avons aucune raison d’être apathiques : nous le sommes au moins autant, mais nous le sommes pour des causes. Bref : aux bourgeois le libre arbitre, aux prolétaires le déterminisme social. Amiech et Mattern se proclament dans leur avant-propos « plus ‘‘sociologues’’ » que le « sociologue [sans guillemets, cette fois] bourdieusien engagé » Alain Accardo (pp. 9 et 8), mais ils ne nous offrent qu’un superbe exemple de ce que Bourdieu – excusez la référence – appelait une sociologie qui néglige la sociologie de sa sociologie. Ils s’annoncent aussi (dans la même phrase) « plus ‘‘matérialistes’’ » ; on aimerait leur demander dans quel passage. Ils affirment que « pour ceux-là [les étudiants travailleurs précaires] – et plus généralement pour la majorité des étudiants, préoccupés avant tout par les échéances scolaires et l’obtention des diplômes –, la focalisation sur les considérations matérielles rejette [NB : ce ne sont pas les étudiants, c’est la focalisation qui rejette] le plus souvent les questions politiques du côté des préoccupations ‘‘intellectuelles’’ et du ‘‘militantisme’’, qui sont dénigrés » (p. 78 toujours : cette phrase suit immédiatement celle sur les étudiants travailleurs dominés par les profs et le savoir). Leur matérialisme consiste-t-il à poser en axiome qu’un sujet qui a de préoccupantes « considérations matérielles » va nécessairement « dénigrer » tout ce qui est intellectuel ? Et que s’il dénigre l’intellectuel il est nécessairement soumis ? Aux bourgeois l’idéalisme tempéré par la carrière, aux prolos le matérialisme vulgaire intempérant : est-ce là le slogan de leur matérialisme subtil ? On les asticotait gentiment sur leur mépris d’une classe d’âge, dont nous nous contrefoutons ; mais sur le mépris de classe social, nous sommes tentés de passer à l’insulte. La suite (p.79) ne pouvant nous apaiser – « On atteint sans doute le comble de l’absurdité avec ces individus si désireux de paraître ‘‘dans le coup’’ qu’ils en viennent à se restreindre considérablement dans certains domaines vitaux (nourriture, logement, santé) pour pouvoir suivre le rythme insensé de la surenchère consommatrice, et que l’on retrouve régulièrement habillés à la dernière mode, équipés des toutes dernières trouvailles technologiques » –, donnons la parole à quelqu’un qui sait garder son calme, Jacques Rancière : « Il n’y a pas à s’étonner que les représentants de la passion consommatrice qui excitent la plus grande fureur de nos idéologues soient en général ceux dont la capacité de consommer est la plus limitée » (8): il n’y a pas à s’en étonner, car les idéologues dont il parle (Finkielkraut et autres) sont des conservateurs de droite. Mais on peut s’étonner que des conservateurs révolutionnaires de gauche ne s’en distinguent pas sur ce point.
Concluons : si un espoir reste permis, il ne peut venir que des rares jeunes miraculeusement non apathiques. La tâche de l’avant-garde étroite constituée par ceux qui ont des références est donc de conquérir autant que possible l’avant-garde large constituée par ceux qui, faute de références, sont séduits par l’antilibéralisme moderniste. Le terme d’ « avant-garde » est bien entendu absent du livre ; nous l’utilisons pour faire apparaître qu’à notre avis son explication du fait que la révolution espérée en 2003 n’a pas eu lieu ne se distingue guère de celle, par exemple, des trotskistes après 1968 : elle n’a pas eu lieu parce que le parti révolutionnaire n’était pas encore construit. Aux questions classiques des révolutionnaires – que penser des luttes partielles ? tout ce qui ne renverse pas le capitalisme ne finit-il pas par le renforcer ? – Amiech et Mattern répondent que les luttes qui ne renversent pas le capitalisme ne valent rien, sauf si elles font gagner un peu de conscience antimoderniste. Mais alors, que faire ? Que faire collectivement, ici et maintenant ? Il ne s’agit certes pas de construire un parti, encore moins un parti révolutionnaire, mais de construire… on ne sait pas.
Les questions, elles aussi classiques, des révolutionnaires sur l’organisation – parti, syndicat, collectif, mouvement – , Amiech et Mattern ne les posent jamais. Est-ce à dire qu’ils répondent qu’il n’y a pas à les poser ? On pourrait le croire. Car ils ne proposent finalement qu’une purification individuelle de son esprit par une ascèse anachorétique. Sans toutefois donner de conseils concrets bien précis. Eux qui aiment tant conseiller des lectures, ils ne renvoient curieusement pas aux textes prémodernes – bouddhiques, par exemple – où se recueillent des expériences, pourtant authentiques et ancestrales, ce qui devrait leur plaire, de la voie spirituelle qu’ils indiquent. Tout ce qu’on en apprend, à les lire, est que c’est à la fois d’une impérieuse nécessité et quasiment impossible. Quant aux institutions nouvelles qui permettraient de lutter collectivement contre cette impossibilité, Amiech et Mattern n’en suggèrent que fort peu, et du bout des lèvres. Nous ne leur reprocherons pas cette pauvreté d’imagination, étant nous-mêmes peu enclins à suivre ce genre de voies qui, prétendument alternatives au capitalisme, tendent dangereusement à devenir alternatives à la lutte contre le capitalisme. Signalons toutefois qu’à part sans doute des clubs de lecture, l’alternative suggérée semble se limiter à des ateliers de technologie parallèle pour « s’interroger au cas par cas sur les outils que met à notre disposition la société industrielle, en se demandant systématiquement lesquels peuvent faire l’objet d’une appropriation émancipatrice… » (p.134). Les lectrices et lecteurs intéressés sont prévenus que s’ils s’y rendent sapés autrement qu’en étudiant bohème ils risquent quelques sévères remontrances, surtout s’ils sont pauvres. Le port de chaussures fabriquées en Chine est toléré lors des premières séances, à condition de faire publiquement son autocritique. Précisons également qu’il sera inutile d’y amener sa mitraillette ; la question de ses éventuelles vertus émancipatrices est déjà résolue par cet imparable argument : « Penser que l’on affaiblit l’adversaire en utilisant l’arme que celui-ci a inventée pour affermir sa domination risque fort de conduire à d’amères désillusions » (p.110).
—-
(1). Cf. par exemple p.8 : « … les grèves du printemps 2003 [furent] à la fois encourageantes et désespérantes : quand la population secoue son joug de nos jours, ce n’est pas pour mettre en cause frontalement la société que produit la modernisation permanente impulsée par le capital depuis deux siècles » (souligné par nous).
(2). Cf. p.123 : « … il peut arriver que ce soient des gens un peu ‘‘étroits d’esprit’’, ‘‘naturellement’’ réticents à l’idée de collectivisation et inquiets devant le déchaînement technologique (…) ; bref, (…) des gens que l’électeur du PS ou des Verts parisiens considérera immanquablement comme ‘‘de droite’’, qui apportent la contribution la moins massive et la moins enthousiaste à cette évolution… » ; p.135, parlant de paysans « réticents » devant « les impératifs de la modernisation » de l’agriculture : « Leur réaction [souligné par les auteurs] aurait pu servir d’avertissement » ; p.146 : « Dans leur courageux essai Révolte et Mélancolie, M. Lowie et R. Sayre s’insurgent à juste titre contre les bonnes âmes qui disqualifient la critique romantique de la modernité… ». Last but not least : « quand Le Pen est le seul homme politique à ne pas craindre de se déclarer hostile à l’extension permanente des échanges internationaux, faut-il s’étonner que bien des ouvriers, victimes des délocalisations (inévitables dans la mesure où leurs entreprises produisaient pour le ‘‘marché mondial’’), succombent au vote ‘‘protestataire’’ (…) ? » (p.97).
(3). Cf. Le Monde du 30 juin 2007, article de Nathalie Brafman : « Les opérateurs sont techniquement capables de savoir d’où est émis un appel, où il est reçu, la durée et l’heure à laquelle a été passée la communication. » Ce n’est pas tout : « Même lorsqu’il est en veille, il est possible de localiser la puce d’un appareil ». Nathalie Brafman nous rassure aussitôt : « Mais ces informations sont utilisées en principe seulement en cas d’enquêtes policières », et la Cnil, heureusement, veille à ce que ce principe soit respecté. On apprend dans cet article que des chercheurs du MIT ont mis au point un procédé de « géolocalisation » qui leur a permis de compter des supporters de foot et de Madona. « Cette technique, ajoute la journaliste, permettrait aussi de régler les différends entre forces de l’ordre et organisateurs concernant le nombre de manifestants. » Gageons que, s’agissant d’une localisation en temps réel, elle permettra aussi de régler des différends d’un autre style entre forces de l’ordre et désorganisateurs…
(4). Qu’est-ce qu’un dispositif ?, éd. Rivages poche, 2007, p.34.
(5). Cf. également Profanations, éd. Rivages poche, 2006, pp. 95-122.
(6). « Nous recevons des subsides de l’État. Nous portons des chaussures fabriquées en Asie (…). Il nous arrive même de regarder avec plaisir des matches de football à la télévision » (p.12). D’où ce redoutable problème que négligent, paraît-il, les partisans de la décroissance : « Les projets de décroissance, s’ils veulent être pris au sérieux, et ne pas servir à un énième changement de façade de la domination moderne, doivent (…) ne pas cacher qu’ils impliquent de renoncer à certaines satisfactions (au profit d’autres) que nous donne cette mégamachine et auxquelles nous sommes habitués, voire attachés. » (p. 171)
(7). « Pourtant [souligné par nous] la lutte des enseignants a été lancée et animée par des profs assez jeunes… » (p.74).
(8). La Haine de la démocratie, La fabrique éditions, 2005, p. 35