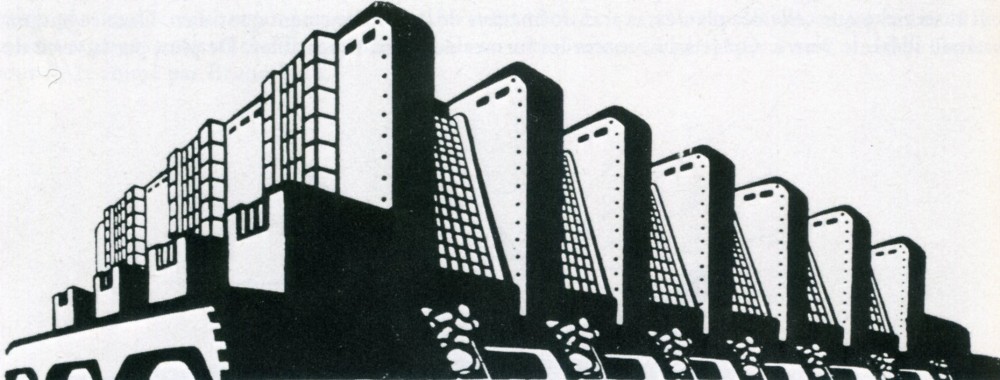Le luddisme comme légitimation
(an)historique du fétichisme antitechnologique
La « révolte luddite » est depuis les temps mêmes de son déroulement dans le premier quart du XIXe siècle au cœur de querelles acharnées d’interprétation. La bataille pour fixer le sens de la révolte des ouvriers anglais aux débuts de l’industrialisation a traversé de nombreux débats érudits, intellectuels et universitaires, spécifiquement en Grande- Bretagne, notamment en ce qui concerne la « formation de la classe ouvrière anglaise » (1) et la naissance du mouvement ouvrier britannique.
Cette bataille herméneutique à la fois historique, sémantique, théorique et pratique (2) est encore vivante aujourd’hui, si l’on considère ceux qui se font les héritiers du luddisme : les tenants actuels d’une critique radicale de la technologie, de la civilisation industrielle, faisant du luddisme un modèle et un mythe fondateur de leur propre posture. Le luddisme est donc plus que jamais un enjeu politique.
L’appellation de « néo-luddites » est significative, même si elle demeure partiellement revendiquée et si on ne peut pas tout à fait rassembler la « nébuleuse » anti-industrielle sous cette bannière. Ce dont il s’agit est tout de même un processus d’identification politique positive à la révolte des ouvriers des Midlands et du nord de l’Angleterre des années 1811-1817 et à une pratique exclusive qui caractériserait en première mesure leur action (le bris de machine), dans une lutte contre un ennemi commun au- delà des âges : la civilisation industrielle qui colonise la vie en société, la dictature de la technologie analysée comme système aliénant s’étant autonomisé et imposant son empire de manière unilatérale et non débattue.
L’empathie filiale des militants antitechnologiques pour les ouvriers anglais a trouvé des illustrations manifestes aux États-Unis. On peut penser aux Notes toward a Neo-Luddit Manifesto de l’écrivain Chellis Glendinning, et surtout au coup d’éclat du journaliste Kirkpatrick Sale, qui, en 1995, casse un ordinateur devant 1500 personnes lors d’une conférence au New York City Town Hall en déclarant que les luddites sont de retour. La même année, il publie une histoire sacralisée du luddisme, livre-manifeste d’une attaque du règne technologique qui sollicite l’histoire à la recherche d’une généalogie légitimatrice (3).
Ce credo est largement relayé en Europe avec par exemple la revue espagnole Los Amigos de Ludd. Boletin de informacion anti-industrial, mais également en France. Le référent luddite est présent dans le cadre des actions contre l’« imposition » des « nouvelles technologies » qui ont marqué ces dix dernières années, le nucléaire en amont, puis les cultures transgéniques, et plus récemment encore la lutte contre la biométrie ou les bio et nano-technologies. Parallèlement, l’ombre du bris de machine luddite plane dans des publications « anti-industrielles » (pour prendre un terme générique) qui ont proliféré, depuis L’Encyclopédie des Nuisances, à la fois revue et maison d’édition, jusqu’à Notes et morceaux choisis, In extremis, L’homme au foyer (Belgique), et de multiples brochures et articles.
Dans ce paysage, la filiation des anti-industriels avec l’expérience luddite a trouvé récemment des illustrations tout à fait significatives : la traduction en 2005 du bulletin Les Amis de Ludd, et l’année suivante celle du livre de Sale aux éditions L’Échappée (4). Cette dernière publication a donné lieu à un regain d’intérêt pour le luddisme dans le paysage « radical », certains militants libertaires apercevant sans doute dans les méchantes technologies une nouvelle « forme de domination » contre laquelle il était impérieux de se battre, parallèlement à toutes les autres (le racisme, le patriarcat… et ah oui j’oubliais, le salariat). Ainsi en deux mois, deux articles sont parus dans la revue Offensive : une interview de la traductrice de Sale dans le numéro de décembre 2006 (5), et un article d’un opposant à la biométrie dans un hors-série concocté par l’OLS et l’OCL en février 2007 (6).
Pourquoi donc se pencher ici sur cette question, tout en considérant que les débats historiographiques n’ont en eux-mêmes pas grand intérêt ? Parce que ce dont il s’agit est de s’attaquer à une doxa, à un discours qui infuse et fait de plus en plus office de vérité dans certains milieux, dont l’enjeu est en fait d’évacuer de l’histoire, pour mieux le faire dans le présent, les rapports sociaux façonnés par le capital, l’exploitation, l’antagonisme de classe, au profit d’une morale pitoyable de l’insoumission de « ceux qui ont compris » à l’empire maléfique de la technologie.
Diabolus ex machina
La question n’est donc pas à proprement parler ici de relancer une bataille herméneutique et d’opposer une interprétation du luddisme à une autre, même si on y sera, en partie, forcément amené (7).
La plongée voire l’égarement dans la concurrence de régimes de vérité et la rivalité des interprétations de l’histoire sont d’avance biaisés. Le cœur du problème est en effet moins les différents modes de mise en lecture de l’histoire elle-même, que des enjeux politiques immédiats. Or ces enjeux sont, pour le luddisme, essentiels : il s’agit d’évacuer ou non le capital et sa contradiction avec le prolétariat de l’histoire et plus avant de ce avec quoi nous sommes aujourd’hui en prise directe.
La posture interprétative du luddisme par les militants anti-industriels s’en réclamant, Sale en tête, s’inspire, comme le notent les érudits qui ont consacré un livre à l’historiographie du phénomène, d’une « sociologie constructiviste des techniques dans laquelle la ‘‘machine’’, objet de la colère luddite, se trouve replacée au centre de l’analyse et devient un sujet (au sens d’un acteur) de l’histoire du luddisme » (8).
On pourrait donc croire à une essentialisation de LA machine. Pourtant, Sale et ses partisans affirment que ce ne sont pas « les machines » en soi, par principe, (n’importe quelle innovation technique ou la technique elle-même) qui sont attaquées, mais les « machines préjudiciables à la communauté » (9). Nos militants contemporains, à travers l’un d’entre eux tout du moins, abondent dans le même sens (10). Des machines préjudiciables donc, du fait de ce qu’elles impliquent et « imposent » : le démantèlement des solidarités communautaires, la perte du savoir-faire artisanal, de l’autonomie dans le travail et de l’autoréalisation dans celui-ci. Au sein de l’ère industrielle et dans un mouvement de mécanisation du rapport au monde, les machines tendent à faire de l’homme un simple exécutant.
Pourquoi alors mettre l’accent sur la lutte contre les machines et ne parler quasiment que du bris de machines, si ce à quoi ils s’opposent est ce que la machine induit ? On sait en effet depuis E. P. Thompson, mais également depuis Morton et Tate (11) que les luddites, qui étaient le plus souvent des ouvriers très qualifiés, travaillaient déjà, avant la « révolution » industrielle, sur des mécaniques complexes. Randall, quant à lui (12), en examinant les temps précédant immédiatement le luddisme, montre que les « nouvelles » machines introduites qui respectent la qualité de l’ouvrage, l’autonomie des ouvriers et l’emploi sont accueillies sans heurts.
Pourquoi ne pas insister sur le fait que le luddisme ne se réduit pas au bris de machines, et qu’il est en réalité un mouvement protéiforme qui balaie tout un éventail de pratiques allant des plus légalistes aux plus émeutières, les secondes s’imposant souvent quand les premières, comme les pétitions, ont échoué ?
Pourquoi a contrario ne pas considérer que le bris de machines n’est pas l’exclusivité du luddisme (même si sa spécificité est réelle) ni dans le temps (il existe depuis le XVIIIe siècle) ni dans l’espace, puisqu’il n’est pas réductible à l’Angleterre, et, surtout, que ce qui le motive est à chaque fois très différent ? (13)
Alors pourquoi ? Une assimilation est en fait opérée, sur le mode de la métonymie, entre la destruction des solidarités communautaires, la perte de l’autonomie dans le travail, c’est-à-dire le fait de contrôler le procès de travail, et la machine « préjudiciable » à la communauté comme vecteur de cette destruction.
Le nœud du problème serait donc ce changement de régime de technicité (le passage de l’établi artisanal à la machine industrielle, l’ « industrialisation ») et non pas la construction d’un nouveau rapport social, dans lequel l’organisation du travail subordonne celui-ci au capital, rapport social qui déstructure effectivement le «monde d’avant », non en imposant la machine, mais dont la machine est un élément constituant. La dépossession de l’outil de travail (la machine est la forme matérielle de l’outil en question) au profit du capital, et les améliorations techniques pour gain de productivité qui vont avec, est un facteur du rapport social de subordination du travail au capital.
L’essentialisation de l’opposition aux machines par le credo anti-industriel nie que cette opposition relève avant tout d’un mouvement d’insubordination aux modalités de l’organisation du travail, du rapport entre capital et désormais ou presque prolétaires.
En plus du voile idéologique de l’anti-industrialisme qui oblitère cette lecture des choses, l’approche chronologique du luddisme que choisit Sale dans son livre entretient aussi le confusionnisme. Il existe bien une homogénéité du luddisme, celle du« geste » commun et d’un langage unificateur (14), mais les motifs d’action des ouvriers révoltés ne sont compréhensibles que dans des rapports sociaux et des contextes d’organisation du travail distincts selon les zones géographiques où le luddisme s’est mis en mouvement. Outre le poids de la crise économique qui touche l’Angleterre des années 1811-1812, synonyme de chômage partiel et de baisse des salaires, des problèmes structurels touchent la main-d’œuvre du secteur textile dans des modalités assez différentes selon les trois régions du « triangle luddite », notamment en ce qui concerne le rapport aux machines.
Dans les Midlands, autour de Nottingham (d’où est partie la révolte luddite), les métiers à tricoter les bas deviennent au début du XIXe siècle la propriété de marchands bonnetiers ou d’investisseurs, qui les louent aux ouvriers travaillant à domicile ou en petits ateliers (de 3 ou 4 métiers) et leur fournissent le fil.
Alors que dans cette région on ne voit pas l’introduction de machines nouvelles, le luddisme des tricoteurs de Nottingham naît d’une opposition à une nouvelle organisation du travail, à des pratiques destinées à abaisser les coûts de production. L’accord conclu sur le tarif (le prix de rétribution du travail) négocié en 1805 et 1807 étant arrivé à expiration et n’étant pas renouvelé, les tarifs ont reculé d’un tiers en 1811-1812. S’ajoutent à cela une tendance à la déqualification du tricotage sur métier avec le cut-up (pièces de bonneterie coupées dans de grands panneaux, de qualité inférieure et moins chères) et le colting (emploi de nombreux apprentis et de travailleurs non qualifiés) (15).
Les machines brisées sont celles des ateliers qui tirent ainsi la production vers le bas, favorisent le travail bâclé, etc. Les machines ne sont pas visées directement, mais cristallisent en quelque sorte l’opposition à la métamorphose du procès de travail, avec la dépossession des conditions objectives de la production (les métiers et la matière première) au profit des marchands.
En ce qui concerne les tisserands de coton du Lancashire, les premiers métiers mécaniques sont mis en place précocement, mais l’on compte en 1812 seulement 2 400 métiers mécaniques pour 240 000 à bras. Ce qui est en jeu ici est bien la prolétarisation des tisserands dans le premier quart du XIXe siècle : la machine est pour eux synonyme d’une mutation fondamentale dans l’organisation du travail avec le passage du travail à domicile au travail dans des unités à plus grande échelle. Cette concentration « usinière » (le système de fabrique) et la surveillance du contremaître qui va avec signifie une perte d’autonomie dans l’organisation du travail, celle du travailleur à domicile travaillant à façon, qui loue son métier et exécute sa tâche selon des prescriptions extérieures (les manufacturiers donneurs d’ouvrage), même si son indépendance réelle est largement illusoire, et les conditions du travail en chambre effroyables.
Cette prolétarisation procède également d’un abaissement considérable des salaires, source de plaintes permanentes des tisserands depuis les années 1790, qui réclament la fixation de salaires nominaux, mais également l’arbitrage des conflits du travail par les Justice of Peace conformément à la vieille législation paternaliste. E. P. Thomson fait ainsi remarquer que ce sont les métiers à tisser appartenant aux employeurs qui ont réduit les salaires de leurs ouvriers qui sont détruits.
On retrouve l’enjeu central de l’organisation du procès de travail même dans le West Riding of Yorkshire, où les tondeurs de draps représentent une aristocratie ouvrière attachée à la qualification du métier, directement menacée par l’introduction des machines nouvelles (la laineuse mécanique, gig-mill et le métier à tondre automatique, shearing frame), mais également et surtout par l’abrogation en 1809 de la vieille législation qui encadrait le marché du travail selon l’ordre traditionnel des métiers.
Or, là encore, la question fondamentale est bien celle de l’évolution de la structure productive. Ainsi, comme l’évoque un article récent d’historien (16), les bris de machines ont lieu dans cette région au sud d’une ligne Leeds-Halifax, dans une zone où commence à s’opérer une intégration verticale du système de production drapier. L’ancien système domestique recule face à la concentration commerciale et technique opérée par les marchands-fabricants qui se font manufacturiers : le temps de l’usine qui gagne du terrain signifie pour les drapiers la perte de leur indépendance et de leur capacité de négociation.
Les modalités de résistance à l’introduction de nouvelles machines dépendent donc de l’organisation du travail qui lui préexiste (17) : l’autonomie est d’autant plus défendue qu’elle s’inscrit dans le mode d’organisation du travail antérieur, c’est-à-dire le travail domestique, tandis que là où le travail est déjà spécialisé, la vulnérabilité des ouvriers à l’introduction machinique est plus importante. C’est le cas de la zone au nord de la ligne Leeds-Halifax où l’emprise des marchands-manufacturiers est d’emblée plus forte.
La focalisation sur l’introduction des machines nouvelles, pire, sur l’imposition technologique dans la lectu- re anti-industrielle du luddisme oblitère donc le rapport des ouvriers en voie de devenir prolétaires à l’organisation du travail en pleine restructuration et à l’enjeu des conditions nouvelles du marché du travail, dont les machines ne sont pas le vecteur, mais un élément agencé aux autres.
« L’historicisme », « un bordel où l’on prend soin que les clients ne se croisent jamais » (18)?
Pour la posture anti-industrielle, l’expérience historique du luddisme fonctionne en fait comme un mythe fondateur, métamorphose d’un événement ou d’un phénomène historique en lieu imaginaire, glissement vers un consensus qui détermine l’adhésion à une perspective politique cohérente. Le mythe fondateur du luddisme est d’autant plus efficace que son caractère exemplaire, héroïque est mis en exergue. La logique de constitution du mythe fondateur est en fait celle d’une surdétermination du présent dans l’évaluation rétrospective du passé. D’où la nécessité pour nous de cerner et de déconstruire cette démarche d’autolégitimation du discours anti-technologique.
Dans l’appréhension anti-industrielle du luddisme, deux énoncés se renforcent pour construire une formule magique imparable :
Le luddisme, expérience historique, est appréhendé et réinvesti par des présupposés théoriques et pratiques élaborés aujourd’hui par les tenants contemporains de la nécessité de lutter contre la technologie. L’interprétation qui en est faite procède donc mécaniquement de la surdétermination d’un aspect du phénomène (le bris de machine) et surtout de son extrapolation dans un ensemble plus vaste auquel les luddites-briseurs-de-machines se sont attaqués, puisque la machine l’incarne : la civilisation industrielle en voie d’asseoir sa domination. On prête ainsi aux ouvriers anglais de 1812 des présupposés élaborés dans ce monde honni, où les horribles technologies autonomisées ont colonisé l’ensemble des aspects de la vie, et on en fait les analystes les plus lucides de notre époque.
L’avantage de cette magouille rhétorique est bien évidemment de fluidifier le rapport entre luddisme et néo- luddisme. La structure du livre de K. Sale assure d’ailleurs à elle seule la réalité de cette fluidité. Le récit détaillé des évènements qui ont constitué le luddisme entre 1811 et 1813 est calé entre deux chapitres fonctionnant comme le miroir l’un de l’autre : le chapitre 2 intitulé « La Première Révolution industrielle » isole un certain nombre de sauts fondamentaux subis par la réalité qui la précédait (l’imposition de la technologie, l’ordre du travail, la destruction du passé etc.), catégories normées, quasiment ontologiques, que l’on retrouve in extenso dans le chapitre 8, qui lui traite de « La Seconde Révolution industrielle », s’entend celle de l’ère numérique. Deux ordres de réalité sont ainsi mis en regard et quasiment unifiés par les attaques répétées du diktat technologique.
Dans un second temps, l’interprétation ainsi effectuée rejaillit en retour sur le présent, dans le sens de la nécessité de lutter contre les technologies. L’histoire, instance suprême de légitimation s’il en est, intervient dans un sens favorable à ces mêmes présupposés pour leur donner force de vérité, les inscrire dans un héritage, une filiation.
Les fameuses « leçons » à tirer de l’histoire (19) auxquelles Sale consacre un chapitre entier (chapitre 9 : « Enseignements luddites ») s’imposent donc d’elles-mêmes, comme d’ailleurs à chaque fois qu’on a la prétention de les débusquer. Dans le long processus de prise de possession du monde humain et naturel par l’industrie et la technologie, puisque les luddites ont eu la lucidité d’entreprendre le combat contre la civilisation industrielle à l’aube même de son épanouissement, et alors que celle-ci, après avoir tout broyé sur son passage, triomphe désormais, le combat est d’autant plus pressant. Il est de l’ordre de l’impératif moral et de la saine nécessité de réactiver ce réflexe de survie que les luddites ont su avoir : entre ces derniers et ceux qui en sont les héritiers, so so so, solidarité (20).
La boucle vertueuse est bouclée, et la tournure rhétorique de la démonstration fait office de vérité.
Le problème avec le fait de court-circuiter, voire de reconstituer l’histoire n’est pas qu’est portée atteinte à une sacro-sainte réalité qu’il conviendrait de réhabiliter par allégeance et souci de scientificité ; et déconstruire la magouille méthodologique de Sale n’implique pas nécessairement de tomber dans l’ « historicisme » le plus rigidement béat. L’académisme des historiens professionnels n’admet en effet que toute appréhension de l’ « histoire » ne puisse servir qu’un objectif de connaissance scientifique existant pour elle-même, détachée du présent afin de bannir tout présupposé, et donc tout anachronisme.
Or il est plus stimulant d’un point de vue critique de dire que l’histoire part du présent, comme l’indique succinctement dans sa préface la traductrice de l’ouvrage de Sale pour en justifier la démarche. Dans une perspective qui renverse le déroulement linéaire des faits, et donc la chronologie, il est incontournable de partir de préoccupations présentes qui vont guider notre attention vers tel ou tel phénomène, pour l’appréhender en ce qu’il peut être éventuellement actualisé ici et maintenant.
Une telle démarche conduit ainsi à ce que d’aucuns écrivent dans la préface des écrits de Blanqui précédemment évoquée, que la connaissance du passé est vitale pour le présent, que « c’est à partir du présent qu’on comprend le passé et non l’inverse », et donc que le passé est avant tout un ensemble d’expériences à dénicher, un « réservoir de forces, de possibilités existentielles ». Pour ces auteurs, il s’agit en fait d’établir des « complicités » transhistoriques, des amitiés universelles par-delà les tristes conjonctures (exemple : Blanqui conspirateur professionnel, concepteur-dresseur de barricades, révolutionnaire apatride intraitable mille fois emprisonné, et donc ami existentiel de nos «Agents» contemporains), ce qui n’est d’ailleurs pas étonnant pour un «Parti» se disant « Imaginaire ». D’où l’assimilation de l’ « historicisme » empêchant ces merveilleuses rencontres à un « bordel ou l’on prend soin que les clients ne se croisent jamais » (21).
Certes. Après tout pourquoi pas. Le rapport au passé est un rapport complexe fait d’interprétations, de connaissances plus ou moins solidifiées, d’enjeux immédiats, de rêves et de mythes venant habiter et inspirer l’action présente.
Mais encore faudrait-il que puisse être éloigné le spectre, lui, peu attirant, de la stricte tautologie. Si le phénomène, l’expérience historique en question n’est pas embrassé dans ses propres conditions matérielles de production, si partir du présent consiste à prêter sans évaluation critique aux expériences du passé des préoccupations actualisées, ou à chercher dans ces expériences les traces de ces préoccupations (et donc à les construire, les fabriquer en cherchant à les dénicher), cette an- ou supra-historicité revendiquée confine à la pure et simple arnaque, dont Sale est d’ailleurs un spécialiste : analyser le luddisme à partir de sa propre posture anti-industrielle, pour ensuite vouloir tirer de cette même analyse des leçons pour le présent, qui, oh ! miracle, correspondent à la posture anti-industrielle. On ne comprend que ce qu’on veut bien comprendre en projetant sur le voile historique ses propres lubies, ce qui, de fait, abolit tout rapport dynamique à l’histoire au profit d’une fétichisation de ce qui appartient au passé.
Les espaces de partage entre différents niveaux historiques sont fondamentaux. Le mouvement révolutionnaire a toujours investi l’histoire pour assurer son autocompréhension, et il n’y a pas de raison que cela s’arrête. Mais les expériences historiques à investir ne peuvent l’être qu’en considérant qu’elles s’inscrivent dans des rapports sociaux déterminés conditionnant leur développement et/ou leur échec, qu’elles sont tactiquement adaptées à ces rapports sociaux, que leurs limites sont supposées par eux, du fait même qu’elles sont enchâssées dans ces rapports et que leur appréhension ne peut se faire ex nihilo.
Notre réelle « complicité » avec elles procède en fait de la maniabilité, de l’actualisation dans les rapports sociaux qui nous enserrent, du « comment » certaines pratiques, tactiques, modalités d’organisation ont été efficaces et/ou ont échoué à un stade différent du développement du capital, de ce qui en elles (le rapport social qu’elles développent) a subverti ou non la réalité du capital dans des conditions différentes de l’exercice de celui-ci.
Une vision diachronique des modalités d’opposition au capital ne peut établir une stricte équivalence entre elles, pas plus qu’une linéarité du genre « des luddites jusqu’à nous, même combat ». Les formes évolutives de lutte contre le capital sont par définition inscrites dans et contre ce qu’est le capital à un moment donné, et deviennent caduques totalement ou en partie si ce stade d’agencement est lui-même dépassé.
Misère de l’anti-industralisme
Ces considérations sur l’analyse du luddisme mettent surtout en exergue un certain nombre d’énoncés, de présupposés, de grilles de lecture qui traversent le discours anti-industriel dans son ensemble contre lesquels la bataille doit être menée.
Subordination contre soumission
La critique anti-industrielle procède d’une dénonciation de la « soumission » des groupes, des communautés, des individus à la technologie, qui leur impose son empire, sa dictature (22).
À l’aube de l’industrialisation, les luddites sont héroïsés en tant que résistants à ce processus démoniaque qui déstructure leur cadre de vie traditionnel, comme des « rebelles contre le futur » (titre anglais du livre de Sale), c’est-à-dire les derniers (les premiers ?) et en tous cas peut- être les seuls, à avoir tenté de s’y opposer avant l’acculturation de la classe ouvrière-classe du capital à l’industrialisme et au progrès.
Le discours antitechnologique contemporain est en effet parcouru par un jugement en technophilie du « mouvement ouvrier » ou « révolutionnaire », sans trop savoir ce que cela recouvre, si ce n’est une allégeance coupable au marxisme et un ouvriérisme complètement has been. L’adhésion théorique des organisations syndicales et politiques du mouvement ouvrier à l’accroissement des forces productives comme condition nécessaire au processus révolutionnaire procède d’une identification positive au progrès comme axe positif du devenir historique, et donc d’une complicité de fait de l’ordre bourgeois qu’il entendait abolir (23).
Face à la dégénérescence in utero du « mouvement ouvrier » représentant d’une classe créée par le capital et donc acquise au progrès, les anti-industriels ont donc trouvé dans le luddisme, ou plutôt dans ce qu’ils veulent bien en comprendre, un modèle « pur », « primitif » au sens noble du terme pour eux, disons « premier », d’insoumission à la technique. L’ampleur du mouvement, sa spontanéité et la radicalité de certains de ses modes d’action renforcent la perfection du tableau. Le bris de machine est sanctifié et extrait de l’arsenal assez vaste des pratiques luddites. Se trouve ainsi créé une sorte d’état de nature de la lutte, fonctionnant comme l’état de nature rousseauiste, où peut être observée une essence de la justesse du combat à mener, tout ce qui y fait suite étant par avance perverti (24).
Comme le notent justement les auteurs du texte Diabolus ex machina qui mène une attaque en règle des positions de l’Encyclopédie des Nuisances :
« C’est pourquoi les insurrections luddistes constituent le seul antécédent historique que l’EDN puisse se reconnaître. Parce qu’elles auraient su saisir immédiatement dans la technique le mal absolu et défendre un mode de vie en passe d’être détruit, elles constituent la seule forme de résistance réelle au capitalisme et inaugurent, à ce titre, la ‘‘subversion anti-industrielle’’ qui ‘‘court tel un fil secret à travers l’histoire des luttes sociales’’. »
Reprenons. La soumission est avant tout le fait de se soumettre, d’être soumis à une force extérieure, qu’elle soit telle autorité ou telle loi. On désigne ainsi avant tout la soumission des autres, ce qui suppose l’idée que le refus de l’existant est l’apanage des valeureux et de ceux qui savent. Encore de la moraline à haute dose. Surtout, le « monde » (moderne, industriel, technoïde) qui s’impose aux cadres traditionnels communautaires à partir du tournant du XIXe siècle devient un extérieur radical : il n’est pas vu comme un ensemble de rapports sociaux mais comme un Autre qui vient s’imposer et contre lequel il faut être capable de résister, pour ne pas s’y soumettre. Mais un extérieur à quoi exactement ? Une invasion barbare ou peut-être extra- terrestre…
Cette façon d’envisager les choses n’est rien d’autre qu’une lecture morale du monde et de l’histoire. À la notion de soumission, nous préférons opposer celle de subordination. À partir du moment où le monde et donc le capital puisqu’il s’agit de cela : le monde formaté, façonné par le capital – est envisagé en termes de rapports sociaux, le capital comme rapport social ne renvoie pas à sa « domination » stricte ou à la « soumission » des prolétaires, mais bien à un rapport réciproque entre des classes antagonistes. Les rapports sociaux ne peuvent pas être que des rapports de soumission, compte tenu de l’implication réciproque qui les sous-tend. Le travail produit le capital qui produit le travail et le reproduit.
À l’avancée de l’ « industrialisme » (comme changement de régime de technicité) s’oppose donc la mise en place du mode de production capitaliste, c’est-à-dire d’un rapport social de subordination du prolétariat à la classe capitaliste, qui prend place dans l’implication réciproque du capital et du travail (25).
Il s’agit d’un rapport social car son ressort est d’extraire du premier du surtravail au profit du second (sous forme de survaleur) : le travailleur, libéré du servage et extrait des contraintes de l’organisation corporative paternaliste, est libre (oui libre) de vendre ce qui reste en sa possession (sa force de travail), à un acheteur qui possède les conditions objectives du travail (moyens de production et de subsistance) qui font face au prolétaire comme capital (elles lui échappent partiellement ou totalement).
La première « étape », telle qu’elle a été caractérisée par le méchant Marx est la subordination formelle (26) du travail au capital, qui passe par la stricte forme sociale qu’est le salariat. Un procès de travail inchangé par rapport à l’ère précapitaliste est intégré au processus de valorisation capitaliste.
Il passe sous le commandement du capitaliste et est optimisé dans le cadre des nouveaux rapports salariaux à travers une série de transformations formelles, à savoir, en gros : l’intégration dans des unités productives plus vastes et clôturées(une coexistence subsiste avec le travail à domicile) ; un contrôle accru de la main-d’œuvre ; la formalisation de la « journée de travail » encadrée ; l’extension de la puissance mécanique du travail (machines plus perfectionnées pour abaisser les coûts de production) (27) ; une production élevée à une plus grande échelle et la mobilisation de grandes quantités de travail dans les moments critiques.
Le « moment » luddite participe donc à cette historicité du mode de production capitaliste, celle des débuts de cette phase de subordination formelle, où les travailleurs en voie de prolétarisation dans le système de fabrique sont amenés à être dépossédés des conditions objectives de production (matières premières, outillage), sur lesquelles l’artisan avait un contrôle. Le travailleur « sans réserve » vend sa force de travail au capitaliste parce que désormais les moyens matériels lui manquent pour faire autrement.
Mort à la morale
L’éthique d’une résistance à la « soumission » (sur le mode : la technologie c’est mal, il faut s’en défaire et résister, cesser les ravages du progrès et réhabiliter la « personne humaine », l’individu) véhicule en fait tout un arsenal de concepts s’y opposant directement – l’autonomie, la responsabilité individuelle, l’indépendance – qui fonctionne comme une machine de guerre moralisatrice que les plus radicaux des jésuites n’auraient pas été peu fiers d’élaborer.
La première chose est qu’envisager le travail, et au- delà tout rapport social, d’un point de vue moral est à la fois vain et abject. Car ce qui nous est servi lorsque sont dénoncées les horreurs que fait subir l’industrialisation au travail humain, en l’aliénant et en rendant son exécution interchangeable, est bel et bien une vraie morale du travail bien fait, une éthique dégueulasse de l’activité laborieuse responsable reposant sur l’indépendance et l’autonomie, la douceur des tâches à accomplir et la maîtrise consciente du processus de production. Le problème avec le travail est qu’il ne s’agit pas d’une catégorie ontologique que le méchant monde industriel a pervertie et démoralisée : le travail est un rapport social historiquement déterminé dont l’agencement subit des restructurations constantes, plus ou moins importantes. La moralité du travail pré-industriel, attachée à la sauvegarde du savoir-faire technique et à la défense de l’outil, à la maîtrise, à la complétude du geste, à l’épanouissement personnel n’est rien d’autre qu’une obscénité idéologique qui voudrait rendre attrayants le compagnonnage et le système des corporations d’Ancien Régime. Nous ne rêvons pas plus d’un OS en bleu de travail collé à une chaîne de montage que d’un fier artisan en bras de chemise finalisant son « chef-d’œuvre » sous l’œil bienveillant de son maître.
Contre une pensée antitechnologique qui dans ses fondements mêmes relève de la prêtrise, la question est aussi ici de savoir si telle ou telle pratique collective est déterminée par des impératifs tactiques ou par un principe moral. Le moralisme extrême du discours anti-industriel en France et aux USA engage en effet parallèlement à développer une pensée tacticienne. Car la lecture des pratiques luddites en termes d’impératif moral se double, dans une gestuelle faussement radicale, d’une spectacularisation du bris de machine et de son essentialisation.
Plusieurs remarques. Pour les luddites, comme l’analyse Thompson, la destruction des machines surgirait quand les ouvriers ont épuisé les moyens légaux de défense des règles anciennes qui ordonnançaient l’exercice du métier (menacées par la disparition de la vieille législation dite « paternaliste ») contre le laissez-faire de l’ordre manufacturier.
Dans un ordre d’idées assez proche, un autre historien britannique, Eric Hobsbawm, replace le bris de machine luddite dans une tradition de lutte des ouvriers anglais qu’il identifie comme « négociation collective par l’émeute ».
Un certain bris de machines, anciennes ou nouvelles, s’impose depuis le XVIIIe siècle comme un moyen normal de pression sur les donneurs d’ouvrage. Cette pratique, sorte de « syndicalisme armé » avant la lettre (28),s’inscrit en fait dans une stratégie destinée à intimider les manufacturiers dans un rapport de force dont l’enjeu peut concerner les salaires ou les conditions de travail. Ce type de bris de machines, hérité, cyclique, et qui pour Hobsbawm caractérise également le luddisme, participe donc à un arsenal de pratiques intriquées les unes aux autres sans qu’il ne soit individualisable : « Ce genre de destruction constituait un aspect traditionnel et établi des conflits industriels au cours de la période proto-industrielle et au premier âge de l’usine et de la mine. Ces destructions ne touchaient pas seulement les machines, mais aussi les matières premières, les produits finis, ou même la propriété privée des employeurs, selon le type de dommages auxquels ces derniers étaient le plus sensibles. » (29)
Saisir le marteau pour défoncer une tondeuse mécanique n’a donc pas à être essentialisé comme gestuelle radicale absolue et épurée : aucune pratique n’a en soi d’essence « radicale » ou révolutionnaire, et ne comporte pas nécessairement de charge subversive immédiate, ce qui compte étant le rapport établi : on peut très bien poser des bombes pour sauver des canards des labos de recherche ou s’opposer à l’avortement.
Ainsi, à considérer le bris de machine, mais également les incendies et les sabotages, ces pratiques correspondent dans leur mise en œuvre à l’objectif d’une efficience immédiate : arrêter la production et rendre l’outil inutilisable pour, en engendrant des coûts supplémentaires, grever un processus, et installer cet arrêt dans la durée. Cette efficacité est celle de coups portés au travail en voie de mécanisation et à son organisation, c’est-à-dire comme nous l’avons vu en voie de subsomption à la valorisation capitaliste.
Ces modes d’intervention ravageurs et adulés par la posture anti-industrielle sont aussi plus adaptés à un mode d’organisation clandestin, rendu clandestin lui-même par l’interdiction de la coalition ouvrière et la répression étatique : rien ne vaut en termes tactiques un coup de poing ciblé dont l’effet est immédiatement pérennisé. On frappe et on s’en va en causant le maximum de dommage au processus productif et en demeurant sur le lieu de production le moins de temps possible.
Le bris de machine s’inscrit donc dans un arsenal de pratiques possibles et inventées dans l’expérience même du mouvement, qu’il s’agit de dégainer ou non du fait de leur potentiel d’efficacité matérielle, toujours dans cette perspective de diffuser la terreur parmi les marchands- manufacturiers pour peser dans un rapport de force précis et circonstancié. Ainsi dans le Lancashire, les tisserands abandonnent vite l’attaque des usines, imprenables (30), et donc le bris de machines, pour s’attaquer directement aux capitalistes en brûlant leurs maisons par exemple, ce qui renforce d’ailleurs leur organisation clandestine.
Classe contre communauté
La critique anti-industrielle renvoie à un rapport à la communauté d’appartenance ante. Il est peu contestable – mais les choses sont plus complexes, nous le verrons – que le mouvement luddite trouve la dynamique de son déroulement dans l’existence effective d’une communauté de travail et de vie pré-industrielle à défendre, contre un processus qui la déstructure. D’ailleurs l’historiographie du luddisme inspirée des travaux Thompson (31) met en avant cet enjeu communautaire et la possibilité qu’avaient les ouvriers anglais de mobiliser les ressources propres aux communautés traditionnelles.
Le problème vient en fait davantage des effets politiques d’une filiation fantasmée à cette tradition communautaire. En effet, puisque nous sommes dans cette civilisation industrielle qui a poursuivi pour le parachever le processus de déstructuration en question, la fluidité entre luddisme et anti-industrialisme impliquerait donc ici et maintenant de poursuivre la défense communautaire.
Le concept de communauté permet de façonner un monde où les rapports sociaux, n’ont pas encore été désenchantés, contrairement à ceux qui dominent l’horrible société industrielle, opposition somme toute classique entre Gemeinschaft et Gesellschaft (32). Aurions- nous pu dire les rapports sociaux désenchantés de la société industrielle divisée en classes ? Oui, et nous touchons ici un point essentiel : la glorification de la communauté comme société traditionnelle extérieure/antérieure au monde industriel s’oppose de fait aux « classes sociales », prolétaire et bourgeoise, qui sont le pur produit de ce monde haï. Comme il a déjà été évoqué, la classe ouvrière en particulier était bien plus exposée à s’intégrer à l’univers capitaliste dont elle est le produit que des communautés traditionnelles, qui étrangères au capitalisme « industriel » avaient toutes les raisons du monde de s’opposer à l’acculturation technologique. La mise en scène communautaire s’accompagne ainsi dans le livre de Sale d’une caractérisation de la notion de « classes » sociales comme pures « inventions » (33).
Encore une fois, cette vision des choses relève d’un schématisme idéologique déconcertant qui consiste à mettre l’un en face de l’autre deux « mondes » radicalement extérieurs et oblitère un processus historique complexe, qui, loin d’être une errance désastreuse de l’humanité, ne se déroule pas en dehors de la « communauté » mais également en son sein. Outre que personne n’a « inventé » les classes et leurs contradictions, ni Marx, ni le capitalisme (parlez-en à Spartacus ou à Jacquou le Croquant), ni un complot international, pas plus que l’économie classique n’a « inventé » l’accumulation du capital, les « communautés » pré-industrielles n’ont jamais été aussi autonomes et repliées sur elles-mêmes que ne le suggèrent les anti-industriels. Elles sont déjà enserrées dans des rapports sociaux verticaux, elles sont investies dans une confrontation avec les différentes strates du pouvoir et avec les mutations du processus de production, et leur fonctionnement ne dépend pas seulement d’un recours à une tradition endogène. Elles sont travaillées de l’intérieur tout au long du mouvement de subordination du travail au capital, puisque ce qui est subordonné est justement ce mode « traditionnel » de travail, réinvesti dans un premier temps dans le processus de valorisation.
L’illusion d’une extériorité radicale entre vie et travail communautaire et univers industriel rejoint d’une certaine manière, toutes choses égales par ailleurs, l’illusion chère au programmatisme ouvrier d’une classe ouvrière extérieure au capital capable de s’en affranchir en s’affirmant en tant que classe, en libérant le travail, en se débarrassant du capital « parasitaire » et en s’universalisant. De la même manière que cette perspective programmatique fait l’impasse sur l’implication réciproque entre travail et capital, qui interdit désormais au prolétariat d’abolir le capital sans abolir sa reproduction en tant que classe et sans se nier lui-même, l’anti-industrialisme ignore l’investissement réciproque de l’appartenance « communautaire » dans le processus de valorisation, qui, de fait, abolit toute forme d’extériorité.
Les luddites se mettent de fait en mouvement pour tenter de sauvegarder des modes de vie et de travail. Au-delà de ce qu’ils sont, même si traversés par des rapports sociaux très peu attirants, faits de contrôle, de hiérarchie et de morale du travail bien fait, l’enjeu est tout de même en soi plus fondamental que de s’attaquer aujourd’hui à la domination technicienne, à la civilisation industrielle, dans un élan de petit bourgeois pleurnichard qui refuse d’utiliser Internet, le téléphone portable ou le four à micro-ondes.
Mais le problème, et pas des moindres, qui se pose avec la lecture communautaire du monde, est qu’il n’y a plus de communauté à défendre. Certes, les différentes composantes de la nébuleuse anti-industrielle ne tombent pas d’accord sur l’idéal communautaire qu’il conviendrait dès lors de restaurer : des formes de vie primitive des cueilleurs de baies d’un Zerzan à l’ancienne communauté élective des petits producteurs permettant « l’auto- accomplissement » d’un Kaczynski (34), en passant par l’idéal de la petite propriété privée qui traverse Le Cauchemar de Don Quichotte.
Il n’y a plus de communauté à défendre : les rapports sociaux capitalistes ont façonné en phase de subordination réelle l’ensemble du monde sensible. En ce sens, la communauté alternative du travail autonome et désalié- né à la mode anti-industrielle n’est qu’une réactualisation, le bon sens moral en plus, des vieilles lubies gauchistes sur l’autogestion, dont la perspective n’a jamais été autre chose que l’autogestion de l’exploitation, des grilles de salaires, des cadences et de la discipline du travail. Critiquer la société industrielle, d’où le capital est magiquement évacué, penser que nous sommes encore en présence de deux mondes extérieurs l’un à l’autre qui s’opposent (un monde industriel et celui qui lui préexiste) permet certes la perspective de ressouder des communautés alternatives, mais sans comprendre qu’il n’existera jamais aucun espace, aucun îlot autosuffisant extérieur au capital.
———
(1). E.P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Gallimard (pour la traduction française), 1988. Cet ouvrage est paru en anglais en 1963.
(2). L’historiographie et les interprétations successives du luddisme sont l’objet d’un livre publié en 2006 : Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les Luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Paris, Ère.
(3). Kirkpatrick Sale, Rebels against the Future : The Luddites and their War on the Industrial Revolution, Reading (Mass.), Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
(4). Kirkpatrick Sale, La Révolte luddite. Briseurs de machines à l’ère de l’industrialisation, Paris, L’Échappée, 2006.
(5). « Entretien. La révolte luddite », Offensive n° 12, décembre 2006, pp. 36-39.
(6). Antonius Blok, « Si j’avais un marteau… Luddisme et bris de machines », Courant alternatif, HS n° 12, février-avril 2007 / Offensive n° 13, février 2007, pp. 28-30. L’héritage luddite trouve donc toute sa place dans un hors-série consacré à la question d’être « Révolutionnaire aujourd’hui ». Une filiation directe est établie entre les ouvriers anglais et les militants antitechnologiques ayant cassé une borne biométrique dans le lycée de la Vallée-de-Chevreuse en novembre 2005.
(7). Nous renvoyons ici à deux textes d’analyse du luddisme, assez proches de notre propos, et desquels nous avons pu nous inspirer . Il s’agit du texte de Bruno Astarian paru dans le n° 113 d’Échanges, bulletin du réseau « Échanges et mouvement » (été 2005), sorte de fiche de lecture de l’ouvrage de Thompson, et le texte de Jacques Wajnsztejn, « Néo-luddisme et résistances ouvrières », Temps critiques n° 12, hiver 2001.
(8). Vincent Bourdeau, op. cit., p. 101.
(9). Kirkpatrick Sale, La Révolte luddite, op. cit., p. 287. Cette expression est tirée d’une lettre de mars 1812.
(10).« Il ne s’agit pas d’une opposition aux machines en tant que machines (…) mais en tant qu’instruments de la nouvelle économie politique, à laquelle ces populations sont clairement opposées » : Antonius Blok, « Si j’avais un marteau… Luddisme et bris de machines », op. cit., p. 29.
(11).A. L. Morton et George Tate, Histoire du mouvement ouvrier anglais, Paris, Maspero, 1963.
(12) Adrian Randall, Before the Luddites : Custom, Community and Machinery in the English Woolen Industry, 1776-1809, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
(13). À ce propos, les grosses têtes de L’Encyclopédie des Nuisances réussissent quand même à unifier sous une même bannière des expériences et des pratiques qui n’ont rien à voir les unes avec les autres, les canuts lyonnais de 1831 se trouvant transformés malgré eux en « luddites ». C’est ce que rappellent les auteurs du texte « Diabolus ex machina », tiré de la brochure de D. Caboret, P. Dumontier, P. Garonne et R. Labarrière, Contre l’EDN. Contribution à une critique du situationnisme, Paris, 2001. Cette brochure est disponible sur le site de la revue La guerre de la Liberté : http ://laguerredelaliberte.free.fr/docu.php
(14) C’est ce que montre Kevin Binfeld dans son analyse des écrits luddites : Writtings of the Luddites, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2004.
(15). La question est également celle de la répartition entre temps de travail payé et non payé. Ce dernier correspond pour le tricoteur au temps passé, pour la réalisation de chaque pièce et quelle que soit sa qualité, au montage des fils sur le métier. Or pour chaque bas de moindre qualité, l’ouvrier gagne moins même si le travail est plus vite effectué : pour gagner au final la même somme, l’ouvrier doit faire plus de pièces dans la journée, et le temps de travail non payé augmente automatiquement.
(16). Philippe Minard, « Le retour de Ned Ludd. Le luddisme et ses interprétations », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54-1, mars 2007, p. 252.
(17). Adrian Randall dans Before the Luddites, insiste sur des systèmes de production proto-industriels qui génèrent des modes de résistance différenciés à la mécanisation. Voir Vincent Bourdeau, op.cit., p. 106-107.
(18). « Répétons-le : l’historicisme est un bordel où l’on prend soin que les clients ne se croisent jamais » : cette citation en forme de métaphore, sur laquelle nous reviendrons, est issue de la préface à une édition récente de textes de Blanqui, préface concoctée par « Quelques agents du Parti imaginaire » : Auguste Blanqui, Maintenant, il faut des armes. Textes choisis et présentés par Dominique Le Nuz, Paris, La fabrique éditions, 2006, p. 26. L’historicisme est entendu par ces auteurs comme positivisme historique rigide et académique, respect religieux du continuum historique, chronique plate d’une chronologie d’évènements, faisant du passé une simple « succession de dates, de faits de modes de vie ».
(19). Ces trucs dont tout le monde parle mais qui en fait n’existent pas : à trop vouloir incarner l’histoire et à l’envisager comme une instance de légitimation, on arrive à en faire une vieille institutrice ridée et moralisante, ou, bien sûr, un tribunal. Nous n’aimons ni l’un ni l’autre.
(20). On en arrive ainsi à des formules ubuesques du genre « les populations luddites étaient d’accord sur les nuisances des nouvelles technologies » : Antonius Blok, « Si j’avais un marteau… Luddisme et bris de machines », op. cit., p. 30. Sans doute l’auteur a-t-il discuté avec les populations en question pour connaître leurs motivations antitechnologiques, ou peut-être est-ce lui qui les a converties à ses propres vues.
(21). Au regard de ces éléments, voilà comment nous comprenons cette image. Métamorphosé en bordel, l’historicisme fait monter les clients un par un par des escaliers séparés, par l’intermédiaire, sans doute, de l’historien devenu mère maquerelle. Ainsi, les clients (Blanqui et ses disciples d’aujourd’hui) qui fréquentent les mêmes filles (à savoir les mêmes pratiques : l’insurrection, la conspiration, l’émeute) ne peuvent en aucun cas partager leurs expériences charnelles communes (encore faudrait-il nous expliquer en quoi le fait, pour deux clients d’un claque, de coucher l’un après l’autre avec une même pute constitue une expérience commune…).
Quelle alternative au triste lupanar de l’historicisme où triomphe la séparation ? Sans doute un bar à hôtesses où tous les clients se croisent en sirotant du champagne, un club échangiste, ou l’idéal hippie (fouriériste ?) de la communauté des désirs charnels, où tout le monde baise les mêmes pratiques en même temps.
(22). Ce vocable du despotisme technologique trouve une illustration récente dans le livre de Cédric Biagini, Guillaume Carnino, Celia Izoard, Pièces et main- d’œuvre, La Tyrannie technologique, Paris, L’Échappée, 2007.
(23). Par extension, on va prêter à l’ « anticapitalisme » une conception neutraliste de la technique, présupposant que telle « avancée » n’est pas mauvaise en soi, le problème étant l’usage qui en est fait, conception qui confinerait en fait à une fascination technicienne. L’ « anticapitalisme » est ici une espèce de bloc informe et indifférencié qui regrouperait le vilain Marx, le mouvement ouvrier du XIXe siècle, le capitalisme d’État soviétique, l’ultragauche, le syndicalisme réformiste et révolutionnaire, la SFIO, Mao, Krazucki, Althusser et Besancenot. Quel est ce qui relie malgré tout la gauche communiste antisyndicale et antistalinienne, les adorateurs de l’URSS et le syndicalisme réformiste ? Le programmatisme ? Non ! La technophilie ! Ici encore règne la plus complète confusion, savamment entretenue, pour jeter le bébé avec l’eau du bain, la savonnette et la baignoire. Il est certes de notoriété publique que le syndicalisme, par exemple en France, s’est converti au « machinisme » dans le seconde moitié du XIXe siècle, considérant en bon représentant du programmatisme ouvrier que les prolétaires pourraient grâce à la machine économiser leurs forces, réduire leur temps de travail et dominer le procès de production dans la société future du travail libéré… Mais le mouvement prolétarien, révolutionnaire ou autre, pétri de contradictions depuis 150 ans n’est pas, loin s’en faut, réductible à ces sottises.
Si l’on considère le communisme comme le mouvement réel qui abolit l’état des choses existant, que les anti-industriels se rassurent, il n’y a rien à sauver dans le capitalisme : pas plus les technologies, les usines que les chaînes de montage, pas davantage le travail artisanal émancipateur et autonome, pas plus l’État que la démocratie, directe ou non, pas plus les flics-êtres humains à qui on peut quand même parler que les chercheurs en sciences humaines.
(24). Dans un ordre d’idée proche même si distinct, John Zerzan transforme le luddisme en paradigme d’un mouvement révolutionnaire spontané ayant eu son organisation et son autonomie propres. Seuls les luddites auraient incarné la subversion ouvrière dans une forme épurée : Elements of Refusal, Columbia, Paleo Editions, 1999, pp. 105-112. Mais aucun mouvement, aucune révolte n’a jamais inauguré la lutte contre le capital ni incarné la quintessence réifiée de cette lutte, même si le syndicalisme est – évidemment – historiquement un vecteur d’encadrement et de neutralisation des pratiques quotidiennes offensives du prolétariat dans son ensemble. Nous préférions lorsque Zerzan, avant de plonger dans ses délires primitivistes, relatait, dans les années 1970, le conflit entre la « révolte contre le travail » des OS américains et les organisations syndicales.
(25). On trouvera une mise au point très claire de ces questions dans la revue Hic Salta 98.
(26). Karl Marx, Un chapitre inédit du capital, Paris, UGE 10/18, 1971, p. 191.
(27). Ce qui est maladroitement appelé parfois « révolution technologique » est ainsi d’abord et avant tout subordonné à une modification profonde des rapports sociaux entre prolétariat et classe capitaliste, elle-même liée à la transformation du travail et du capital. Comme on peut le lire dans la revue Hic Salta 98 déjà citée : « La technologie se nourrit de ce dont le travail vivant a été dépossédé et cette dépossession est la dynamique du rapport de subordination. Les transformations technologiques que le mode de production capitaliste fait subir au procès de production ne valent que par la déqualification qu’elles permettent de faire subir au travail vivant. »
(28). Dans l’Italie des années 1970 et 1980, cette appellation a pu être employée parmi les brigadistes pour désigner une tendance à lier revendications ouvrières classiques et action armée pour aboutir à un résultat qu’une lutte syndicale aurait pu atteindre par des moyens plus « classiques ». Ainsi en est-il par exemple de l’enlèvement en juin 1981 par la colonne milanaise des Brigades rouges (colonne Walter Alasia) du directeur de l’organisation du travail chez Alfa-Roméo, en exigeant l’abandon de la mise en chômage prévue de 500 ouvriers de la firme. Il est libéré au bout de 51 jours une fois cette revendication entendue. La ligne majoritaire BR-PCC dénonce dans des débats internes sur l’orientation stratégique de l’organisation le « syndicalisme » ou « réformisme armé » de la colonne.
(29). Eric J. Hobsbawm, « Les briseurs de machines », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 53-4 bis, supplément 2006, p. 16. Cet article est paru pour la première fois en anglais en février 1952 dans le premier numéro de la revue Past and Present.
(30). E.P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, op.cit., p. 513-514.
(31). C’est par exemple le cas de C. Calhoun, The Question of Class Struggle : Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1982.
(32). La communauté, Gemeinschaft, où domine le principe de solidarité héritée entre des individus soudés dans un commun, partageant les mêmes valeurs, la même culture, s’oppose à la Gesellschaft, tissu informe d’individus égoïstes et isolés, traversée de part en part par la contradiction sociale.
(33). K. Sale, La Révolte luddite, op.cit., p. 238-239.
(34). Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir, Encyclopédie des Nuisances, 1998.