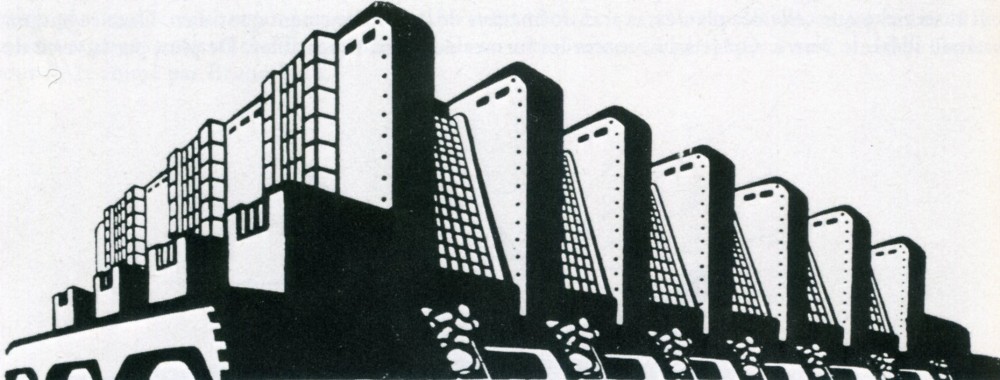Ces textes ont été écrits collectivement (entre 2007 et 2008) dans le cadre de la rédaction d’un dossier pour une revue qui n’a finalement jamais été publiée. Le collectif composant cette revue n’existe plus. Malgré les quelques années écoulées, les perspectives de ce dossier, ainsi que les contenus de ces articles semblent encore aujourd’hui largement valables, pertinents et utiles. A notre connaissance, rien de déjà publié ailleurs ne les a rendus caduques. Voilà pourquoi ils sont portés aujourd’hui à la connaissance de tous.
Category Archives: Misère de l’anti-technologie
Misère de l’antitechnologie
Pourquoi nous a-t-il semblé important de réagir à un certain nombre de discours qu’on appellera ici sommairement « antitech » pour « antitechnologiques » ?
D’abord et surtout parce nous avons constaté qu’ils circulent de plus en plus au sein d’une « mouvance » qui peut être perçue comme étant aussi la nôtre. Cherchant nous-mêmes à comprendre nos propres pratiques et les points de vue qui les sous-tendent, nous ne pouvons qu’être attentifs aux divers prêts-à-penser disponibles sur le marché de la critique radicale. Celui des antitech nous a particulièrement intéressé parce que, pour des raisons qui seront exposées dans les divers textes proposés, le fait même qu’ils soient intégrés et diffusés avec succès dans cette mouvance pose véritablement question.
« Pourtant, nous direz-vous, les antitech sont comme vous anticapitalistes : importe-t-il vraiment que ce soit pour des raisons que vous jugez mauvaises ? Le grondement des révoltes ne vous agrée-t-il que lorsqu’il finit sur l’air de L’Internationale ? Le capitalisme n’est-il pas repoussant aussi sous d’autres aspects que ceux qui vous dégoûtent plus particulièrement, aspects auxquels sont plus sensibles ceux que vous qualifiez, par un dogmatisme progressiste qu’il est peut-être temps de critiquer, de ‘‘réactionnaires’’ ?
Au diable les divisions inutiles et même dangereuses de notre mouvance. Passez outre et à l’action ! ». Cette objection n’est pas sans valeur. Il est en effet très important de pouvoir éventuellement mener un combat commun avec celles et ceux avec qui l’on a des désaccords théoriques.
C’est pourquoi nous devons quelques explications à propos de ce dossier. Des raisons d’ordres différents nous ont conduit à considérer comme important de réagir aux discours anti-industriels et antitechnologiques.
On ne peut tout d’abord accepter que le discours qui se présente comme étant le plus à la pointe des discours critiques en opposition au capitalisme et à l’État, et qui se propose, avec une diffusion très large, aux passants des librairies, aux acteurs des derniers mouvements sociaux, aux curieux de la contradiction, voire aux spectateurs de la télévision, prenne comme grille de lecture l’opposition à la technologie. En effet, que cela soit à travers quelques actions, des interventions médiatiques, des réunions publiques, des tracts, des revues, des livres, des interviews, on assiste, de la part des tenants de l’antitechnologisme à ce qu’on peut appeler une tentative d’OPA sur les énoncés critiques. Or il nous importe que, si la part publique de la subversion est amenée à tomber dans une lecture morale, ce ne soit pas sans batailles. Car il s’agit de cela : l’analyse proposée par l’antitechnologisme est profondément morale. Elle propose une ligne de partage entre le Bien et le Mal qui en appelle à la responsabilité individuelle et la culpabilisation.
Par ailleurs, il se trouve que quelques uns parmi nous ont pu côtoyer certains tenants des énoncés antitech, par exemple dans un éphémère collectif parisien contre la biométrie, ou pendant le mouvement dit « anti-CPE ». Il est apparu à ces occasions, outre un évident et profond désaccord, qu’une énergie importante était déployée pour que la critique que nous proposions ne soit ni énonçable ni audible. Les plus vieilles magouilles de fonctionnement tout à fait détestables avaient gentiment cours, parées des habits de couleur du festif et de l’informel, visant en particulier à capter, voire au besoin à faire avorter les fonctionnements collectifs s’ils n’allaient pas dans le « bon » sens. Il se trouve que nous pensons que ce type de comportement trouve ses raisons d’être dans les fondements théoriques des présupposés antitechs. C’est ce qui sera exploré dans les divers documents de ce dossier.
Présentons-en brièvement les différents éléments. Le premier texte, intitulé « Quand les prolos ne rêvaient pas d’écrans plasma », en s’appuyant plus particulièrement sur l’ouvrage de Kirpatrick Sale intitulé La Révolte luddite, explore le rapport à l’histoire autour de la référence mythologisée des « briseurs de machines », avancée régulièrement par les antitechs comme un héritage dont ils actualiseraient la pratique. Les deuxième et
troisième textes s’attardent à critiquer un ouvrage, Le Cauchemar de Don Quichotte de deux points de vue différents, l’un visant à en comprendre et à en cerner les propositions qui nous sont les plus étrangères, tandis que l’autre, de manière plus subjective, s’attache à démontrer qu’il ne s’agit pas d’un livre de lutte. Si nous avons été amenés à nous intéresser plus spécialement à cet essai, c’est parce qu’il circulait comme une référence très largement partagée au sein du collectif antibiométrie auquel certains d’entre nous ont participé, comme en témoigne le tract publié en fin de dossier. À vous de juger si, en tirant sur une cible aussi grossièrement facile à atteindre, nous méritons ou non le reproche d’être nous-mêmes trop grossiers. Mais il nous était difficile de passer sous silence notre étonnement devant le fait qu’un tel pamphlet réactionnaire aux accents finkielkrautiens voire villiéristes puisse être absorbé sans problème dans un milieu qui se pense encore globalement révolutionnaire. Le dernier texte, avec force citations, reviendra sur un certain nombre de thématiques liées aux discours antitechs, en particulier celles de la responsabilité individuelle et de la culpabilisation. Enfin, pour terminer, est proposé à la lecture un document parodique ayant le format d’un tract, et qui a été diffusé en mai 2007 à l’occasion d’un débat autour de la sortie du livre La Tyrannie technologique aux éditions L’Échappée.
Pour ce qui est des – récents – ancêtres des antitechs, L’Encyclopédie des Nuisances, n’ayant pas travaillé sérieusement sur leur prose, nous renvoyons à la lecture d’un texte intitulé Diabolus ex machina disponible là : Brochure contre l’Edn ou là Diabolus ex machina. Ses arguments nous ont semblé suffisamment convaincants et complémentaires de notre réflexion pour que nous invitions nos lecteurs à lire ce texte.
Quoiqu’il en soit, nous espérons avoir réussi à attirer l’attention des uns et des autres sur la nécessité d’éviter la paresse critique vis-à-vis de discours franchement douteux, ou l’indifférence vis-à-vis de pratiques au sujet desquelles on est en principe très attentifs. Parmi ces énoncés et positionnements figure plus particulièrement l’idée – assurément présente dans toute la nébuleuse antitech, et au-delà dans une grande partie de la mouvance alternativiste de l’extrême gauche française – selon laquelle la pertinence du choix comme grille de lecture du monde de la séparation entre le Bien et le Mal, implique naturellement que toute action subversive suppose de la part de chacun une prise de conscience de sa responsabilité individuelle dans le développement et l’entretien de ce même Mal.
Quand les prolos ne rêvaient pas d’écrans plasma
Le luddisme comme légitimation
(an)historique du fétichisme antitechnologique
La « révolte luddite » est depuis les temps mêmes de son déroulement dans le premier quart du XIXe siècle au cœur de querelles acharnées d’interprétation. La bataille pour fixer le sens de la révolte des ouvriers anglais aux débuts de l’industrialisation a traversé de nombreux débats érudits, intellectuels et universitaires, spécifiquement en Grande- Bretagne, notamment en ce qui concerne la « formation de la classe ouvrière anglaise » (1) et la naissance du mouvement ouvrier britannique.
Cette bataille herméneutique à la fois historique, sémantique, théorique et pratique (2) est encore vivante aujourd’hui, si l’on considère ceux qui se font les héritiers du luddisme : les tenants actuels d’une critique radicale de la technologie, de la civilisation industrielle, faisant du luddisme un modèle et un mythe fondateur de leur propre posture. Le luddisme est donc plus que jamais un enjeu politique.
L’appellation de « néo-luddites » est significative, même si elle demeure partiellement revendiquée et si on ne peut pas tout à fait rassembler la « nébuleuse » anti-industrielle sous cette bannière. Ce dont il s’agit est tout de même un processus d’identification politique positive à la révolte des ouvriers des Midlands et du nord de l’Angleterre des années 1811-1817 et à une pratique exclusive qui caractériserait en première mesure leur action (le bris de machine), dans une lutte contre un ennemi commun au- delà des âges : la civilisation industrielle qui colonise la vie en société, la dictature de la technologie analysée comme système aliénant s’étant autonomisé et imposant son empire de manière unilatérale et non débattue.
L’empathie filiale des militants antitechnologiques pour les ouvriers anglais a trouvé des illustrations manifestes aux États-Unis. On peut penser aux Notes toward a Neo-Luddit Manifesto de l’écrivain Chellis Glendinning, et surtout au coup d’éclat du journaliste Kirkpatrick Sale, qui, en 1995, casse un ordinateur devant 1500 personnes lors d’une conférence au New York City Town Hall en déclarant que les luddites sont de retour. La même année, il publie une histoire sacralisée du luddisme, livre-manifeste d’une attaque du règne technologique qui sollicite l’histoire à la recherche d’une généalogie légitimatrice (3).
Ce credo est largement relayé en Europe avec par exemple la revue espagnole Los Amigos de Ludd. Boletin de informacion anti-industrial, mais également en France. Le référent luddite est présent dans le cadre des actions contre l’« imposition » des « nouvelles technologies » qui ont marqué ces dix dernières années, le nucléaire en amont, puis les cultures transgéniques, et plus récemment encore la lutte contre la biométrie ou les bio et nano-technologies. Parallèlement, l’ombre du bris de machine luddite plane dans des publications « anti-industrielles » (pour prendre un terme générique) qui ont proliféré, depuis L’Encyclopédie des Nuisances, à la fois revue et maison d’édition, jusqu’à Notes et morceaux choisis, In extremis, L’homme au foyer (Belgique), et de multiples brochures et articles.
Dans ce paysage, la filiation des anti-industriels avec l’expérience luddite a trouvé récemment des illustrations tout à fait significatives : la traduction en 2005 du bulletin Les Amis de Ludd, et l’année suivante celle du livre de Sale aux éditions L’Échappée (4). Cette dernière publication a donné lieu à un regain d’intérêt pour le luddisme dans le paysage « radical », certains militants libertaires apercevant sans doute dans les méchantes technologies une nouvelle « forme de domination » contre laquelle il était impérieux de se battre, parallèlement à toutes les autres (le racisme, le patriarcat… et ah oui j’oubliais, le salariat). Ainsi en deux mois, deux articles sont parus dans la revue Offensive : une interview de la traductrice de Sale dans le numéro de décembre 2006 (5), et un article d’un opposant à la biométrie dans un hors-série concocté par l’OLS et l’OCL en février 2007 (6).
Pourquoi donc se pencher ici sur cette question, tout en considérant que les débats historiographiques n’ont en eux-mêmes pas grand intérêt ? Parce que ce dont il s’agit est de s’attaquer à une doxa, à un discours qui infuse et fait de plus en plus office de vérité dans certains milieux, dont l’enjeu est en fait d’évacuer de l’histoire, pour mieux le faire dans le présent, les rapports sociaux façonnés par le capital, l’exploitation, l’antagonisme de classe, au profit d’une morale pitoyable de l’insoumission de « ceux qui ont compris » à l’empire maléfique de la technologie.
Diabolus ex machina
La question n’est donc pas à proprement parler ici de relancer une bataille herméneutique et d’opposer une interprétation du luddisme à une autre, même si on y sera, en partie, forcément amené (7).
La plongée voire l’égarement dans la concurrence de régimes de vérité et la rivalité des interprétations de l’histoire sont d’avance biaisés. Le cœur du problème est en effet moins les différents modes de mise en lecture de l’histoire elle-même, que des enjeux politiques immédiats. Or ces enjeux sont, pour le luddisme, essentiels : il s’agit d’évacuer ou non le capital et sa contradiction avec le prolétariat de l’histoire et plus avant de ce avec quoi nous sommes aujourd’hui en prise directe.
La posture interprétative du luddisme par les militants anti-industriels s’en réclamant, Sale en tête, s’inspire, comme le notent les érudits qui ont consacré un livre à l’historiographie du phénomène, d’une « sociologie constructiviste des techniques dans laquelle la ‘‘machine’’, objet de la colère luddite, se trouve replacée au centre de l’analyse et devient un sujet (au sens d’un acteur) de l’histoire du luddisme » (8).
On pourrait donc croire à une essentialisation de LA machine. Pourtant, Sale et ses partisans affirment que ce ne sont pas « les machines » en soi, par principe, (n’importe quelle innovation technique ou la technique elle-même) qui sont attaquées, mais les « machines préjudiciables à la communauté » (9). Nos militants contemporains, à travers l’un d’entre eux tout du moins, abondent dans le même sens (10). Des machines préjudiciables donc, du fait de ce qu’elles impliquent et « imposent » : le démantèlement des solidarités communautaires, la perte du savoir-faire artisanal, de l’autonomie dans le travail et de l’autoréalisation dans celui-ci. Au sein de l’ère industrielle et dans un mouvement de mécanisation du rapport au monde, les machines tendent à faire de l’homme un simple exécutant.
Pourquoi alors mettre l’accent sur la lutte contre les machines et ne parler quasiment que du bris de machines, si ce à quoi ils s’opposent est ce que la machine induit ? On sait en effet depuis E. P. Thompson, mais également depuis Morton et Tate (11) que les luddites, qui étaient le plus souvent des ouvriers très qualifiés, travaillaient déjà, avant la « révolution » industrielle, sur des mécaniques complexes. Randall, quant à lui (12), en examinant les temps précédant immédiatement le luddisme, montre que les « nouvelles » machines introduites qui respectent la qualité de l’ouvrage, l’autonomie des ouvriers et l’emploi sont accueillies sans heurts.
Pourquoi ne pas insister sur le fait que le luddisme ne se réduit pas au bris de machines, et qu’il est en réalité un mouvement protéiforme qui balaie tout un éventail de pratiques allant des plus légalistes aux plus émeutières, les secondes s’imposant souvent quand les premières, comme les pétitions, ont échoué ?
Pourquoi a contrario ne pas considérer que le bris de machines n’est pas l’exclusivité du luddisme (même si sa spécificité est réelle) ni dans le temps (il existe depuis le XVIIIe siècle) ni dans l’espace, puisqu’il n’est pas réductible à l’Angleterre, et, surtout, que ce qui le motive est à chaque fois très différent ? (13)
Alors pourquoi ? Une assimilation est en fait opérée, sur le mode de la métonymie, entre la destruction des solidarités communautaires, la perte de l’autonomie dans le travail, c’est-à-dire le fait de contrôler le procès de travail, et la machine « préjudiciable » à la communauté comme vecteur de cette destruction.
Le nœud du problème serait donc ce changement de régime de technicité (le passage de l’établi artisanal à la machine industrielle, l’ « industrialisation ») et non pas la construction d’un nouveau rapport social, dans lequel l’organisation du travail subordonne celui-ci au capital, rapport social qui déstructure effectivement le «monde d’avant », non en imposant la machine, mais dont la machine est un élément constituant. La dépossession de l’outil de travail (la machine est la forme matérielle de l’outil en question) au profit du capital, et les améliorations techniques pour gain de productivité qui vont avec, est un facteur du rapport social de subordination du travail au capital.
L’essentialisation de l’opposition aux machines par le credo anti-industriel nie que cette opposition relève avant tout d’un mouvement d’insubordination aux modalités de l’organisation du travail, du rapport entre capital et désormais ou presque prolétaires.
En plus du voile idéologique de l’anti-industrialisme qui oblitère cette lecture des choses, l’approche chronologique du luddisme que choisit Sale dans son livre entretient aussi le confusionnisme. Il existe bien une homogénéité du luddisme, celle du« geste » commun et d’un langage unificateur (14), mais les motifs d’action des ouvriers révoltés ne sont compréhensibles que dans des rapports sociaux et des contextes d’organisation du travail distincts selon les zones géographiques où le luddisme s’est mis en mouvement. Outre le poids de la crise économique qui touche l’Angleterre des années 1811-1812, synonyme de chômage partiel et de baisse des salaires, des problèmes structurels touchent la main-d’œuvre du secteur textile dans des modalités assez différentes selon les trois régions du « triangle luddite », notamment en ce qui concerne le rapport aux machines.
Dans les Midlands, autour de Nottingham (d’où est partie la révolte luddite), les métiers à tricoter les bas deviennent au début du XIXe siècle la propriété de marchands bonnetiers ou d’investisseurs, qui les louent aux ouvriers travaillant à domicile ou en petits ateliers (de 3 ou 4 métiers) et leur fournissent le fil.
Alors que dans cette région on ne voit pas l’introduction de machines nouvelles, le luddisme des tricoteurs de Nottingham naît d’une opposition à une nouvelle organisation du travail, à des pratiques destinées à abaisser les coûts de production. L’accord conclu sur le tarif (le prix de rétribution du travail) négocié en 1805 et 1807 étant arrivé à expiration et n’étant pas renouvelé, les tarifs ont reculé d’un tiers en 1811-1812. S’ajoutent à cela une tendance à la déqualification du tricotage sur métier avec le cut-up (pièces de bonneterie coupées dans de grands panneaux, de qualité inférieure et moins chères) et le colting (emploi de nombreux apprentis et de travailleurs non qualifiés) (15).
Les machines brisées sont celles des ateliers qui tirent ainsi la production vers le bas, favorisent le travail bâclé, etc. Les machines ne sont pas visées directement, mais cristallisent en quelque sorte l’opposition à la métamorphose du procès de travail, avec la dépossession des conditions objectives de la production (les métiers et la matière première) au profit des marchands.
En ce qui concerne les tisserands de coton du Lancashire, les premiers métiers mécaniques sont mis en place précocement, mais l’on compte en 1812 seulement 2 400 métiers mécaniques pour 240 000 à bras. Ce qui est en jeu ici est bien la prolétarisation des tisserands dans le premier quart du XIXe siècle : la machine est pour eux synonyme d’une mutation fondamentale dans l’organisation du travail avec le passage du travail à domicile au travail dans des unités à plus grande échelle. Cette concentration « usinière » (le système de fabrique) et la surveillance du contremaître qui va avec signifie une perte d’autonomie dans l’organisation du travail, celle du travailleur à domicile travaillant à façon, qui loue son métier et exécute sa tâche selon des prescriptions extérieures (les manufacturiers donneurs d’ouvrage), même si son indépendance réelle est largement illusoire, et les conditions du travail en chambre effroyables.
Cette prolétarisation procède également d’un abaissement considérable des salaires, source de plaintes permanentes des tisserands depuis les années 1790, qui réclament la fixation de salaires nominaux, mais également l’arbitrage des conflits du travail par les Justice of Peace conformément à la vieille législation paternaliste. E. P. Thomson fait ainsi remarquer que ce sont les métiers à tisser appartenant aux employeurs qui ont réduit les salaires de leurs ouvriers qui sont détruits.
On retrouve l’enjeu central de l’organisation du procès de travail même dans le West Riding of Yorkshire, où les tondeurs de draps représentent une aristocratie ouvrière attachée à la qualification du métier, directement menacée par l’introduction des machines nouvelles (la laineuse mécanique, gig-mill et le métier à tondre automatique, shearing frame), mais également et surtout par l’abrogation en 1809 de la vieille législation qui encadrait le marché du travail selon l’ordre traditionnel des métiers.
Or, là encore, la question fondamentale est bien celle de l’évolution de la structure productive. Ainsi, comme l’évoque un article récent d’historien (16), les bris de machines ont lieu dans cette région au sud d’une ligne Leeds-Halifax, dans une zone où commence à s’opérer une intégration verticale du système de production drapier. L’ancien système domestique recule face à la concentration commerciale et technique opérée par les marchands-fabricants qui se font manufacturiers : le temps de l’usine qui gagne du terrain signifie pour les drapiers la perte de leur indépendance et de leur capacité de négociation.
Les modalités de résistance à l’introduction de nouvelles machines dépendent donc de l’organisation du travail qui lui préexiste (17) : l’autonomie est d’autant plus défendue qu’elle s’inscrit dans le mode d’organisation du travail antérieur, c’est-à-dire le travail domestique, tandis que là où le travail est déjà spécialisé, la vulnérabilité des ouvriers à l’introduction machinique est plus importante. C’est le cas de la zone au nord de la ligne Leeds-Halifax où l’emprise des marchands-manufacturiers est d’emblée plus forte.
La focalisation sur l’introduction des machines nouvelles, pire, sur l’imposition technologique dans la lectu- re anti-industrielle du luddisme oblitère donc le rapport des ouvriers en voie de devenir prolétaires à l’organisation du travail en pleine restructuration et à l’enjeu des conditions nouvelles du marché du travail, dont les machines ne sont pas le vecteur, mais un élément agencé aux autres.
« L’historicisme », « un bordel où l’on prend soin que les clients ne se croisent jamais » (18)?
Pour la posture anti-industrielle, l’expérience historique du luddisme fonctionne en fait comme un mythe fondateur, métamorphose d’un événement ou d’un phénomène historique en lieu imaginaire, glissement vers un consensus qui détermine l’adhésion à une perspective politique cohérente. Le mythe fondateur du luddisme est d’autant plus efficace que son caractère exemplaire, héroïque est mis en exergue. La logique de constitution du mythe fondateur est en fait celle d’une surdétermination du présent dans l’évaluation rétrospective du passé. D’où la nécessité pour nous de cerner et de déconstruire cette démarche d’autolégitimation du discours anti-technologique.
Dans l’appréhension anti-industrielle du luddisme, deux énoncés se renforcent pour construire une formule magique imparable :
Le luddisme, expérience historique, est appréhendé et réinvesti par des présupposés théoriques et pratiques élaborés aujourd’hui par les tenants contemporains de la nécessité de lutter contre la technologie. L’interprétation qui en est faite procède donc mécaniquement de la surdétermination d’un aspect du phénomène (le bris de machine) et surtout de son extrapolation dans un ensemble plus vaste auquel les luddites-briseurs-de-machines se sont attaqués, puisque la machine l’incarne : la civilisation industrielle en voie d’asseoir sa domination. On prête ainsi aux ouvriers anglais de 1812 des présupposés élaborés dans ce monde honni, où les horribles technologies autonomisées ont colonisé l’ensemble des aspects de la vie, et on en fait les analystes les plus lucides de notre époque.
L’avantage de cette magouille rhétorique est bien évidemment de fluidifier le rapport entre luddisme et néo- luddisme. La structure du livre de K. Sale assure d’ailleurs à elle seule la réalité de cette fluidité. Le récit détaillé des évènements qui ont constitué le luddisme entre 1811 et 1813 est calé entre deux chapitres fonctionnant comme le miroir l’un de l’autre : le chapitre 2 intitulé « La Première Révolution industrielle » isole un certain nombre de sauts fondamentaux subis par la réalité qui la précédait (l’imposition de la technologie, l’ordre du travail, la destruction du passé etc.), catégories normées, quasiment ontologiques, que l’on retrouve in extenso dans le chapitre 8, qui lui traite de « La Seconde Révolution industrielle », s’entend celle de l’ère numérique. Deux ordres de réalité sont ainsi mis en regard et quasiment unifiés par les attaques répétées du diktat technologique.
Dans un second temps, l’interprétation ainsi effectuée rejaillit en retour sur le présent, dans le sens de la nécessité de lutter contre les technologies. L’histoire, instance suprême de légitimation s’il en est, intervient dans un sens favorable à ces mêmes présupposés pour leur donner force de vérité, les inscrire dans un héritage, une filiation.
Les fameuses « leçons » à tirer de l’histoire (19) auxquelles Sale consacre un chapitre entier (chapitre 9 : « Enseignements luddites ») s’imposent donc d’elles-mêmes, comme d’ailleurs à chaque fois qu’on a la prétention de les débusquer. Dans le long processus de prise de possession du monde humain et naturel par l’industrie et la technologie, puisque les luddites ont eu la lucidité d’entreprendre le combat contre la civilisation industrielle à l’aube même de son épanouissement, et alors que celle-ci, après avoir tout broyé sur son passage, triomphe désormais, le combat est d’autant plus pressant. Il est de l’ordre de l’impératif moral et de la saine nécessité de réactiver ce réflexe de survie que les luddites ont su avoir : entre ces derniers et ceux qui en sont les héritiers, so so so, solidarité (20).
La boucle vertueuse est bouclée, et la tournure rhétorique de la démonstration fait office de vérité.
Le problème avec le fait de court-circuiter, voire de reconstituer l’histoire n’est pas qu’est portée atteinte à une sacro-sainte réalité qu’il conviendrait de réhabiliter par allégeance et souci de scientificité ; et déconstruire la magouille méthodologique de Sale n’implique pas nécessairement de tomber dans l’ « historicisme » le plus rigidement béat. L’académisme des historiens professionnels n’admet en effet que toute appréhension de l’ « histoire » ne puisse servir qu’un objectif de connaissance scientifique existant pour elle-même, détachée du présent afin de bannir tout présupposé, et donc tout anachronisme.
Or il est plus stimulant d’un point de vue critique de dire que l’histoire part du présent, comme l’indique succinctement dans sa préface la traductrice de l’ouvrage de Sale pour en justifier la démarche. Dans une perspective qui renverse le déroulement linéaire des faits, et donc la chronologie, il est incontournable de partir de préoccupations présentes qui vont guider notre attention vers tel ou tel phénomène, pour l’appréhender en ce qu’il peut être éventuellement actualisé ici et maintenant.
Une telle démarche conduit ainsi à ce que d’aucuns écrivent dans la préface des écrits de Blanqui précédemment évoquée, que la connaissance du passé est vitale pour le présent, que « c’est à partir du présent qu’on comprend le passé et non l’inverse », et donc que le passé est avant tout un ensemble d’expériences à dénicher, un « réservoir de forces, de possibilités existentielles ». Pour ces auteurs, il s’agit en fait d’établir des « complicités » transhistoriques, des amitiés universelles par-delà les tristes conjonctures (exemple : Blanqui conspirateur professionnel, concepteur-dresseur de barricades, révolutionnaire apatride intraitable mille fois emprisonné, et donc ami existentiel de nos «Agents» contemporains), ce qui n’est d’ailleurs pas étonnant pour un «Parti» se disant « Imaginaire ». D’où l’assimilation de l’ « historicisme » empêchant ces merveilleuses rencontres à un « bordel ou l’on prend soin que les clients ne se croisent jamais » (21).
Certes. Après tout pourquoi pas. Le rapport au passé est un rapport complexe fait d’interprétations, de connaissances plus ou moins solidifiées, d’enjeux immédiats, de rêves et de mythes venant habiter et inspirer l’action présente.
Mais encore faudrait-il que puisse être éloigné le spectre, lui, peu attirant, de la stricte tautologie. Si le phénomène, l’expérience historique en question n’est pas embrassé dans ses propres conditions matérielles de production, si partir du présent consiste à prêter sans évaluation critique aux expériences du passé des préoccupations actualisées, ou à chercher dans ces expériences les traces de ces préoccupations (et donc à les construire, les fabriquer en cherchant à les dénicher), cette an- ou supra-historicité revendiquée confine à la pure et simple arnaque, dont Sale est d’ailleurs un spécialiste : analyser le luddisme à partir de sa propre posture anti-industrielle, pour ensuite vouloir tirer de cette même analyse des leçons pour le présent, qui, oh ! miracle, correspondent à la posture anti-industrielle. On ne comprend que ce qu’on veut bien comprendre en projetant sur le voile historique ses propres lubies, ce qui, de fait, abolit tout rapport dynamique à l’histoire au profit d’une fétichisation de ce qui appartient au passé.
Les espaces de partage entre différents niveaux historiques sont fondamentaux. Le mouvement révolutionnaire a toujours investi l’histoire pour assurer son autocompréhension, et il n’y a pas de raison que cela s’arrête. Mais les expériences historiques à investir ne peuvent l’être qu’en considérant qu’elles s’inscrivent dans des rapports sociaux déterminés conditionnant leur développement et/ou leur échec, qu’elles sont tactiquement adaptées à ces rapports sociaux, que leurs limites sont supposées par eux, du fait même qu’elles sont enchâssées dans ces rapports et que leur appréhension ne peut se faire ex nihilo.
Notre réelle « complicité » avec elles procède en fait de la maniabilité, de l’actualisation dans les rapports sociaux qui nous enserrent, du « comment » certaines pratiques, tactiques, modalités d’organisation ont été efficaces et/ou ont échoué à un stade différent du développement du capital, de ce qui en elles (le rapport social qu’elles développent) a subverti ou non la réalité du capital dans des conditions différentes de l’exercice de celui-ci.
Une vision diachronique des modalités d’opposition au capital ne peut établir une stricte équivalence entre elles, pas plus qu’une linéarité du genre « des luddites jusqu’à nous, même combat ». Les formes évolutives de lutte contre le capital sont par définition inscrites dans et contre ce qu’est le capital à un moment donné, et deviennent caduques totalement ou en partie si ce stade d’agencement est lui-même dépassé.
Misère de l’anti-industralisme
Ces considérations sur l’analyse du luddisme mettent surtout en exergue un certain nombre d’énoncés, de présupposés, de grilles de lecture qui traversent le discours anti-industriel dans son ensemble contre lesquels la bataille doit être menée.
Subordination contre soumission
La critique anti-industrielle procède d’une dénonciation de la « soumission » des groupes, des communautés, des individus à la technologie, qui leur impose son empire, sa dictature (22).
À l’aube de l’industrialisation, les luddites sont héroïsés en tant que résistants à ce processus démoniaque qui déstructure leur cadre de vie traditionnel, comme des « rebelles contre le futur » (titre anglais du livre de Sale), c’est-à-dire les derniers (les premiers ?) et en tous cas peut- être les seuls, à avoir tenté de s’y opposer avant l’acculturation de la classe ouvrière-classe du capital à l’industrialisme et au progrès.
Le discours antitechnologique contemporain est en effet parcouru par un jugement en technophilie du « mouvement ouvrier » ou « révolutionnaire », sans trop savoir ce que cela recouvre, si ce n’est une allégeance coupable au marxisme et un ouvriérisme complètement has been. L’adhésion théorique des organisations syndicales et politiques du mouvement ouvrier à l’accroissement des forces productives comme condition nécessaire au processus révolutionnaire procède d’une identification positive au progrès comme axe positif du devenir historique, et donc d’une complicité de fait de l’ordre bourgeois qu’il entendait abolir (23).
Face à la dégénérescence in utero du « mouvement ouvrier » représentant d’une classe créée par le capital et donc acquise au progrès, les anti-industriels ont donc trouvé dans le luddisme, ou plutôt dans ce qu’ils veulent bien en comprendre, un modèle « pur », « primitif » au sens noble du terme pour eux, disons « premier », d’insoumission à la technique. L’ampleur du mouvement, sa spontanéité et la radicalité de certains de ses modes d’action renforcent la perfection du tableau. Le bris de machine est sanctifié et extrait de l’arsenal assez vaste des pratiques luddites. Se trouve ainsi créé une sorte d’état de nature de la lutte, fonctionnant comme l’état de nature rousseauiste, où peut être observée une essence de la justesse du combat à mener, tout ce qui y fait suite étant par avance perverti (24).
Comme le notent justement les auteurs du texte Diabolus ex machina qui mène une attaque en règle des positions de l’Encyclopédie des Nuisances :
« C’est pourquoi les insurrections luddistes constituent le seul antécédent historique que l’EDN puisse se reconnaître. Parce qu’elles auraient su saisir immédiatement dans la technique le mal absolu et défendre un mode de vie en passe d’être détruit, elles constituent la seule forme de résistance réelle au capitalisme et inaugurent, à ce titre, la ‘‘subversion anti-industrielle’’ qui ‘‘court tel un fil secret à travers l’histoire des luttes sociales’’. »
Reprenons. La soumission est avant tout le fait de se soumettre, d’être soumis à une force extérieure, qu’elle soit telle autorité ou telle loi. On désigne ainsi avant tout la soumission des autres, ce qui suppose l’idée que le refus de l’existant est l’apanage des valeureux et de ceux qui savent. Encore de la moraline à haute dose. Surtout, le « monde » (moderne, industriel, technoïde) qui s’impose aux cadres traditionnels communautaires à partir du tournant du XIXe siècle devient un extérieur radical : il n’est pas vu comme un ensemble de rapports sociaux mais comme un Autre qui vient s’imposer et contre lequel il faut être capable de résister, pour ne pas s’y soumettre. Mais un extérieur à quoi exactement ? Une invasion barbare ou peut-être extra- terrestre…
Cette façon d’envisager les choses n’est rien d’autre qu’une lecture morale du monde et de l’histoire. À la notion de soumission, nous préférons opposer celle de subordination. À partir du moment où le monde et donc le capital puisqu’il s’agit de cela : le monde formaté, façonné par le capital – est envisagé en termes de rapports sociaux, le capital comme rapport social ne renvoie pas à sa « domination » stricte ou à la « soumission » des prolétaires, mais bien à un rapport réciproque entre des classes antagonistes. Les rapports sociaux ne peuvent pas être que des rapports de soumission, compte tenu de l’implication réciproque qui les sous-tend. Le travail produit le capital qui produit le travail et le reproduit.
À l’avancée de l’ « industrialisme » (comme changement de régime de technicité) s’oppose donc la mise en place du mode de production capitaliste, c’est-à-dire d’un rapport social de subordination du prolétariat à la classe capitaliste, qui prend place dans l’implication réciproque du capital et du travail (25).
Il s’agit d’un rapport social car son ressort est d’extraire du premier du surtravail au profit du second (sous forme de survaleur) : le travailleur, libéré du servage et extrait des contraintes de l’organisation corporative paternaliste, est libre (oui libre) de vendre ce qui reste en sa possession (sa force de travail), à un acheteur qui possède les conditions objectives du travail (moyens de production et de subsistance) qui font face au prolétaire comme capital (elles lui échappent partiellement ou totalement).
La première « étape », telle qu’elle a été caractérisée par le méchant Marx est la subordination formelle (26) du travail au capital, qui passe par la stricte forme sociale qu’est le salariat. Un procès de travail inchangé par rapport à l’ère précapitaliste est intégré au processus de valorisation capitaliste.
Il passe sous le commandement du capitaliste et est optimisé dans le cadre des nouveaux rapports salariaux à travers une série de transformations formelles, à savoir, en gros : l’intégration dans des unités productives plus vastes et clôturées(une coexistence subsiste avec le travail à domicile) ; un contrôle accru de la main-d’œuvre ; la formalisation de la « journée de travail » encadrée ; l’extension de la puissance mécanique du travail (machines plus perfectionnées pour abaisser les coûts de production) (27) ; une production élevée à une plus grande échelle et la mobilisation de grandes quantités de travail dans les moments critiques.
Le « moment » luddite participe donc à cette historicité du mode de production capitaliste, celle des débuts de cette phase de subordination formelle, où les travailleurs en voie de prolétarisation dans le système de fabrique sont amenés à être dépossédés des conditions objectives de production (matières premières, outillage), sur lesquelles l’artisan avait un contrôle. Le travailleur « sans réserve » vend sa force de travail au capitaliste parce que désormais les moyens matériels lui manquent pour faire autrement.
Mort à la morale
L’éthique d’une résistance à la « soumission » (sur le mode : la technologie c’est mal, il faut s’en défaire et résister, cesser les ravages du progrès et réhabiliter la « personne humaine », l’individu) véhicule en fait tout un arsenal de concepts s’y opposant directement – l’autonomie, la responsabilité individuelle, l’indépendance – qui fonctionne comme une machine de guerre moralisatrice que les plus radicaux des jésuites n’auraient pas été peu fiers d’élaborer.
La première chose est qu’envisager le travail, et au- delà tout rapport social, d’un point de vue moral est à la fois vain et abject. Car ce qui nous est servi lorsque sont dénoncées les horreurs que fait subir l’industrialisation au travail humain, en l’aliénant et en rendant son exécution interchangeable, est bel et bien une vraie morale du travail bien fait, une éthique dégueulasse de l’activité laborieuse responsable reposant sur l’indépendance et l’autonomie, la douceur des tâches à accomplir et la maîtrise consciente du processus de production. Le problème avec le travail est qu’il ne s’agit pas d’une catégorie ontologique que le méchant monde industriel a pervertie et démoralisée : le travail est un rapport social historiquement déterminé dont l’agencement subit des restructurations constantes, plus ou moins importantes. La moralité du travail pré-industriel, attachée à la sauvegarde du savoir-faire technique et à la défense de l’outil, à la maîtrise, à la complétude du geste, à l’épanouissement personnel n’est rien d’autre qu’une obscénité idéologique qui voudrait rendre attrayants le compagnonnage et le système des corporations d’Ancien Régime. Nous ne rêvons pas plus d’un OS en bleu de travail collé à une chaîne de montage que d’un fier artisan en bras de chemise finalisant son « chef-d’œuvre » sous l’œil bienveillant de son maître.
Contre une pensée antitechnologique qui dans ses fondements mêmes relève de la prêtrise, la question est aussi ici de savoir si telle ou telle pratique collective est déterminée par des impératifs tactiques ou par un principe moral. Le moralisme extrême du discours anti-industriel en France et aux USA engage en effet parallèlement à développer une pensée tacticienne. Car la lecture des pratiques luddites en termes d’impératif moral se double, dans une gestuelle faussement radicale, d’une spectacularisation du bris de machine et de son essentialisation.
Plusieurs remarques. Pour les luddites, comme l’analyse Thompson, la destruction des machines surgirait quand les ouvriers ont épuisé les moyens légaux de défense des règles anciennes qui ordonnançaient l’exercice du métier (menacées par la disparition de la vieille législation dite « paternaliste ») contre le laissez-faire de l’ordre manufacturier.
Dans un ordre d’idées assez proche, un autre historien britannique, Eric Hobsbawm, replace le bris de machine luddite dans une tradition de lutte des ouvriers anglais qu’il identifie comme « négociation collective par l’émeute ».
Un certain bris de machines, anciennes ou nouvelles, s’impose depuis le XVIIIe siècle comme un moyen normal de pression sur les donneurs d’ouvrage. Cette pratique, sorte de « syndicalisme armé » avant la lettre (28),s’inscrit en fait dans une stratégie destinée à intimider les manufacturiers dans un rapport de force dont l’enjeu peut concerner les salaires ou les conditions de travail. Ce type de bris de machines, hérité, cyclique, et qui pour Hobsbawm caractérise également le luddisme, participe donc à un arsenal de pratiques intriquées les unes aux autres sans qu’il ne soit individualisable : « Ce genre de destruction constituait un aspect traditionnel et établi des conflits industriels au cours de la période proto-industrielle et au premier âge de l’usine et de la mine. Ces destructions ne touchaient pas seulement les machines, mais aussi les matières premières, les produits finis, ou même la propriété privée des employeurs, selon le type de dommages auxquels ces derniers étaient le plus sensibles. » (29)
Saisir le marteau pour défoncer une tondeuse mécanique n’a donc pas à être essentialisé comme gestuelle radicale absolue et épurée : aucune pratique n’a en soi d’essence « radicale » ou révolutionnaire, et ne comporte pas nécessairement de charge subversive immédiate, ce qui compte étant le rapport établi : on peut très bien poser des bombes pour sauver des canards des labos de recherche ou s’opposer à l’avortement.
Ainsi, à considérer le bris de machine, mais également les incendies et les sabotages, ces pratiques correspondent dans leur mise en œuvre à l’objectif d’une efficience immédiate : arrêter la production et rendre l’outil inutilisable pour, en engendrant des coûts supplémentaires, grever un processus, et installer cet arrêt dans la durée. Cette efficacité est celle de coups portés au travail en voie de mécanisation et à son organisation, c’est-à-dire comme nous l’avons vu en voie de subsomption à la valorisation capitaliste.
Ces modes d’intervention ravageurs et adulés par la posture anti-industrielle sont aussi plus adaptés à un mode d’organisation clandestin, rendu clandestin lui-même par l’interdiction de la coalition ouvrière et la répression étatique : rien ne vaut en termes tactiques un coup de poing ciblé dont l’effet est immédiatement pérennisé. On frappe et on s’en va en causant le maximum de dommage au processus productif et en demeurant sur le lieu de production le moins de temps possible.
Le bris de machine s’inscrit donc dans un arsenal de pratiques possibles et inventées dans l’expérience même du mouvement, qu’il s’agit de dégainer ou non du fait de leur potentiel d’efficacité matérielle, toujours dans cette perspective de diffuser la terreur parmi les marchands- manufacturiers pour peser dans un rapport de force précis et circonstancié. Ainsi dans le Lancashire, les tisserands abandonnent vite l’attaque des usines, imprenables (30), et donc le bris de machines, pour s’attaquer directement aux capitalistes en brûlant leurs maisons par exemple, ce qui renforce d’ailleurs leur organisation clandestine.
Classe contre communauté
La critique anti-industrielle renvoie à un rapport à la communauté d’appartenance ante. Il est peu contestable – mais les choses sont plus complexes, nous le verrons – que le mouvement luddite trouve la dynamique de son déroulement dans l’existence effective d’une communauté de travail et de vie pré-industrielle à défendre, contre un processus qui la déstructure. D’ailleurs l’historiographie du luddisme inspirée des travaux Thompson (31) met en avant cet enjeu communautaire et la possibilité qu’avaient les ouvriers anglais de mobiliser les ressources propres aux communautés traditionnelles.
Le problème vient en fait davantage des effets politiques d’une filiation fantasmée à cette tradition communautaire. En effet, puisque nous sommes dans cette civilisation industrielle qui a poursuivi pour le parachever le processus de déstructuration en question, la fluidité entre luddisme et anti-industrialisme impliquerait donc ici et maintenant de poursuivre la défense communautaire.
Le concept de communauté permet de façonner un monde où les rapports sociaux, n’ont pas encore été désenchantés, contrairement à ceux qui dominent l’horrible société industrielle, opposition somme toute classique entre Gemeinschaft et Gesellschaft (32). Aurions- nous pu dire les rapports sociaux désenchantés de la société industrielle divisée en classes ? Oui, et nous touchons ici un point essentiel : la glorification de la communauté comme société traditionnelle extérieure/antérieure au monde industriel s’oppose de fait aux « classes sociales », prolétaire et bourgeoise, qui sont le pur produit de ce monde haï. Comme il a déjà été évoqué, la classe ouvrière en particulier était bien plus exposée à s’intégrer à l’univers capitaliste dont elle est le produit que des communautés traditionnelles, qui étrangères au capitalisme « industriel » avaient toutes les raisons du monde de s’opposer à l’acculturation technologique. La mise en scène communautaire s’accompagne ainsi dans le livre de Sale d’une caractérisation de la notion de « classes » sociales comme pures « inventions » (33).
Encore une fois, cette vision des choses relève d’un schématisme idéologique déconcertant qui consiste à mettre l’un en face de l’autre deux « mondes » radicalement extérieurs et oblitère un processus historique complexe, qui, loin d’être une errance désastreuse de l’humanité, ne se déroule pas en dehors de la « communauté » mais également en son sein. Outre que personne n’a « inventé » les classes et leurs contradictions, ni Marx, ni le capitalisme (parlez-en à Spartacus ou à Jacquou le Croquant), ni un complot international, pas plus que l’économie classique n’a « inventé » l’accumulation du capital, les « communautés » pré-industrielles n’ont jamais été aussi autonomes et repliées sur elles-mêmes que ne le suggèrent les anti-industriels. Elles sont déjà enserrées dans des rapports sociaux verticaux, elles sont investies dans une confrontation avec les différentes strates du pouvoir et avec les mutations du processus de production, et leur fonctionnement ne dépend pas seulement d’un recours à une tradition endogène. Elles sont travaillées de l’intérieur tout au long du mouvement de subordination du travail au capital, puisque ce qui est subordonné est justement ce mode « traditionnel » de travail, réinvesti dans un premier temps dans le processus de valorisation.
L’illusion d’une extériorité radicale entre vie et travail communautaire et univers industriel rejoint d’une certaine manière, toutes choses égales par ailleurs, l’illusion chère au programmatisme ouvrier d’une classe ouvrière extérieure au capital capable de s’en affranchir en s’affirmant en tant que classe, en libérant le travail, en se débarrassant du capital « parasitaire » et en s’universalisant. De la même manière que cette perspective programmatique fait l’impasse sur l’implication réciproque entre travail et capital, qui interdit désormais au prolétariat d’abolir le capital sans abolir sa reproduction en tant que classe et sans se nier lui-même, l’anti-industrialisme ignore l’investissement réciproque de l’appartenance « communautaire » dans le processus de valorisation, qui, de fait, abolit toute forme d’extériorité.
Les luddites se mettent de fait en mouvement pour tenter de sauvegarder des modes de vie et de travail. Au-delà de ce qu’ils sont, même si traversés par des rapports sociaux très peu attirants, faits de contrôle, de hiérarchie et de morale du travail bien fait, l’enjeu est tout de même en soi plus fondamental que de s’attaquer aujourd’hui à la domination technicienne, à la civilisation industrielle, dans un élan de petit bourgeois pleurnichard qui refuse d’utiliser Internet, le téléphone portable ou le four à micro-ondes.
Mais le problème, et pas des moindres, qui se pose avec la lecture communautaire du monde, est qu’il n’y a plus de communauté à défendre. Certes, les différentes composantes de la nébuleuse anti-industrielle ne tombent pas d’accord sur l’idéal communautaire qu’il conviendrait dès lors de restaurer : des formes de vie primitive des cueilleurs de baies d’un Zerzan à l’ancienne communauté élective des petits producteurs permettant « l’auto- accomplissement » d’un Kaczynski (34), en passant par l’idéal de la petite propriété privée qui traverse Le Cauchemar de Don Quichotte.
Il n’y a plus de communauté à défendre : les rapports sociaux capitalistes ont façonné en phase de subordination réelle l’ensemble du monde sensible. En ce sens, la communauté alternative du travail autonome et désalié- né à la mode anti-industrielle n’est qu’une réactualisation, le bon sens moral en plus, des vieilles lubies gauchistes sur l’autogestion, dont la perspective n’a jamais été autre chose que l’autogestion de l’exploitation, des grilles de salaires, des cadences et de la discipline du travail. Critiquer la société industrielle, d’où le capital est magiquement évacué, penser que nous sommes encore en présence de deux mondes extérieurs l’un à l’autre qui s’opposent (un monde industriel et celui qui lui préexiste) permet certes la perspective de ressouder des communautés alternatives, mais sans comprendre qu’il n’existera jamais aucun espace, aucun îlot autosuffisant extérieur au capital.
———
(1). E.P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Gallimard (pour la traduction française), 1988. Cet ouvrage est paru en anglais en 1963.
(2). L’historiographie et les interprétations successives du luddisme sont l’objet d’un livre publié en 2006 : Vincent Bourdeau, François Jarrige, Julien Vincent, Les Luddites : bris de machines, économie politique et histoire, Paris, Ère.
(3). Kirkpatrick Sale, Rebels against the Future : The Luddites and their War on the Industrial Revolution, Reading (Mass.), Addison-Wesley Publishing Company, 1995.
(4). Kirkpatrick Sale, La Révolte luddite. Briseurs de machines à l’ère de l’industrialisation, Paris, L’Échappée, 2006.
(5). « Entretien. La révolte luddite », Offensive n° 12, décembre 2006, pp. 36-39.
(6). Antonius Blok, « Si j’avais un marteau… Luddisme et bris de machines », Courant alternatif, HS n° 12, février-avril 2007 / Offensive n° 13, février 2007, pp. 28-30. L’héritage luddite trouve donc toute sa place dans un hors-série consacré à la question d’être « Révolutionnaire aujourd’hui ». Une filiation directe est établie entre les ouvriers anglais et les militants antitechnologiques ayant cassé une borne biométrique dans le lycée de la Vallée-de-Chevreuse en novembre 2005.
(7). Nous renvoyons ici à deux textes d’analyse du luddisme, assez proches de notre propos, et desquels nous avons pu nous inspirer . Il s’agit du texte de Bruno Astarian paru dans le n° 113 d’Échanges, bulletin du réseau « Échanges et mouvement » (été 2005), sorte de fiche de lecture de l’ouvrage de Thompson, et le texte de Jacques Wajnsztejn, « Néo-luddisme et résistances ouvrières », Temps critiques n° 12, hiver 2001.
(8). Vincent Bourdeau, op. cit., p. 101.
(9). Kirkpatrick Sale, La Révolte luddite, op. cit., p. 287. Cette expression est tirée d’une lettre de mars 1812.
(10).« Il ne s’agit pas d’une opposition aux machines en tant que machines (…) mais en tant qu’instruments de la nouvelle économie politique, à laquelle ces populations sont clairement opposées » : Antonius Blok, « Si j’avais un marteau… Luddisme et bris de machines », op. cit., p. 29.
(11).A. L. Morton et George Tate, Histoire du mouvement ouvrier anglais, Paris, Maspero, 1963.
(12) Adrian Randall, Before the Luddites : Custom, Community and Machinery in the English Woolen Industry, 1776-1809, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
(13). À ce propos, les grosses têtes de L’Encyclopédie des Nuisances réussissent quand même à unifier sous une même bannière des expériences et des pratiques qui n’ont rien à voir les unes avec les autres, les canuts lyonnais de 1831 se trouvant transformés malgré eux en « luddites ». C’est ce que rappellent les auteurs du texte « Diabolus ex machina », tiré de la brochure de D. Caboret, P. Dumontier, P. Garonne et R. Labarrière, Contre l’EDN. Contribution à une critique du situationnisme, Paris, 2001. Cette brochure est disponible sur le site de la revue La guerre de la Liberté : http ://laguerredelaliberte.free.fr/docu.php
(14) C’est ce que montre Kevin Binfeld dans son analyse des écrits luddites : Writtings of the Luddites, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2004.
(15). La question est également celle de la répartition entre temps de travail payé et non payé. Ce dernier correspond pour le tricoteur au temps passé, pour la réalisation de chaque pièce et quelle que soit sa qualité, au montage des fils sur le métier. Or pour chaque bas de moindre qualité, l’ouvrier gagne moins même si le travail est plus vite effectué : pour gagner au final la même somme, l’ouvrier doit faire plus de pièces dans la journée, et le temps de travail non payé augmente automatiquement.
(16). Philippe Minard, « Le retour de Ned Ludd. Le luddisme et ses interprétations », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 54-1, mars 2007, p. 252.
(17). Adrian Randall dans Before the Luddites, insiste sur des systèmes de production proto-industriels qui génèrent des modes de résistance différenciés à la mécanisation. Voir Vincent Bourdeau, op.cit., p. 106-107.
(18). « Répétons-le : l’historicisme est un bordel où l’on prend soin que les clients ne se croisent jamais » : cette citation en forme de métaphore, sur laquelle nous reviendrons, est issue de la préface à une édition récente de textes de Blanqui, préface concoctée par « Quelques agents du Parti imaginaire » : Auguste Blanqui, Maintenant, il faut des armes. Textes choisis et présentés par Dominique Le Nuz, Paris, La fabrique éditions, 2006, p. 26. L’historicisme est entendu par ces auteurs comme positivisme historique rigide et académique, respect religieux du continuum historique, chronique plate d’une chronologie d’évènements, faisant du passé une simple « succession de dates, de faits de modes de vie ».
(19). Ces trucs dont tout le monde parle mais qui en fait n’existent pas : à trop vouloir incarner l’histoire et à l’envisager comme une instance de légitimation, on arrive à en faire une vieille institutrice ridée et moralisante, ou, bien sûr, un tribunal. Nous n’aimons ni l’un ni l’autre.
(20). On en arrive ainsi à des formules ubuesques du genre « les populations luddites étaient d’accord sur les nuisances des nouvelles technologies » : Antonius Blok, « Si j’avais un marteau… Luddisme et bris de machines », op. cit., p. 30. Sans doute l’auteur a-t-il discuté avec les populations en question pour connaître leurs motivations antitechnologiques, ou peut-être est-ce lui qui les a converties à ses propres vues.
(21). Au regard de ces éléments, voilà comment nous comprenons cette image. Métamorphosé en bordel, l’historicisme fait monter les clients un par un par des escaliers séparés, par l’intermédiaire, sans doute, de l’historien devenu mère maquerelle. Ainsi, les clients (Blanqui et ses disciples d’aujourd’hui) qui fréquentent les mêmes filles (à savoir les mêmes pratiques : l’insurrection, la conspiration, l’émeute) ne peuvent en aucun cas partager leurs expériences charnelles communes (encore faudrait-il nous expliquer en quoi le fait, pour deux clients d’un claque, de coucher l’un après l’autre avec une même pute constitue une expérience commune…).
Quelle alternative au triste lupanar de l’historicisme où triomphe la séparation ? Sans doute un bar à hôtesses où tous les clients se croisent en sirotant du champagne, un club échangiste, ou l’idéal hippie (fouriériste ?) de la communauté des désirs charnels, où tout le monde baise les mêmes pratiques en même temps.
(22). Ce vocable du despotisme technologique trouve une illustration récente dans le livre de Cédric Biagini, Guillaume Carnino, Celia Izoard, Pièces et main- d’œuvre, La Tyrannie technologique, Paris, L’Échappée, 2007.
(23). Par extension, on va prêter à l’ « anticapitalisme » une conception neutraliste de la technique, présupposant que telle « avancée » n’est pas mauvaise en soi, le problème étant l’usage qui en est fait, conception qui confinerait en fait à une fascination technicienne. L’ « anticapitalisme » est ici une espèce de bloc informe et indifférencié qui regrouperait le vilain Marx, le mouvement ouvrier du XIXe siècle, le capitalisme d’État soviétique, l’ultragauche, le syndicalisme réformiste et révolutionnaire, la SFIO, Mao, Krazucki, Althusser et Besancenot. Quel est ce qui relie malgré tout la gauche communiste antisyndicale et antistalinienne, les adorateurs de l’URSS et le syndicalisme réformiste ? Le programmatisme ? Non ! La technophilie ! Ici encore règne la plus complète confusion, savamment entretenue, pour jeter le bébé avec l’eau du bain, la savonnette et la baignoire. Il est certes de notoriété publique que le syndicalisme, par exemple en France, s’est converti au « machinisme » dans le seconde moitié du XIXe siècle, considérant en bon représentant du programmatisme ouvrier que les prolétaires pourraient grâce à la machine économiser leurs forces, réduire leur temps de travail et dominer le procès de production dans la société future du travail libéré… Mais le mouvement prolétarien, révolutionnaire ou autre, pétri de contradictions depuis 150 ans n’est pas, loin s’en faut, réductible à ces sottises.
Si l’on considère le communisme comme le mouvement réel qui abolit l’état des choses existant, que les anti-industriels se rassurent, il n’y a rien à sauver dans le capitalisme : pas plus les technologies, les usines que les chaînes de montage, pas davantage le travail artisanal émancipateur et autonome, pas plus l’État que la démocratie, directe ou non, pas plus les flics-êtres humains à qui on peut quand même parler que les chercheurs en sciences humaines.
(24). Dans un ordre d’idée proche même si distinct, John Zerzan transforme le luddisme en paradigme d’un mouvement révolutionnaire spontané ayant eu son organisation et son autonomie propres. Seuls les luddites auraient incarné la subversion ouvrière dans une forme épurée : Elements of Refusal, Columbia, Paleo Editions, 1999, pp. 105-112. Mais aucun mouvement, aucune révolte n’a jamais inauguré la lutte contre le capital ni incarné la quintessence réifiée de cette lutte, même si le syndicalisme est – évidemment – historiquement un vecteur d’encadrement et de neutralisation des pratiques quotidiennes offensives du prolétariat dans son ensemble. Nous préférions lorsque Zerzan, avant de plonger dans ses délires primitivistes, relatait, dans les années 1970, le conflit entre la « révolte contre le travail » des OS américains et les organisations syndicales.
(25). On trouvera une mise au point très claire de ces questions dans la revue Hic Salta 98.
(26). Karl Marx, Un chapitre inédit du capital, Paris, UGE 10/18, 1971, p. 191.
(27). Ce qui est maladroitement appelé parfois « révolution technologique » est ainsi d’abord et avant tout subordonné à une modification profonde des rapports sociaux entre prolétariat et classe capitaliste, elle-même liée à la transformation du travail et du capital. Comme on peut le lire dans la revue Hic Salta 98 déjà citée : « La technologie se nourrit de ce dont le travail vivant a été dépossédé et cette dépossession est la dynamique du rapport de subordination. Les transformations technologiques que le mode de production capitaliste fait subir au procès de production ne valent que par la déqualification qu’elles permettent de faire subir au travail vivant. »
(28). Dans l’Italie des années 1970 et 1980, cette appellation a pu être employée parmi les brigadistes pour désigner une tendance à lier revendications ouvrières classiques et action armée pour aboutir à un résultat qu’une lutte syndicale aurait pu atteindre par des moyens plus « classiques ». Ainsi en est-il par exemple de l’enlèvement en juin 1981 par la colonne milanaise des Brigades rouges (colonne Walter Alasia) du directeur de l’organisation du travail chez Alfa-Roméo, en exigeant l’abandon de la mise en chômage prévue de 500 ouvriers de la firme. Il est libéré au bout de 51 jours une fois cette revendication entendue. La ligne majoritaire BR-PCC dénonce dans des débats internes sur l’orientation stratégique de l’organisation le « syndicalisme » ou « réformisme armé » de la colonne.
(29). Eric J. Hobsbawm, « Les briseurs de machines », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 53-4 bis, supplément 2006, p. 16. Cet article est paru pour la première fois en anglais en février 1952 dans le premier numéro de la revue Past and Present.
(30). E.P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, op.cit., p. 513-514.
(31). C’est par exemple le cas de C. Calhoun, The Question of Class Struggle : Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution, Chicago, University of Chicago Press, 1982.
(32). La communauté, Gemeinschaft, où domine le principe de solidarité héritée entre des individus soudés dans un commun, partageant les mêmes valeurs, la même culture, s’oppose à la Gesellschaft, tissu informe d’individus égoïstes et isolés, traversée de part en part par la contradiction sociale.
(33). K. Sale, La Révolte luddite, op.cit., p. 238-239.
(34). Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir, Encyclopédie des Nuisances, 1998.
Les mauvais rêves des antitech
Lecture critique du livre Le Cauchemar de Don Quichotte, sur l’impuissance de la jeunesse d’aujourd’hui de Matthieu Amiech et Julien Mattern, Editions Climats.
—
Le titre est accrocheur : Le Cauchemar de Don Quichotte. On savait que Don Quichotte avait des fantaisies magnifiques et dérisoires qui faisaient de lui un héros étrange, à la fois puissant et impuissant : l’hypothèse qu’il faudrait les comprendre comme des « cauchemars » semblait annoncer une éclairante réinterprétation du mythe. Mais la citation de Chesterton mise en exergue nous déçoit aussitôt : dans notre monde moderne, les cauchemars de Don Quichotte se sont réalisés, « les moulins sont effectivement devenus des géants ». Double appauvrissement de la fiction : appauvrissement de la fiction de Cervantès, appauvrissement des fantaisies de son personnage, qui, si elles sont des cauchemars, ne sont certainement pas vides de sens au point de n’être que la manifestation d’un effroi latent devant les signes prémonitoires d’une future société nucléaire. Faire de Don Quichotte un apologue moralisant, même juste comme un clin d’œil vendeur qui justifie une chouette illustration de couverture (le chevalier à la triste figure face à une centrale nucléaire), inviter à lire – ou plutôt ne pas lire – Cervantès comme si c’était du sous-Orwell, c’est déjà mal commencer. Qu’à cela ne tienne, il ne s’agit pas d’un essai littéraire… Le sous-titre nous avait prévenus : c’est un essai sur l’impuissance de la jeunesse d’aujourd’hui.
Il y a 30 ou 40 ans, la jeunesse était puissante car révolutionnaire ; aujourd’hui, fascinée par la technologie, elle n’aspire qu’à l’irresponsabilité à laquelle tout l’invite, devient donc incivile, ne peut accéder à la culture que lui proposent ses profs parce qu’elle est gavée de jeux vidéos, n’a pas de métier et ne croit donc plus en l’avenir, se gargarise d’échanges planétaires alors que seuls les échanges locaux sont épanouissants. Dépolitisée et soumise, elle laisse la maîtrise de son destin et du monde aux machines qui, telles le Léthé, lui font boire à longs traits l’oubli des horreurs qui les accompagnent. Séduite par les sirènes du progrès, elle est incapable de voir qu’il ne lui facilite la vie que pour mieux dévorer sa dignité morale et saper ainsi les bases de la démocratie. Preuve : l’échec du mouvement contre la loi Fillon en 2003, clair symptôme de ce que « si la génération de nos parents a pu être qualifiée de lyrique, nous sommes tentés de dire de la nôtre qu’elle est perdue (à la fois paumée, et sans rôle historique positif) » (p.11, souligné par les auteurs). Amiech et Mattern se garderont bien cependant d’être à nouveau lyriques : « Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle, mais on a tout à fait le droit d’étudier les lois de l’hydraulique » (citation de Chesterton, p.7). Les lois de l’hydraulique que les jeunes d’aujourd’hui doivent étudier pour être moins paumés et regagner un rôle historique positif sont heureusement consignées dans de vieux livres. « Il nous semble impossible de penser le monde contemporain sans revenir à ces références (…) qui avaient été au moins en partie à la source des troubles de 1968 » (p. 11 toujours – le mot « troubles » est bien dans le texte…) ; ces références vont « de Nietzsche à Marcuse, en passant par Weber, Arendt, Schmitt, Heidegger, Anders, Ernst Bloch, Benjamin, Adorno, Horkheimer, etc. » (p. 138), à quoi il faut ajouter, pour la France, Simone Weil, Guy Debord, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Baudoin de Bodinat et d’autres. Hélas, au lieu d’étudier ces bons auteurs les jeunes d’aujourd’hui – du moins ceux qui lisent : ils sont bien peu, mais puisqu’on écrit un livre, c’est forcément à eux qu’on s’adresse – lisent des économistes et sociologues marxistes tels que Alain Accardo, Michel Husson ou Jean-Marie Harribey.
D’où le plan du livre : première partie, critique de ces mauvais auteurs ; deuxième partie, analyse des raisons pour lesquelles les jeunes d’aujourd’hui ne lisent plus les bons auteurs ; troisième partie, brève présentation de ceux-ci.
Ainsi, après avoir dans la première partie démystifié ceux qui croient pouvoir penser le monde contemporain sans les bonnes références, Amiech et Mattern montrent par l’exemple dans la deuxième comment le penser – et plus spécialement ce qui leur semble son problème numéro 1 : l’impuissance de la jeunesse ; enfin, ils nous livrent modestement et généreusement des indications sur ces références qui leur ont permis d’avoir une pensée critique si rare dans ce contexte de « grande amnésie » (titre de leur troisième partie).
S’agissant de gens que nous rencontrons dans les luttes, et qui, dans ces luttes, ne font pas toujours apparaître bien clairement leurs positions politiques, nous apprécions qu’ils considèrent qu’« il est important de prendre à certains moments du recul et d’essayer d’identifier les forces profondes qui travaillent la réalité et nous empêchent de nous en saisir pour la maîtriser (un peu) collectivement » (p.7). Même si les questions « comment identifier les forces profondes qui travaillent la réalité ? » et « comment maîtriser (un peu) la réalité collectivement ? » ne nous semblent pas, telles quelles, très bien posées, nous ne pouvons qu’encourager ceux qui les posent à se lancer sans fausse pudeur dans le rude travail de faire une « mise au point quant à la situation politique présente » afin de clarifier leur position.
Cette position, nous nous sommes demandés, un peu bêtement peut-être, quel nom lui donner. Amiech et Mattern indiquent en passant qu’on ne peut la comprendre si l’on tente de la situer « …sur un unique continuum, qui mènerait du conservatisme le plus obtus et le plus ringard au socialisme le plus radical donc nécessairement le plus collectiviste, en passant par le prétendu pragmatisme social-démocrate » (p. 53, note 50). Selon eux, si nous ne nous trompons pas, un même postulat présiderait à la fois à la hiérarchisation qui valorise le socialisme aux dépens du conservatisme, et à l’assimilation du conservatisme à la ringardise d’une part, du meilleur socialisme au collectivisme d’autre part : le postulat que l’accumulation capitaliste est bonne en tant qu’accumulation, mauvaise seulement en tant que capitaliste. Appelons cela le postulat moderniste de la gauche.
Le propos dominant d’Amiech et Mattern étant de s’attaquer à ce postulat, ils ne verront sans doute pas d’inconvénient à ce qu’on les qualifie d’antimodernistes (1). S’ils acceptaient de se situer quelque part sur le continuum qu’ils récusent, ce devrait être du côté des conservateurs : rappelons que ce continuum va du moins (conservateurs) au plus progressiste et moderniste (les socialistes « collectivistes »). Une partie de leur stratégie pour détruire le postulat moderniste de la gauche consiste d’ailleurs logiquement à s’opposer au regrettable dénigrement dont certaines pensées ouvertement conservatrices et réactionnaires sont, d’après eux, victimes (2). Certes, les termes de « conservateur » et de « réactionnaire » sont associés à la droite, et eux sont de gauche ; mais pourquoi ne pas oser frapper les esprits en s’affirmant réactionnaires ou conservateurs de gauche ? Sans doute parce que ces qualifications laisseraient mal deviner qu’ils ne sont pas seulement de gauche : ils sont aussi révolutionnaires. Ils soutiennent en effet que seule est souhaitable une « Grande Transformation d’une ampleur comparable » à celle par laquelle « un monde entièrement soumis à la science, à l’industrie et à l’utilité économique (…) est en train de s’accomplir définitivement sous nos yeux », « mais dans un sens très différent et à bien des égards inverse » (p. 174, souligné par eux). Seulement, cette grande transformation – pardon : cette Grande Transformation – ils ne veulent pas qu’on l’appelle une révolution : « Le terme même de ‘‘révolutionnaire’’ a tendance à parasiter les débats. Il est totalement déplacé, à l’heure actuelle, de penser qu’une transformation radicale, et radicalement positive – quelque chose comme ce qu’on a longtemps entendu par ‘‘une révolution’’ –, puisse avoir lieu dans un proche avenir. L’heure n’est donc pas vraiment de reprocher aux ‘‘forces de gauche’’ (…) de ne faire que de petits pas (…). Ce qui importe avant toute chose, c’est de savoir ce qui vaut la peine d’être défendu et ce qui vaut la peine d’être exigé, et de savoir au nom de quoi on l’exige. Autrement dit, c’est d’abord de savoir si les petits pas vont dans la bonne direction ou non » (p. 52, souligné par les auteurs). Résumons : Amiech et Mattern sont des Grands Transformateurs petipatistes antimodernistes de gauche.
Mais laissons là ces vaines questions d’étiquette, et pour indiquer en quoi notre position se distingue de la leur, disons que nous sommes d’accord avec eux pour récuser le postulat moderniste de la gauche, mais pour une tout autre raison. Leur raison, c’est que l’accumulation en tant que telle, loin d’être bonne, est en fait mauvaise. Notre raison à nous, c’est qu’on ne peut séparer dans l’accumulation capitaliste deux aspects – l’un par lequel elle pourrait être dite bonne, l’autre par lequel elle devrait être dite mauvaise. Amiech et Mattern partagent cette idée avec ceux qu’ils critiquent, à ceci près que là où ceux-ci considèrent que l’un des côtés est bon et l’autre mauvais, il faudrait dire que les deux côtés sont mauvais, et que celui que les modernistes de gauche trouvent bon est en fait pire que l’autre.
On l’a vu, Amiech et Mattern aiment bien donner des conseils de lecture : la troisième partie de leur livre est tout entière une sorte de bibliographie raisonnée qu’ils donneraient à des étudiants en première année d’antitechnologie. Qu’ils nous permettent d’y ajouter le chapitre II, § 1er de Misère de la philosophie, où Marx critique la « méthode des bons et des mauvais côtés » de Proudhon : on pourra y trouver aussi bien de quoi s’interroger sur ce qu’on pourrait appeler la méthode des mauvais et des mauvais côtés d’Amiech et Mattern, par laquelle ils séparent au sein du capitalisme le moins pire du pire. Le moins pire, ce qui vaut la peine d’être défendu, ce sont par exemple les économistes critiques (p.17), l’État social (p.53), les petites entreprises (p.54), les « bases locales de l’éducation » (p. 75), c’est-à-dire semble-t-il la famille – peut-être aussi les scouts, la paroisse ? –, l’instruction et la « culture » scolaires (p.75 aussi, curieusement : n’ont-elles pas toujours eu comme premier objectif de détruire l’éducation familiale et la culture locale ?), et même… le fétichisme de la marchandise, «dernier rempart à la violence latente» (p.168), et le libéralisme qui, « dans un univers toujours plus façonné par la quête infinie de richesse abstraite (…) sera toujours le parti de la vie – aussi dégradante et prédatrice soit-elle dans ce cadre » (p.169, souligné par les auteurs). Le pire, ce dont il faut s’éloigner le plus vite possible à petits pas, ce sont, outre la quête infinie de richesse abstraite, « les gains de productivité » (p.37), « la course folle à la compétitivité » (p.45), ou encore « la marchandisation » (p.47), « l’économie » (p.59) et même « l’Économie » (p.169), « l’abstraction monétaire » (p.166), – liste nullement exhaustive des divers synonymes d’une même entité dont Amiech et Mattern ne nous livrent pas le nom propre, mais osent écrire le nom commun : le diable (p.118).
À titre d’exemple, arrêtons-nous un moment sur cette dernière page. L’honnêteté intellectuelle nous oblige à préciser que le diable est nommé dans une phrase écrite sans doute partiellement au style indirect libre. Le mouvement qui aboutit à cette phrase n’en est pas moins exemplaire de l’usage débridé de la réification des catégories en entités magiques auquel conduit la méthode des mauvais et des pires côtés. Il clôt une longue diatribe contre Internet.
Après avoir montré qu’il était idiot d’utiliser contre certaines dominations, celle par exemple des multinationales, une arme dont l’usage renforce une domination première dont les multinationales ne sont que de secondaires et piètres servantes, Amiech et Mattern concluent : « Finalement, on ne peut penser sérieusement que le réseau des réseaux est une arme dans la lutte contre l’Empire du Mal (les Méchantes Multinationales)… » : ici, ces expressions sont clairement ironiques. Mais essayons de dire clairement ce que masque l’ironie : qu’est-ce qui ne va pas dans l’idée selon laquelle les multinationales seraient l’Empire du Mal ?
Eh bien, ce qui ne va pas, ce n’est pas l’idée paranoïde qu’il y a un Empire du Mal, qu’une entité surpuissante dont le nom s’écrit en majuscules complote obstinément contre nous. Non, ce qui ne va pas, c’est que cette entité est mal identifiée par les naïfs prosélytes d’Internet. Ils n’ont peut-être pas tort, après tout, de croire qu’Internet soit une arme contre les Méchantes Multinationales ; mais quoi qu’il en soit ils ont tort de croire que l’Empire du Mal soit les Méchantes Multinationales. Car, en fait, c’est la Méchante Économie. C’est ce que dit la phrase interrompue, que nous citons maintenant en entier (vive le copier-coller !) :
« Finalement, on ne peut penser sérieusement que le réseau des réseaux est une arme dans la lutte contre l’Empire du Mal (les Méchantes Multinationales) que parce qu’on refuse de voir qu’il est en premier lieu un moyen d’approfondissement de l’emprise de l’Economie sur l’existence quotidienne, jusqu’à un point qui était difficilement imaginable il y a à peine trente ans. » Deux phrases plus loin l’Empire du Mal devient celui du diable : ce refus de voir dans toute sa profondeur le mal que fait Internet est « lié (…) au refus d’admettre que le diable de l’économie automatisée ne pourra être ramené dans sa boîte que sur la base d’échanges majoritairement locaux » (souligné par les auteurs). Certes, un diable qui sort d’une boîte n’est le plus souvent qu’une effigie ridicule du grand Belzébuth. Mais c’est bien par reprise du propos ironiquement prêté à leurs adversaires qu’Amiech et Mattern parlent maintenant du diable. Or, on vient de le voir, l’ironie ne dénonçait pas l’idée qu’il y a un diable, mais celle que le diable, ce sont les multinationales ; décidément peu cohérents dans leurs métaphores, Amiech et Mattern parlent maintenant de leur Empire du Mal à eux, le vrai diable, qu’ils appellent ici l’ « économie automatisée »…
Posons franchement la question : sommes-nous, oui ou non, des modernistes ? Eh bien, qu’on nous pardonne cette réponse de normand : nous pouvons l’être, et nous pouvons ne pas l’être. Si vous tenez absolument à ce qu’on réponde par oui ou par non, la réponse sera oui ou non selon que vous vous adresserez à l’un ou à l’autre d’entre nous, et au même ou à la même mais à propos de différents cas. Prenons l’un des objets d’horrification favori d’Amiech et Mattern : le téléphone portable. Nous serions tous partie prenante d’une résistance au portable, et encore plus d’une lutte collective contre lui, en tant que dispositif de traçabilité des individus (3). Pour le reste, chacun a sa sensibilité… Concernant ce gadget en tant que moyen de communication, qui est le seul aspect sous lequel Amiech et Mattern l’exècrent, quelques-uns (minoritaires) parmi nous pourraient reprendre ce propos de Giorgio Agamben : « Vivant (…) dans un pays oùles gestes et les comportements des individus ont été refaçonnés de fond en comble par les téléphones portables, j’ai fini par nourrir une haine implacable pour ce dispositif qui a rendu les rapports entre les personnes encore plus abstraits. » (4) Mais, à part l’évident mais dérisoire refus d’en posséder un, que faire ? Agamben poursuit comme ceci : « Même si je me suis surpris à me demander plusieurs fois comment détruire ou désactiver les téléphones portables, je ne crois pas qu’on puisse trouver là la bonne solution. » Nous ne le croyons pas non plus, du moins pour l’instant. Compte tenu du fait que le procédé technique qui permet aux portables de communiquer entre eux est aussi celui qui permet de les localiser, nous nous surprenons parfois à nous dire que dans le cadre (qu’on excuse cet horrible mot) d’une guerre révolutionnaire il faudra peut-être se poser la question en ces termes. Mais nous n’en sommes pas là. Si l’on s’effraie de l’abstraction que produit le portable, on ne peut aujourd’hui que s’efforcer d’imaginer quelle véritable résistance pourrait lui être opposée. Le Cauchemar de Don Quichotte n’est d’aucune aide, mais Agamben non plus. Il explique que ce ne pourrait être un usage nouveau du portable, et il cherche lequel ce pourrait être en méditant sur la notion de profanation (5). C’est très intéressant, mais n’étant pas plus avancés que lui dans l’imagination de ce que serait une profanation du portable, ceux qui parmi nous supportent mal l’abstraction des rapports personnels que selon eux il induit en restent à ne pas l’utiliser, et à tenir autant que possible leur perception éveillée pour repérer d’éventuelles profanations qu’inventeraient des gens plus imaginatifs qu’eux. Voilà ! Tirez-en s’il vous plaît la conclusion qu’en ce qui concerne au moins le portable nous ne sommes pas tous modernistes. Mais, surtout, comprenez pourquoi nous ne faisons des éventuelles sensibilités antimodernistes des uns ou des autres ni l’occasion d’un jugement moral, ni le principe du choix de nos alliés ou de nos ennemis politiques.
Libre à vous de penser que nous sommes donc tous en fait d’affreux modernistes, puisque les plus antimodernistes d’entre nous ne le sont, et reconnaissent ne l’être, que par goût. Et alors ? Que vous importe le degré d’authenticité ou d’intensité de notre antimodernisme pour mener un combat politique avec nous ? Admettons que celle qui ne mange pas de viandes uniquement parce qu’il se trouve qu’aucune n’est à son goût n’est pas une authentique végétarienne : est-ce une raison pour ne pas s’asseoir à sa table ? Le combat, pour revenir à l’exemple des portables, contre le contrôle par traçabilité ne mériterait-il pas quelque compromission avec des modernistes tels que nous ? Si ce genre de compromission est au-delà de vos forces, dans quelles luttes allez-vous lutter ? Que dites-vous des luttes qui mettent en mouvement des gens qui ont dans leur vie ordinaire de tout autres goûts ou dégoûts que les vôtres ? Il n’y en a d’ailleurs pas d’autres – à moins de croire qu’on lutte en fréquentant les bars alternatifs et les épiceries bio.
Lorsqu’on lit la partie centrale de leur livre – intitulée Une génération perdue ? – on s’aperçoit qu’Amiech et Mattern ne se donnent et ne nous donnent pas du tout les moyens théoriques de mener une quelconque lutte commune avec les jeunes dont ils déplorent l’impuissance. Annoncer en sous-titre une réflexion sur l’impuissance de la jeunesse pouvait être prometteur : les luttes de novembre 2005 et du printemps 2006 ont confirmé chacune à sa manière qu’il est sans doute temps d’en parler. Mais selon Amiech et Mattern, on s’en souvient, il faut « expliquer pourquoi notre génération, lorsqu’elle sort de son apathie, se révèle à ce point réceptive à leur [les intellectuels modernistes de gauche] optimisme déplacé et à leurs fausses solutions » (p.73) : il nous semble, à la lumière de ces derniers mouvements, que le problème n’est pas bien cerné…
Surtout, leur explication de l’impuissance se résume comme ceci : la société est divisée en deux grands groupes, les jeunes et les vieux ; les jeunes sont soit apathiques, soit non apathiques ; les jeunes non apathiques sont soit modernistes de gauche, soit sans références ; seule une infime minorité des jeunes non apathiques a des références, mais même elle n’est pas totalement libérée du modernisme – en témoignent les auteurs eux-mêmes dans le poignant mea culpa qui clôt leur avant-propos (6). Où est l’explication annoncée ? Ce résumé partial (ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas objectif) le montre : nous ne l’avons pas trouvée… Il nous semble qu’elle se réduit à : « Notre génération, lorsqu’elle est sortie de son apathie, en 2003, s’est révélée réceptive à l’optimisme déplacé et aux fausses solutions des modernistes de gauche… parce qu’elle n’avait pas lu notre bouquin. » Lequel, il est vrai, n’était pas encore écrit. Pourtant, sa lecture ne suscite guère le désir de reprendre le combat. On y apprend avant tout que la nécessaire prise de conscience de l’horreur de la modernité implique celle qu’on n’a rien à faire ni avec les vieux, ni avec les jeunes apathiques, c’est-à-dire l’immense majorité d’entre eux. Il ne reste plus grand monde…
Permettez-nous quelques mots sur les vieux. Amiech et Mattern supposent constamment qu’il n’y a rien à espérer d’eux ; et comme ils s’adressent (donc) aux jeunes, dont ils supposent (donc ?) qu’eux aussi supposeront la même chose, ils n’en parlent tout simplement pas. Peut-être avons-nous été parfois un peu distraits, mais nous n’avons repéré que deux très brefs passages où il en était question. Premier passage : parlant du déplorable manque de reconnaissance des vertus du travail de la part des jeunes qui vivent dans des quartiers de relégation sociale, les auteurs leur trouvent quelques circonstances atténuantes : n’oublions pas, en effet, qu’ « ils subissent de plein fouet l’effondrement des structures familiales, redoublé par la détérioration des formes d’encadrement informel des enfants et des adolescents (personnes âgées sur le pas des portes ou sur les bancs…) » (p. 74). Deuxième passage : parlant des étudiants et des lycéens qui ont laissé tomber les profs, en 2003, comme de veilles chaussettes, alors pourtant qu’elles n’étaient heureusement pas si veilles que ça (7), cette remarque : « On comprend qu’ils refusent de songer même un instant à vieillir, à les voir si soumis et si résignés, bref si vieux dans leur tête. Ils acceptent la définition de la jeunesse que leur donne L’Oréal (ne pas avoir de rides)…» (p. 80, souligné par les auteurs). Après sondage, nous n’avons en effet trouvé que fort peu de jeunes sachant dire précisément à quel moment ils avaient, dernièrement, même un instant, songé à vieillir. Mais, avouons-le, nous n’avons pas su quel sens exact donner à la mise en italique de l’expression « vieillir dans sa tête » : indique-t-elle que les auteurs souhaitent montrer qu’ils n’utilisent pas eux-mêmes ce langage ? Disons-le franchement : nous n’avons pas pu convaincre nos vieux – vous a-t-on dit que nous en avions parmi nous ? – qu’ils devaient vous remercier de ne pas les définir par leurs rides ; ils nous ont répondu qu’il n’est guère plus agréable de l’être par le contenu forcément soumis et résigné de sa tête. Certes, entre le gardien d’un écomusée et les pièces qui y sont exposées la distinction est parfois difficile à faire. Par égard pour nos vieux, nous eussions cependant apprécié qu’Amiech et Mattern la fissent, d’autant que l’encadrement, même informel, des jeunes n’est pas leur fort. Mais place aux jeunes, puisque c’est d’eux qu’il s’agit dans ce livre.
Dans la description qu’ils font des jeunes apathiques, Amiech et Mattern ne font pas expressément usage de la notion de classes. Les classes s’y trouvent cependant, on va le voir. Suivons le paragraphe où sont présentées « des explications à la franche indifférence des étudiants – voire à leur sourde hostilité – envers les mouvements sociaux » (pp. 77-78). D’une part, « il y a ceux qui maîtrisent allégrement leur sujet et trustent depuis longtemps les premières places des filières les plus prestigieuses… ». Ils ont leurs raisons pour rester apathiques : « Ils ont tellement intériorisé le fonctionnement du champ universitaire qu’ils s’interdiront toujours de faire quoi que ce soit de compromettant pour leur carrière. » D’autre part, « à l’opposé, il y a tous ceux qui doivent travailler pour s’assurer une relative sécurité matérielle, et sont contraints de perdre leur temps et leur santé dans des boulots précaires et nuisibles, sans aucune garantie sociale. » Ceux-ci aussi sont apathiques. Pourquoi ? D’abord, parce que « cela [les boulots précaires dont il vient d’être question] ne les aide pas à sortir d’un rapport de dominé à dominant avec les professeurs et le savoir dispensé. » Eux ne s’interdisent rien. Ils ne sauraient s’interdire ce dont leur maîtrise du champ leur conseillerait judicieusement de s’abstenir, puisque précisément ils n’en ont aucune maîtrise. C’est leur appartenance sociale à la classe des travailleurs pauvres qui leur interdit quelque chose – ou du moins, mais c’est manifestement une litote, elle ne les aide pas : elle les empêche de sortir d’un rapport de dominés avec leurs professeurs et avec le savoir. Leur apathie s’explique par cette domination. Pourquoi être contraint au travail salarié fait-il de son rapport avec le savoir un « rapport de dominé à dominant » ? Pourquoi être dans un rapport de dominé avec le savoir entraîne-t-il l’apathie ? Est-ce parce que tout rapport de dominé à dominant entraîne nécessairement l’apathie ? Amiech et Mattern s’attendent curieusement à ce que nous comprenions sans avoir besoin d’explications supplémentaires, puisqu’ils n’en donnent pas. L’explication s’arrête là. Nous sommes censés admettre comme allant de soi que si nous maîtrisons le savoir universitaire, nous avons de trop bonnes raisons de nous complaire dans l’apathie pour, sauf héroïsme moral rare, ne pas y céder ; et que si nous ne le maîtrisons pas, nous sommes ipso facto plongés dans une apathie dont, encore une fois, seule une grâce exceptionnelle pourrait nous faire sortir. Il faut remarquer que les deux branches de la tenaille dans laquelle nous coince ce raisonnement n’exercent pas une contrainte de même nature : pour s’en dégager, dans le premier cas il suffirait de décider de ne pas céder à des raisons ; mais dans le second nous n’avons aucune raison d’être apathiques : nous le sommes au moins autant, mais nous le sommes pour des causes. Bref : aux bourgeois le libre arbitre, aux prolétaires le déterminisme social. Amiech et Mattern se proclament dans leur avant-propos « plus ‘‘sociologues’’ » que le « sociologue [sans guillemets, cette fois] bourdieusien engagé » Alain Accardo (pp. 9 et 8), mais ils ne nous offrent qu’un superbe exemple de ce que Bourdieu – excusez la référence – appelait une sociologie qui néglige la sociologie de sa sociologie. Ils s’annoncent aussi (dans la même phrase) « plus ‘‘matérialistes’’ » ; on aimerait leur demander dans quel passage. Ils affirment que « pour ceux-là [les étudiants travailleurs précaires] – et plus généralement pour la majorité des étudiants, préoccupés avant tout par les échéances scolaires et l’obtention des diplômes –, la focalisation sur les considérations matérielles rejette [NB : ce ne sont pas les étudiants, c’est la focalisation qui rejette] le plus souvent les questions politiques du côté des préoccupations ‘‘intellectuelles’’ et du ‘‘militantisme’’, qui sont dénigrés » (p. 78 toujours : cette phrase suit immédiatement celle sur les étudiants travailleurs dominés par les profs et le savoir). Leur matérialisme consiste-t-il à poser en axiome qu’un sujet qui a de préoccupantes « considérations matérielles » va nécessairement « dénigrer » tout ce qui est intellectuel ? Et que s’il dénigre l’intellectuel il est nécessairement soumis ? Aux bourgeois l’idéalisme tempéré par la carrière, aux prolos le matérialisme vulgaire intempérant : est-ce là le slogan de leur matérialisme subtil ? On les asticotait gentiment sur leur mépris d’une classe d’âge, dont nous nous contrefoutons ; mais sur le mépris de classe social, nous sommes tentés de passer à l’insulte. La suite (p.79) ne pouvant nous apaiser – « On atteint sans doute le comble de l’absurdité avec ces individus si désireux de paraître ‘‘dans le coup’’ qu’ils en viennent à se restreindre considérablement dans certains domaines vitaux (nourriture, logement, santé) pour pouvoir suivre le rythme insensé de la surenchère consommatrice, et que l’on retrouve régulièrement habillés à la dernière mode, équipés des toutes dernières trouvailles technologiques » –, donnons la parole à quelqu’un qui sait garder son calme, Jacques Rancière : « Il n’y a pas à s’étonner que les représentants de la passion consommatrice qui excitent la plus grande fureur de nos idéologues soient en général ceux dont la capacité de consommer est la plus limitée » (8): il n’y a pas à s’en étonner, car les idéologues dont il parle (Finkielkraut et autres) sont des conservateurs de droite. Mais on peut s’étonner que des conservateurs révolutionnaires de gauche ne s’en distinguent pas sur ce point.
Concluons : si un espoir reste permis, il ne peut venir que des rares jeunes miraculeusement non apathiques. La tâche de l’avant-garde étroite constituée par ceux qui ont des références est donc de conquérir autant que possible l’avant-garde large constituée par ceux qui, faute de références, sont séduits par l’antilibéralisme moderniste. Le terme d’ « avant-garde » est bien entendu absent du livre ; nous l’utilisons pour faire apparaître qu’à notre avis son explication du fait que la révolution espérée en 2003 n’a pas eu lieu ne se distingue guère de celle, par exemple, des trotskistes après 1968 : elle n’a pas eu lieu parce que le parti révolutionnaire n’était pas encore construit. Aux questions classiques des révolutionnaires – que penser des luttes partielles ? tout ce qui ne renverse pas le capitalisme ne finit-il pas par le renforcer ? – Amiech et Mattern répondent que les luttes qui ne renversent pas le capitalisme ne valent rien, sauf si elles font gagner un peu de conscience antimoderniste. Mais alors, que faire ? Que faire collectivement, ici et maintenant ? Il ne s’agit certes pas de construire un parti, encore moins un parti révolutionnaire, mais de construire… on ne sait pas.
Les questions, elles aussi classiques, des révolutionnaires sur l’organisation – parti, syndicat, collectif, mouvement – , Amiech et Mattern ne les posent jamais. Est-ce à dire qu’ils répondent qu’il n’y a pas à les poser ? On pourrait le croire. Car ils ne proposent finalement qu’une purification individuelle de son esprit par une ascèse anachorétique. Sans toutefois donner de conseils concrets bien précis. Eux qui aiment tant conseiller des lectures, ils ne renvoient curieusement pas aux textes prémodernes – bouddhiques, par exemple – où se recueillent des expériences, pourtant authentiques et ancestrales, ce qui devrait leur plaire, de la voie spirituelle qu’ils indiquent. Tout ce qu’on en apprend, à les lire, est que c’est à la fois d’une impérieuse nécessité et quasiment impossible. Quant aux institutions nouvelles qui permettraient de lutter collectivement contre cette impossibilité, Amiech et Mattern n’en suggèrent que fort peu, et du bout des lèvres. Nous ne leur reprocherons pas cette pauvreté d’imagination, étant nous-mêmes peu enclins à suivre ce genre de voies qui, prétendument alternatives au capitalisme, tendent dangereusement à devenir alternatives à la lutte contre le capitalisme. Signalons toutefois qu’à part sans doute des clubs de lecture, l’alternative suggérée semble se limiter à des ateliers de technologie parallèle pour « s’interroger au cas par cas sur les outils que met à notre disposition la société industrielle, en se demandant systématiquement lesquels peuvent faire l’objet d’une appropriation émancipatrice… » (p.134). Les lectrices et lecteurs intéressés sont prévenus que s’ils s’y rendent sapés autrement qu’en étudiant bohème ils risquent quelques sévères remontrances, surtout s’ils sont pauvres. Le port de chaussures fabriquées en Chine est toléré lors des premières séances, à condition de faire publiquement son autocritique. Précisons également qu’il sera inutile d’y amener sa mitraillette ; la question de ses éventuelles vertus émancipatrices est déjà résolue par cet imparable argument : « Penser que l’on affaiblit l’adversaire en utilisant l’arme que celui-ci a inventée pour affermir sa domination risque fort de conduire à d’amères désillusions » (p.110).
—-
(1). Cf. par exemple p.8 : « … les grèves du printemps 2003 [furent] à la fois encourageantes et désespérantes : quand la population secoue son joug de nos jours, ce n’est pas pour mettre en cause frontalement la société que produit la modernisation permanente impulsée par le capital depuis deux siècles » (souligné par nous).
(2). Cf. p.123 : « … il peut arriver que ce soient des gens un peu ‘‘étroits d’esprit’’, ‘‘naturellement’’ réticents à l’idée de collectivisation et inquiets devant le déchaînement technologique (…) ; bref, (…) des gens que l’électeur du PS ou des Verts parisiens considérera immanquablement comme ‘‘de droite’’, qui apportent la contribution la moins massive et la moins enthousiaste à cette évolution… » ; p.135, parlant de paysans « réticents » devant « les impératifs de la modernisation » de l’agriculture : « Leur réaction [souligné par les auteurs] aurait pu servir d’avertissement » ; p.146 : « Dans leur courageux essai Révolte et Mélancolie, M. Lowie et R. Sayre s’insurgent à juste titre contre les bonnes âmes qui disqualifient la critique romantique de la modernité… ». Last but not least : « quand Le Pen est le seul homme politique à ne pas craindre de se déclarer hostile à l’extension permanente des échanges internationaux, faut-il s’étonner que bien des ouvriers, victimes des délocalisations (inévitables dans la mesure où leurs entreprises produisaient pour le ‘‘marché mondial’’), succombent au vote ‘‘protestataire’’ (…) ? » (p.97).
(3). Cf. Le Monde du 30 juin 2007, article de Nathalie Brafman : « Les opérateurs sont techniquement capables de savoir d’où est émis un appel, où il est reçu, la durée et l’heure à laquelle a été passée la communication. » Ce n’est pas tout : « Même lorsqu’il est en veille, il est possible de localiser la puce d’un appareil ». Nathalie Brafman nous rassure aussitôt : « Mais ces informations sont utilisées en principe seulement en cas d’enquêtes policières », et la Cnil, heureusement, veille à ce que ce principe soit respecté. On apprend dans cet article que des chercheurs du MIT ont mis au point un procédé de « géolocalisation » qui leur a permis de compter des supporters de foot et de Madona. « Cette technique, ajoute la journaliste, permettrait aussi de régler les différends entre forces de l’ordre et organisateurs concernant le nombre de manifestants. » Gageons que, s’agissant d’une localisation en temps réel, elle permettra aussi de régler des différends d’un autre style entre forces de l’ordre et désorganisateurs…
(4). Qu’est-ce qu’un dispositif ?, éd. Rivages poche, 2007, p.34.
(5). Cf. également Profanations, éd. Rivages poche, 2006, pp. 95-122.
(6). « Nous recevons des subsides de l’État. Nous portons des chaussures fabriquées en Asie (…). Il nous arrive même de regarder avec plaisir des matches de football à la télévision » (p.12). D’où ce redoutable problème que négligent, paraît-il, les partisans de la décroissance : « Les projets de décroissance, s’ils veulent être pris au sérieux, et ne pas servir à un énième changement de façade de la domination moderne, doivent (…) ne pas cacher qu’ils impliquent de renoncer à certaines satisfactions (au profit d’autres) que nous donne cette mégamachine et auxquelles nous sommes habitués, voire attachés. » (p. 171)
(7). « Pourtant [souligné par nous] la lutte des enseignants a été lancée et animée par des profs assez jeunes… » (p.74).
(8). La Haine de la démocratie, La fabrique éditions, 2005, p. 35
À quoi ce cauchemar pourrait-il bien servir ?
Quelques compagnons anarchistes m’ont dit qu’ils trouvaient bon Le Cauchemar de Don Quichotte. À mon goût il n’est bon qu’à mettre aux cabinets. Ainsi va la vie ! Si nous n’avons rien de mieux à faire, nous discuterons peut-être un soir autour d’un bock de ce que j’aime et n’aime pas dans ce livre. Rien ne presse. Chacun ses goûts. On me dit aussi qu’Amiech et Mattern sont des compagnons de lutte, et sympathiques, intelligents (il se trouve que je ne les connais pas : notre petit milieu anticapitaliste et révolutionnaire, à Paris, n’est pas si petit). Admettons ! La lutte n’attend pas que nous écrivions tous de bons livres : c’est si difficile ! Quelque chose cependant m’inquiète : croiriez-vous que c’est un bon livre de lutte ? Je préfèrerais alors en parler tout de suite et sans bock. Je préfère publier ce texte.
Le coût des vies
Je voudrais essayer d’expliquer ce que j’appelle un bon livre de lutte, en prenant deux exemples. D’abord un livre antitechnologique : Le Coût de la vie, d’Arundhati Roy (1). Ce court texte fut publié en 1999 dans deux revues, peu après que Roy fut devenue romancière célèbre. Il s’inscrit expressément dans la lutte menée en Inde depuis le milieu des années 1980 contre une technologie, celle des grands barrages, en tant qu’intervention de cette lutte dans le champ médiatique, rendue possible par la célébrité de son auteure. En Inde, troisième constructeur mondial de grands barrages, quelque chose a changé dans l’opinion à leur sujet grâce à la lutte, commencée en 1986, de petits paysans de la vallée de la Narmada contre la construction du gigantesque barrage de Sardar Sarovar. En janvier 1991, notamment, date d’une longue, tenace et rude action, les médias ont fini par faire du sujet un sujet important, et depuis la politique des grands barrages est devenue objet de débats récurrents, un peu comme, en France, Saint-Bernard est venu perturber le consensus sur la politique de fermeture des frontières (2).
Roy commence par expliquer que la sortie médiatique de l’ombre fut certes en elle-même, et plus encore par ses répercussions, une importante victoire, mais que la façon dont la lutte apparut immédiatement et continue d’apparaître au public fut par contre une défaite.
Elle apparaît comme le dernier avatar d’une opposition structurelle depuis l’indépendance entre deux entités abstraites antagoniques : progrès industriel de la nation d’un côté (incarné symboliquement par Nehru), archaïsme artisanal des régions de l’autre (incarné symboliquement par Gandhi). Or, explique Roy, « pour les gens de la vallée, que les enjeux aient monté à ce point a eu pour effet, en raison de l’élargissement du débat autour des seuls ‘‘grands’’ problèmes, d’émousser leur arme la plus efficace : des faits précis concernant spécifiquement les problèmes de cette vallée en particulier, à l’exclusion de toute autre » (p.20). C’est précisément de cette arme, mais pas émoussée, que Roy entend faire usage dans et par son texte, à un moment crucial de la lutte (la Cour suprême vient d’autoriser la reprise des travaux). S’adressant à un public de classes moyennes urbaines et cultivées dont l’opinion s’est formée à partir des informations partiellement diffusées par les médias et de leurs commentaires, elle lui dit d’abord qu’il s’interdira de comprendre les enjeux de cette lutte tant que, comme l’y invitent les médias, il n’y voit qu’une « …guerre entre les forces progressistes modernes, rationnelles, du développement et une sorte de mouvement néo-luddite, caractérisé par une résistance irrationnelle à ce même développement … » (p.21). Lorsqu’on tombe sur cette phrase peu de temps après avoir lu Le Cauchemar de Don Quichotte, on est immanquablement frappé par une curieuse impression de déjà-vu. Le fait est qu’elle pourrait se trouver telle quelle dans Le Cauchemar, à l’exception toutefois des qualificatifs « rationnelles » et « irrationnelles ». En effet, ce sont exactement les termes – « forces progressistes modernes » contre « mouvement néo-luddite », « développement » contre « résistance à ce développement » – de l’antagonisme social et politique principal selon Amiech et Mattern. C’est à cette guerre qu’il est urgent d’après eux que nous participions activement,– dans le bon camp, bien entendu. Le Cauchemar de Don Quichotte est très parcimonieux en faits précis concernant des problèmes particuliers, et singulièrement en faits précis se rapportant aux problèmes particuliers posés par la lutte qui lui donna son impulsion : la lutte de 2003 contre la loi Fillon. Il est vrai qu’Amiech et Mattern n’ont aucune raison d’utiliser l’arme que Roy tient pour la plus efficace dans la lutte, puisqu’ils ne s’inscrivent plus dans cette lutte : ils adoptent au contraire une posture de juges, extérieurs et supérieurs à elle et à ses acteurs et actrices, en posant non pas la question de comment la poursuivre minoritairement alors qu’elle est en reflux, mais celle des raisons de son échec présumé définitif. Pour eux, d’ailleurs, les problèmes ne sont pas posés par la lutte, mais à l’occasion de la lutte ; on ne saurait s’étonner alors que celle-ci soit présentée comme la rencontre par une subjectivité encline aux vastes questions existentielles d’un événement qui la porte à réactiver l’interrogation socratique sur la valeur des différents genres de vie : « Pour tous ceux qui (…) n’entendent pas se résoudre à une soumission complète, ce conflit était à nouveau l’occasion de poser un certain nombre de problèmes fondamentaux, au premier rang desquels celui de savoir quelle sorte de vie nous voulons mener » (p.14). Roy, elle, suppose seulement que nous admettrons que personne ne souhaite être brutalement contraint à un genre de vie totalement nouveau que non seulement il ou elle n’a pas choisi, mais que personne ne choisirait : en l’occurrence une vie d’extrême misère dans les bidonvilles périurbains. Elle décrit donc minutieusement et sans pathos superflu la situation dans laquelle se trouvent les familles déjà expulsées du terrain qu’elles occupaient, mettant en œuvre ses talents d’écrivain pour faire franchir à ses lecteurs la distance qui les sépare des habitants de la vallée inondable, lesquels, en plus d’être paysans ou pêcheurs dans une région lointaine, ont le double défaut supplémentaire d’appartenir pour beaucoup à la plus basse caste et pour la plupart à une ethnie au moins aussi méprisée en Inde que les Tziganes chez nous. Mais il ne faut pas seulement faire percevoir que ces dalits (la caste en question, dite chez nous des « intouchables ») et ces adivasis (l’ethnie en question) sont des êtres humains, sensibles et rationnels. Leur mouvement, du moins lorsqu’il est emporté par les plus militants et les plus radicaux, tels ceux et celles qui ont fait l’action de janvier 1991, n’est pas pour une expulsion et un relogement décents ; il est pour l’arrêt immédiat de la construction du barrage et la destruction de ce qui est déjà construit.
Or, tout le monde sait que les dommages collatéraux sur les oeufs sont nécessaires à l’omelette, et qu’il y a des omelettes nécessaires au bien commun. Tout le monde voit – et si ces Adivasis étaient pleinement rationnels ils devraient le voir eux aussi – que lorsque les œufs, par malheur, sont des êtres humains, il n’y a hélas rien de mieux à faire que de limiter autant que possible les dommages qu’on leur inflige, bien entendu tout à fait à contre-coeur. Roy attaque cet argument sous différents angles, et le réfute toujours grâce à son arme : les faits précis, l’examen attentif et informé des questions que la lutte contraint à poser. Que coûte, financièrement, le barrage à l’État ? Combien de personnes sont-elles touchées par sa construction ? Combien en pâtiront-elles, combien en bénéficieront-elles ? En quoi consistent exactement ses avantages, s’il y en a ? S’ils sont à long terme, quel est le terme ?
Y a-t-il des investissements qui, à coût financier égal, apporteraient moins de dégâts à moins de gens ou plus d’avantages à plus de gens ? L’essentiel du livre est consacré à donner à ces questions les réponses qui montrent que le projet n’est pas raisonnable. Roy admet donc, lorsqu’elle s’en tient à cette ligne argumentative, qu’il pourrait être raisonnable si les réponses étaient différentes : si vraiment les besoins vitaux d’un très grand nombre de gens ne pouvaient être satisfaits qu’aux dépens d’un nombre significativement plus petit, alors oui le barrage serait un progrès et pourrait être justifié en tant que tel, aussi pharaonnique fût-il, aussi grands fussent les malheurs de ceux qu’il chasse de leurs terres.
Qu’on ne croie pas que je veuille reprocher à Amiech et Mattern de ne pas avoir admis un tel présupposé.
Moi non plus je ne voudrais pas écrire un livre qui l’admette sans recul, serait-ce même pour contrer l’adversaire. Roy ne l’admet d’ailleurs pas toujours. Elle dit à un moment : « Dans de telles circonstances, ne serait-ce qu’envisager un débat sur le relogement et la réadaptation, c’est bafouer les principes élémentaires de la justice. Transplanter 200 000 personnes de manière à donner (ou à prétendre donner) de l’eau potable à 40 millions : il y a quelque chose qui ne va pas dans l’énormité même de ces chiffres. C’est une arithmétique fasciste. Qui étouffe toutes les histoires. Ecrase le détail. Et réussit à aveugler les gens les plus raisonnables grâce à son éclat visionnaire mais totalement fallacieux » (p. 82). Le « dans de telles circonstances » et le « mais totalement fallacieux » ressortissent à la ligne principale d’argumentation ; mais la formule « arithmétique fasciste » détruit le fondement même de cette argumentation. Ici, Roy rejette d’emblée toute politique de gestion des populations : c’est l’attitude dont pour ma part je ne souhaite pas me départir. Cela dit, j’apprécie que d’autres, impliquées dans la lutte contre une politique, soient à l’occasion moins scrupuleuses que moi quant aux compromissions avec la politique en elle-même. Par exemple, L’Injustifiable, de Monique Chemillier-Gendreau, qui – selon une conception utilitariste de la rationalité tout à fait semblable à celle que Roy suppose dans son argumentation principale – montre l’irrationalité de la politique dite de fermeture des frontières, est selon moi un bon livre pour la lutte, même si son auteure est une militante que j’ai combattue lors de la lutte de Saint-Bernard, où elle prit une position débectable (elle appartenait au « collège des médiateurs ») en conformité à l’idée débectable que supposent le titre et tout le raisonnement de son livre, à savoir qu’une autre politique migratoire pourrait être justifiable. Me fais-je comprendre ? Je ne dis pas que le livre d’Amiech et Mattern est un mauvais livre pour la lutte parce qu’il n’est pas de la même veine que ceux de Roy ou Chemillier-Gendreau. Je dis seulement qu’il peut être bon de poser la question des armes. Et je ne vois pas comment on pourrait écrire un bon livre de lutte sans avoir une idée claire de quelle sorte d’arme on veut que ce livre soit dans cette lutte. Le combat de géants entre le froid Progrès rationnel – quantitatif, abstrait et déraciné – et la chaleureuse Vie sensible – qualitative, respectueuse des particularités et communautaire – est rarement la meilleure arme. Peut-être certains peuvent-ils en faire quelque chose d’intéressant, mais je ne connais pas beaucoup d’exemples. Weil ? – il paraît ; Heidegger ? – j’en suis convaincu ; Debord ? – sans doute. Amiech et Mattern savent qu’ils n’ont pas leur talent, mais ils ignorent, semble-t-il, qu’il faudrait l’avoir pour écrire un bon livre tout en restant constamment à ce haut degré d’abstraction – mais peu importe, je l’ai déjà dit : libre à chacun d’écrire de mauvais livres. Je veux juste montrer que le leur n’est pas un bon livre de lutte. Il ne l’est pas, en tout cas, à la façon de celui de Roy.
Le coût des vivres
Prenons maintenant une œuvre, cette fois, protechnologique : La Conquête du pain, de Pierre Kropotkine. Quel livre de lutte, celui-là ! Et de quelle lutte ! On est en France, en 1891 : non seulement, dit Kropotkine, tout le monde « sent la nécessité d’une révolution sociale », mais, à nouveau, 20 ans après la défaite de la Commune, « les riches comme les pauvres ne se dissimulent pas que cette révolution est proche, qu’elle peut éclater du jour au lendemain » (II, 2, p.33) (3). L’insurrection prochaine ne risque-t-elle pas de subir le même sort que la précédente ? Ce problème demande que l’on considère des faits précis (si précis que Kropotkine écrira quelques années plus tard, en anglais cette fois, Champs, usines et ateliers, qui traite du même problème et défend la même solution politique ; mais les faits ne sont plus exactement les mêmes alors, et ne sont pas exactement les mêmes à Londres qu’à Paris). Comme Roy, Kropotkine fourbit l’arme du problème bien posé et de la connaissance des faits précis. Mais pas dans la perspective d’une résistance : dans celle, autrement exaltante, d’une conquête. Le problème est de stratégie et de logistique. Je ne peux faire mieux que de citer presque entièrement les pages où Kropotkine le pose – pages lumineuses, questions des femmes et de la centralité du travail mises à part. À la lumière de 1792-93, 8 et la Commune, on peut déjà savoir ce qui se passera lorsque, après la débandade de leurs flics, les capitalistes et les politiques apeurés auront fui Paris :
« Des milliers d’hommes sont dans les rues et accourent le soir dans des clubs improvisés en se demandant : ‘‘que faire ?’’, discutant avec ardeur les affaires publiques. Tout le monde s’y intéresse ; les indifférents de la veille sont peut-être les plus zélés. Partout beaucoup de bonne volonté, un vif désir d’assurer la victoire. Les grands dévouements se produisent. Le peuple ne demande pas mieux que de marcher en avant. Tout cela c’est beau, c’est sublime. Mais ce n’est pas encore la révolution. Au contraire, c’est maintenant que va commencer la besogne du révolutionnaire.(…) Les socialistes gouvernementaux, les radicaux, les génies méconnus du journalisme, les orateurs à effets – bourgeois et ex-travailleurs – courront à l’Hôtel de Ville, aux ministères, prendre possession des fauteuils délaissés. Ils s’admireront dans les glaces ministérielles et s’étudieront à donner des ordres avec un air de gravité à la hauteur de leur nouvelle position (…) Élus ou acclamés, ils se rassembleront en parlements ou en Conseils de la Commune. Là, se rencontreront des hommes appartenant à dix, vingt écoles différentes qui ne sont pas des chapelles personnelles, comme on le dit souvent, mais qui répondent à des manières particulières de concevoir l’étendue, la portée, le devoir de la révolution. Alternativistes, anars, post-léninistes de la vraie gauche, autonomes, forcément réunis… [Pardon ! Kropotkine écrit en fait :] Possibilistes, collectivistes, radicaux, jacobins, blanquistes, forcément réunis, perdant leur temps à discuter. Les honnêtes gens se confondant avec les ambitieux qui ne rêvent que domination et méprisent la foule dont ils sont sortis. Tous arrivant avec des idées diamétralement opposées, forcés de conclure des alliances fictives pour constituer des majorités qui ne dureront qu’un jour ; se disputant, se traitant les uns les autres de réactionnaires, d’autoritaires, de coquins ; incapables de s’entendre sur des mesures sérieuses et entraînés à discutailler sur des bêtises ; ne parvenant à mettre au jour que des proclamations ronflantes ; tous se prenant au sérieux, tandis que la vraie force du mouvement sera dans la rue.Tout cela peut amuser ceux qui aiment le théâtre. Mais ce n’est pas encore la révolution ; il n’y a rien de fait !Pendant ce temps-là le peuple souffre. Les usines chôment, les ateliers sont fermés ; le commerce ne va pas. Le travailleur ne touche même plus le salaire minime qu’il touchait auparavant ; le prix des denrées monte !
Avec ce dévouement héroïque qui a toujours caractérisé le peuple et qui va au sublime lors des grandes époques, il patiente. (…) avec la bonhomie de la masse qui croit en ses meneurs, il attend que là-haut, à la Chambre, à l’Hôtel de Ville, au Comité de salut public – on s’occupe de lui.
Mais là-haut on pense à toutes sortes de choses, excepté aux souffrances de la foule. Lorsque la famine ronge la France en 1793 et compromet la révolution ; lorsque le peuple est réduit à la dernière misère, tandis que les Champs-Elysées sont sillonnés de phaétons superbes où les femmes étalent leurs parures luxueuses, Robespierre insiste devant les jacobins pour faire discuter son mémoire sur la Constitution anglaise ! Lorsque le travailleur souffre en 1848 de l’arrêt général de l’industrie, le Gouvernement provisoire et la Chambre disputaillent sur les pensions militaires et le travail des prisons, sans se demander de quoi vit le peuple pendant cette époque de crise. Et si l’on doit adresser un reproche à la Commune de Paris, née sous les canons des prussiens et ne durant que soixante-dix jours, c’est encore de ne pas avoir compris que la révolution communale ne pouvait triompher sans combattants bien nourris, et qu’avec trente sous par jour, on ne saurait à la fois se battre sur les remparts et entretenir sa famille. » (4)
Le problème est si bien posé que sa solution immédiate est évidente : la besogne du révolutionnaire, c’est l’expropriation des biens disponibles ; c’est de « prendre possession, au nom du peuple révolté, des dépôts de blé, des magasins qui regorgent de vêtements, des maisons habitables. »
« Faire en sorte que, dès le premier jour de la révolution, le travailleur sache qu’une ère nouvelle s’ouvre devant lui : que désormais personne ne sera forcé de coucher sous les ponts, à côté des palais ; de rester à jeun tant qu’il y aura de la nourriture ;
de grelotter de froid auprès des magasins de fourrures. Que tout soit à tous, en réalité comme en principe, et qu’enfin dans l’histoire il se produise une révolution qui songe aux besoins du peuple avant de lui faire la leçon sur ses devoirs. Ceci ne pourra s’accomplir par décrets, mais uniquement par la prise de possession immédiate, effective, de tout ce qui est nécessaire pour assurer la vie de tous. » (5)
Mais cela ne suffit pas. Après avoir soigneusement montré aux léninistes de son temps – celles et ceux qui feignent d’ignorer la capacité d’organisation spontanée d’un peuple en émeute permanente – qu’aucune des difficultés pratiques prétendument insurmontables (sans la dictature du parti) qu’ils opposent à cette solution n’est réelle, Kropotkine pose le seul problème qu’elle soulève vraiment, celui de sa durée :
« ‘‘Mais les vivres manqueront au bout d’un mois !’’ nous crient déjà les critiques. Tant mieux ! répondons-nous, cela prouvera que pour la première fois le prolétaire aura mangé à sa faim. Quant aux moyens de remplacer ce qui aura été consommé – c’est précisément cette question que nous allons aborder. » (6)
Nous sommes au premier quart du livre. Tout le reste est consacré à la question désormais posée : comment produire assez pour tenir ? Le problème de la mise à disposition des biens existants devient celui de la production de nouveaux biens. Kropotkine va montrer que la solution de ce second problème est en continuité avec la première : l’expropriation évitait les premières défaites militaires en réalisant la consommation immédiatement communiste ; ce qui permettra aux villes insurgées – y compris Paris, dont Kropotkine fait l’hypothèse qu’elle subirait un long état de siège – de remporter la victoire définitive, c’est la production immédiatement communiste. Le communisme n’est pas seulement possible, il est nécessaire. A la conquête du pain, le peuple se demandera par exemple si la terre des départements parisiens peut avoir rapidement une surface cultivable et un rendement suffisants pour leur population ; mais aussi, indissolublement, s’il faut, pour qu’elle les ait, instituer un procédé de contrainte au travail. Lisez si ça vous intéresse la rigoureuse démonstration à laquelle procède Kropotkine pour répondre « oui » à la première question et « non » à la seconde : le communisme n’est pas seulement possible et nécessaire, il est nécessairement anarchiste.
Ce qui m’intéresse ici n’est pas cette démonstration. Pour celles et ceux qui ont lu Amiech et Mattern et qui en gardent quelque souvenir, j’en extrais cependant ce bref passage, à titre d’exemple de la façon tout opposée dont, chez Kropotkine, se mêlent constamment les deux questions, se répondent science et jouissance, technique moderne et désaliénation, intensités productives et sentimentales :
« Les citoyens auront à se faire agriculteur. Non à la façon du paysan qui s’esquinte à la charrue pour recueillir à peine sa nourriture annuelle, mais en suivant les principes de l’agriculture intensive, maraîchère, appliquée en de vastes proportions au moyen des meilleures machines que l’homme a inventées, qu’il peut inventer. On cultivera, mais non comme la bête de somme du Cantal – le bijoutier du Temple s’y refuserait d’ailleurs – on réorganisera l’agriculture, non pas dans dix ans, mais sur-le-champ, au milieu des luttes révolutionnaires, sous peine de succomber devant l’ennemi. Il faudra le faire comme des êtres intelligents, en s’aidant du savoir, en s’organisant en bandes joyeuses comme celles qui remuaient, il y a cent ans, le Champ de Mars, pour la fête de la Fédération : travail plein de jouissances quand il ne se prolonge pas outre mesure, quand il est scientifiquement organisé, quand l’homme améliore et invente ses outils, et qu’il a conscience d’être un membre utile de la communauté. » (7)
Mais ce qui m’intéresse, c’est, je dirais, l’esprit dans lequel cette démonstration est faite. Kropotkine défend fermement la thèse de son « école », l’une de ces « vingt écoles différentes (…) qui répondent à des manières particulières de concevoir l’étendue, la portée, le devoir de la révolution ». C’est donc, si vous voulez, l’exposition d’un programme, en ce sens que c’est ce que cette école conçoit quant à ce que la révolution devra faire. Dans le cas de l’école anarchiste, sa manière particulière de concevoir est que nul n’est mieux en situation de définir ses « devoirs » que le peuple insurgé lui-même. Ce n’est donc un programme qu’au sens où c’est ce pour quoi les anarchistes agiront, ce qu’ils soutiendront dans les « clubs improvisés discutant des affaires publiques ». Ce ne l’est pas au sens où ce serait ce pour quoi ils intrigueraient dans les instances substitutives du pouvoir déchu. Mais d’autres écoles pourraient écrire d’autres livres dans le même esprit : je n’ai pris qu’un exemple. Roy est d’une autre école, elle écrit cependant dans un esprit semblable : poser des questions et diffuser un savoir qui ont été produits par un mouvement. La Conquête du pain est bien autre chose que le programme d’action qu’une élite éclairée définit selon sa philosophie du « devoir de la révolution ». Elle est l’un des produits actuels d’un mouvement – en l’occurrence : le mouvement ouvrier – au sein d’une certaine école qui en fait partie. Elle est avant tout l’un des moyens par lesquels cette école met en circulation le savoir et l’intelligence du mouvement qui sont les siens. Savoir et intelligence du mouvement : au sens où ce sont une intelligence et un savoir que le mouvement produit, chez Roy comme chez Kropotkine, mais aussi, chez ce dernier, au sens où ils ont ce même mouvement comme objet. Cela en prévision des questions qu’il se posera. Ces questions, l’école anarchiste suppose qu’elles seront – dans une certaine conjoncture prévisible justement grâce à l’expérience et à l’intelligence des luttes antérieures – des questions relatives à la conquête du pain : d’où la nécessité pour elle d’écrire La Conquête du pain.
On m’a compris : je ne dis pas que le Cauchemar est d’une autre école que la mienne. Je dis qu’il n’est d’aucune école, d’aucun mouvement. Je ne sais pas s’il est possible qu’un mouvement produise un jour une école antimoderniste digne de ce nom. Mais si le Cauchemar m’a servi à quelque chose, c’est à me rassurer sur ce point : il m’a démontré par l’exemple que ce jour funeste n’était pas encore advenu.
—-
(1). Je citerai la traduction de Claude Demanuelli, éd. Gallimard, coll. « Arcades », 1999.
(2). Soit dit en passant cette action, dont Roy fait le récit pp. 57-59, fut l’œuvre de 6000 militants déterminés, dont 7 grévistes de la faim. Autrement dit, il s’agissait d’une action minoritaire : minoritaire à l’échelle de l’Inde et du projet, qui menace de déplacer un demi-million de personnes, mais aussi à l’échelle du mouvement : un an plus tôt, une manifestation avait rassemblé 50 000 personnes. Or, c’est cette action qui a conduit au plus grand succès enregistré par
le mouvement : le retrait de la Banque mondiale, financière du projet, et la suspension des travaux. Toujours en passant, et toujours dans le but de nous ravigoter, nous autres amateurs d’actions minoritaires, j’ajouterai que celle-ci abandonna en 1995 un projet de barrage géant au Népal qui ne faisait pourtant l’objet d’aucune lutte sur les lieux ; et l’on y répète depuis lors dans les séminaires de formation internes ce slogan : « Don’t get zapped by the Narmada effect, do your EIAs [EIA signifie : Environmental Impact Assesment] ! » (Cf. Michael Goldman, Imperial Nature, Yale University Press, 2005, pp. 151-153).
(3). Le 1er nombre renvoie aux chapitres, le second aux alinéas numérotés à l’intérieur de chaque chapitre. Le numéro de page est celui de l’édition
(mauvaise… mais c’est celle que j’ai sous la main) des Éditions du Sextant, 2006.
(4). II, 2, pp. 35-37.
(5). Ibid., p. 38.
(6). V, 4, p. 87.
(7). XVI, 3, pp. 250-251.
Responsabilité et autonomie dans le catéchisme antitechnologie
Responsabilité et autonomie dans le catéchisme antitechnologie
Cette réflexion se fonde sur un certain nombre de textes : Le Cauchemar de Don Quichotte (1) en est une des sources principales, de même que les textes de l’Encyclopédie des Nuisances (EdN) et autres tracts de Pièces et Main-d’œuvre (PMO), du défunt Collectif universitaire d’agitation (CUL), de son descendant le Groupe Oblomoff, et de La Tyrannie technologique (2). Toutes ces démarches critiques ont des caractères communs et des différences. Nous nous intéresserons à ce qui constitue chez eux un propos plus ou moins cohérent, dont l’homogénéité est renforcée par leurs relations interpersonnelles et leur participation aux mêmes luttes : responsabilité, rapports humains et communauté, donc. Nous puiserons par ailleurs dans d’autres textes de l’antitechnologie avec lesquels ils ne sont sans doute pas en accord sur tous les points (3) mais qui nous éclaireront sur les mêmes sujets. Puisque les Critiques précédemment cités font par ailleurs la promotion de cette pensée, ils ne nous en voudront pas de les rapprocher d’une mouvance avec laquelle ils ont de nombreux points d’accord, certes, mais aussi des différences que nous marquerons quand cela nous semblera nécessaire (4).
Résumons. Tout discours « économiste » participe de l’idéologie technicienne. Toute réflexion qui centrerait la question de l’organisation de la production autour du vieux concept d’exploitation passerait à côté du problème : l’autonomisation du monde de la technique. Il conviendra donc ici d’éviter l’écueil de tomber dans le marxisme le plus plat et le discours vide sur la guerre des classes. D’abord parce que l’objet même de cette réflexion serait pris dans l’illusion qui détourne notre regard de la centralité du problème de la technique. Ensuite parce que la méthode elle-même porterait en germe un regard falsifié sur le monde : penser à partir de l’exploitation c’est d’ores et déjà se glisser dans le discours de l’ennemi, lui accorder de se battre sur son propre terrain, se voir contraint à partager ses présupposés « progressistes ».
En effet, comment croire encore que la lutte des classes soit une dynamique autre que celle de la reconduction du monde industriel et de l’idéologie du progrès ? Quand on constate que ceux qu’on appelait hier encore les prolétaires sont les premiers à « désirer » téléphones portables dernière génération, écrans plasma et autres gadgets high-tech ? La question des vrais besoins, de l’existence libérée, de la possibilité de prendre sa place dans « le mouvement bariolé de la vie » (Zerzan) ou de retrouver « l’ancien monde de la nature humanisée » (Encyclopédie des Nuisances) ne peut se poser en termes de lutte des classes, tant il est vrai que, tous, nous sommes soumis à l’idéologie industrielle.
Suivons donc leurs préceptes, ne tombons pas dans le piège : il s’agira ici de faire le moins possible d’analyses économiques. Nous tenterons au contraire de renouer avec d’anciennes méthodes, datant d’un temps moins artificialisé que le nôtre. Nous ne risquerons pas de perdre notre âme à ne pas considérer la technique comme un problème central et nous tenterons donc de nous poser une question purement éthique : quelles sont les « valeurs humaines », les « modes de vie », la « morale » que nous proposent, nous promettent (ou, mieux, nous permettent pour éviter l’usage risqué du futur), les discours antitechnologiques ? Nous esquiverons les problèmes absurdes du marxisme et des autres théories critiques dont on peut le rapprocher en nous rappelant que les faits sont avant tous des faits « moraux » . Ainsi, notre méthode sera-t-elle celles de ceux que l’on appelait « psychologues » ou « moralistes » au dix-septième siècle : à quels instincts, désirs et affects président donc les jugements, concepts et utopies de l’antitechnologie ? Vers quoi font signe les problèmes de « responsabilité individuelle et collective », de « valeurs » ou « rapports humains », de « communauté » ?
Contre les irresponsables
Nous avons exposé notre méthode, examinons la leur. Certains sont plus précautionneux que d’autres en ce domaine, notamment les auteurs du CDQ, puisqu’ils tiennent à préciser qu’ils n’entendent pas juger les gens et leurs opinions, faire preuve de manichéisme, ou prétendre à une quelconque pureté. La démarche est honorable mais la répétition de telles affirmations confrontée à l’épaisseur du texte nous ferait presque soupçonner qu’il s’agit avant tout de se dédouaner. Rien de mieux en effet que de mettre entre parenthèses un jugement de valeur par la dénégation qu’il s’agisse de cela (5).
Ainsi, leur démarche autocritique de l’introduction entend s’interdire toute position aristocratique. Avouer « regarder avec plaisir des matchs de football à la télévision », symbole exemplaire résumant à lui tout seul l’horreur de ce monde, est ainsi particulièrement courageux. Nos Critiques ne nient pas en effet leur culpabilité dans ce monde où la lutte contre le confort industriel nécessite un ascétisme crâne, « des efforts quasi héroïques » pour « vivre de la manière la plus autonome possible » par rapport à ce système hideux. Et de même : « la technologie » est un sujet « tabou suscitant immédiatement l’atrophie du jugement moral » (TT14), or nos contemporains sont « dépourvus d’armature morale » (TT18).
Mais qui peut donc être un héros dans ce monde où nous sommes tous coupables ? On serait tenté de répondre : personne – mais ce serait nier que si nous sommes tous « responsables » de l’horreur technologique, nous ne le sommes pas tous de la même manière. Il y a des héros, qui agissent, qui essaient de s’en sortir qui, au moins, ont conscience de la faute et de l’effort nécessaire, du péché et de la tâche à accomplir.
Car cette soumission aux impératifs du monde moderne n’est pas qu’un sort subi, elle nécessite notre participation consciente : CDQ l’affirme, leur traité pourrait s’appeler De notre servitude volontaire car le rapport que nous entretenons avec le système est celui « d’une adhésion enthousiaste » au « confort industriel moderne » . « Tout le monde » a donc une « part active » dans la « dégradation du monde » (TT18). Le fait même de ne pas agir contre le monde industriel, de ne pas au moins le dénoncer, est constitutif de la faute : le « désengagement » est en effet un engagement : on participe « activement au cours présent des choses en travaillant et en consommant » (CDQ78).
Ainsi, « tout le monde fait de la politique, même sans le savoir, notamment en acceptant que la vie quotidienne soit de plus en plus façonnée par la fuite en avant des besoins artificiels et illusoires. Chacun entérine ainsi la très réelle destruction de la nature et des sociétés humaines qui est son corollaire inévitable » . Ce sont eux qui soulignent : en effet, un des modes essentiels de notre collaboration avec ce monde est l’action passive d’acceptation, l’auto-aveuglement « volontaire » face à la « responsabilité » que nous avons dans son existence et son renforcement. Le « même sans le savoir » est ce qui articule notre culpabilité : car nous ne pouvons pas ne pas voir le monde dans lequel nous vivons et que notre mode de vie est cause de ce monde , par la volonté de ne pas voir, nous le cautionnons, le construisons, le consolidons (6). En effet, pour préserver notre « confort mental », et par une terrible « paresse », nous préférons ne pas voir l’évidence, nous nous comportons comme des enfants gâtés mais dont la satisfaction des caprices provoque l’existence d’un monde diabolique, voire chez l’EdN ne provoquera rien de moins que la destruction du monde. Majesté de la critique que de dévoiler que les comportements les plus anodins ont les conséquences les plus monstrueuses : qu’importe que l’essentiel de la pollution par exemple soit le résultat de stratégies industrielles et agricoles sur lesquelles nous ne décidons pas de fait, en recentrant le problème de la production sur celui de la consommation c’est notre comportement qui est la cause en soi de l’apocalypse technologique – nous décidons de consommer, donc on produit pour nous satisfaire. On nous dit par ailleurs que nous sommes soumis à la pub, dans une grande confusion post-situationniste de la plus belle espèce qui arrive à tenir à la fois la dictature totalitaire de la réclame et notre consentement volontaire à ses injonctions.
Mais passons, pour essayer de comprendre comment fonctionne notre irresponsabilité consumériste. Elle s’articule en fait sur une pseudo-dialectique entre la conscience du crime et le confort de s’y laisser entraîner :
« Car c’est chaque fois de manière à nous dispenser de savoir exactement ce que l’on fait, d’en avoir la pleine intelligence ; en nous fournissant le confort de n’avoir pas à être entièrement conscients de nos actes et d’en éprouver les déterminations contraires: de n’avoir pas, en quelque sorte, à être là en personne. C’est toujours une infantilisation, que ce soit par le voyage instantané en avion ou le paiement avec une carte de crédit, le récepteur d’image à domicile ou la lecture assistée par ordinateur ; par la contraception hormonale ou l’accouchement de confort sous péridurale. »
EdN, Remarques sur l’agriculture génétiquement modifiée et la dégradation des espèces.
« Du matin au soir, nous vivons perpétuellement entourés d’objets techniques de plus en plus sophistiqués. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à établir avec eux des relations d’automatisme, sans réfléchir aux conséquences de nos habitudes. En démarrant sa voiture, qui pense à la pollution qu’elle rejette ? En allumant la télévision, qui se soucie de ses effets psychiques ? En achetant un ordinateur, qui réfléchit à son devenir une fois usagé ? La publicité est la première à occulter les questions morales et politiques que soulève la technologie. »
Les Argumentocs, Les Renseignements généreux, octobre 2006.
« Mais ils refusent de l’envisager de manière frontale, d’y réfléchir posément et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, pour s’épargner la peine d’avoir à formuler une condamnation morale de leur propre rôle dans cette société. Ce malaise laisse entrevoir la possibilité d’une révolte de ceux qui, parmi eux, auraient conservé un sens moral assez sain. »
Un chercheur « dissident » de Sauvons la recherche, à propos de ses collègues, sur le site de l’OCL.
« Peut être que tu as cette réaction, car il est trop difficile pour toi de te remettre en question, de remettre en question ton rapport à la consommation, à la machine, et en fait sortir de tes petites habitudes. C’est difficile de se poser des questions qui remettent en cause son mode de vie et ce qu’on considère comme acquis. »
Commentaire d’une réponse « pro-machine » à un texte antitechnologique sur Internet (7).
Ne pas savoir ce que l’on fait est permis par le « confort » que nous offre le monde technicien. Ce confort nous permet de ne pas éprouver les « déterminations contraires », c’est-à-dire les conséquences de nos actes : nous nous laissons donc, par pur goût de la jouissance, retomber en enfance, être complètement à la merci du système. Toutes ces citations partagent le même vocabulaire, celui de la responsabilité et le même thème, celui de la faute morale. Ils partagent aussi une position de surplomb, un désir de faire la leçon à ceux qui se laissent embrigader par le confort. La question est de fait « qui se soucie des conséquences à part nous ? ». Les antitechnologie sont les seuls capables de « remettre en question » le confort du mode de vie contemporain. Ne pas avoir de portable est ainsi un exploit moral, une résistance héroïque confrontée à la moquerie des contemporains (8).
Évidemment, cette posture de supériorité morale n’est pas exclusive : elle laisse l’occasion à celui qui aura le « courage » d’ouvrir les yeux et « l’héroïsme » de renoncer à la jouissance de reconnaître son erreur et de les rejoindre. Il est possible à tous de développer « une conscience plus claire (forcément douloureuse) » d’être des salauds qui bossent pour le pouvoir (CDQ127) et, une fois purifié par le passage de la culpabilité et de la souffrance morale, de se convertir à la pureté – comme dans toutes les religions !
Mais quelle est cette responsabilité dont on nous parle ? Il y a des « avantages » au système nous l’avons vu. Or, « dans chacun de nos gestes de la vie quotidienne, pour répondre à chacun de nos besoins, nous déclenchons (ou nous utilisons) des processus auxquels nous ne pensons pas ». Nous n’avons en effet pas conscience de nos actes, plus encore, nous profitons « volontairement », avec plaisir, de « l’exonération de nos responsabilités ». Nous participons donc tous d’une « irresponsabilité courante de la vie moderne » (CDQ 84-86) : d’une part, nous sommes tous responsables du monde horrible que nous façonnons, d’autre part nous récusons cette responsabilité grâce au confort que nous offre ledit monde (9). Or, « chaque fois que vous passez un coup de fil sur votre portable, vous jouez avec la santé des habitants du Grésivaudan, avec la vie des Congolais et celle des derniers grands singes de la planète » nous disent Pièces et main-d’œuvre (10).
Mais les « médiations technologiques » ont le pouvoir « d’éloigner » les nuisances, c’est-à-dire la prochaine fin du monde et l’horreur de l’exploitation du Tiers-monde.
Le rapport aux marchandises est ainsi décrit dans les termes de la dépendance, de l’accroc, du drogué, du malade…
le technologisme est une maladie morale. On notera que le problème n’est jamais l’exploitation mais bien que nous puissions nous éloigner de cette conséquence déplaisante de notre mode de vie par le confort satisfait.
Or, « le prix de notre confort » est un concept de petit-bourgeois qui vit en effet confortablement dans ce monde. L’écrasante majorité de ce qu’on appelait autrefois prolétariat (désolé du gros mot) est « consciente » de vivre dans ce monde comme exploitée. Son problème n’est pas d’être « éloignée » de ces réalités sordides mais d’y être directement confrontée. Il s’agit ici d’une éthique pour petits-bourgeois dont la conscience de l’horreur du monde est celle de la téléprésence, celles de spectateurs des conséquences forcément lointaines, mais bien trop proches dans leur spectacle, de leur confort : le malheur des pauvres du tiers-monde, le futur comme catastrophe inévitable. Curieusement, il n’y a là rien de présent, d’intime, à condamner, il s’agit toujours d’un ailleurs. La seule présence à cette situation de nos pourfendeurs du système est la conscience malheureuse et l’identification impossible au prolétariat (11). Ils n’ont pas d’expérience du monde !
Tout est ramené à la consommation, d’où l’anti-économisme : les machines produisent et se consomment. On consomme, donc on produit.
D’un côté donc, la simple consommation est un acte coupable (CDQ 79), de l’autre, la plupart des antitechnologie avouent ne pas pouvoir ne pas y participer. Ce qui fait la différence c’est le supplément de conscience coupable qui dédouane et excuse. D’autres, moins radicaux, posent un « on n’a pas le choix » dans un monde tel que le nôtre, parodiant certains marxistes (qui, s’ils sont opposés au salariat n’en admettent pas moins qu’ils sont obligés de travailler ou de squatter/voler et partant d’être « de ce monde »), mais en oubliant que, contrairement à la nécessité matérielle de vivre dans un monde réglé par le travail, s’il ne s’agit que d’une manière de vivre, d’un impératif moral à tenir pour ne pas être coupable, personne ne les oblige à diffuser leurs textes sur Internet. La cohérence pensée/action impossible est déverrouillée par une magouille purement rhétorique : « Pourquoi voudriez-vous nous interdire de parler ?», ou « On sait qu’on ne peut pas battre l’ennemi avec ses armes mais bon », certains allant jusqu’à une sorte de calcul rationnel des moyens et effets où la conscientisation équilibre la « nuisance » d’utiliser un média maléfique – une sorte de comptabilité des bonnes et mauvaises actions, soutenue par l’excuse de la conscience du problème moral, bref, la culpabilité.
Critique qui se veut non « aristocratique » (12). Les auteurs du CDQ identifient ainsi la « pensée de gauche » à la « réduction des inégalités » . Fort heureusement, nous ne sommes pas de gauche et les prolétaires en lutte eux non plus : ils ne cherchent pas l’égalité dans le confort mais luttent contre leur condition d’exploités. Mais comme s’ils bénéficiaient tous du niveau de confort de nos écrivains le monde courrait à sa perte, il est urgent qu’ils cessent de réclamer des sous ou du temps libre aux dépens de plus prolétaires qu’eux. La question ne se pose que dans une urgence réformiste : comment faire les « petits pas » qui nous permettront à tous d’être pauvres ?
Malheureusement, seuls nos rebelles en lutte contre les machines sont conscients et responsables de leurs actes. C’est que leur volonté doit être plus forte ou plus pure que la nôtre qui refusons de voir les conséquences de nos vies confortables. Voilà en effet la nécessité du caractère « volontaire » de la soumission confortable au Mal : se poser en donneurs de leçons, en héros, en juges de leurs contemporains. Et de s’offusquer que « l’idée de responsabilité tend à devenir une notion purement juridique », dès lors, il n’est pas étonnant que « prospèrent » les « comportements de voyou et de casse-cou » dont la seule réponse du système (quelle autre pourrait-il donner ?) est le « renforcement du contrôle social » . Voilà qui est ironique. Passons sur la dénonciation des « voyous », nous y reviendrons plus tard. Mais c’est faire preuve d’une drôle d’inconséquence que de penser que l’apologie de la « responsabilité » peut mener à autre chose que son recyclage juridique et pénitentiaire… La responsabilité et le justicialisme fonctionnent sur le même présupposé, sur le même désir, sur le même besoin : punir.
Il faut un en effet une « liberté » comme « pouvoir moral » et conscience des « limites » (TT38), un « libre arbitre » (13), il faut rendre l’humanité « responsable » pour pouvoir la « punir » et la « juger » : « La doctrine de la volonté a été inventée afin de punir, c’est-à-dire avec l’intention de trouver un coupable. » C’est une « invention » de prêtre. Les hommes ont été considérés comme « libres » pour pouvoir être jugés et punis – pour pouvoir être coupables. Monde moral, péché, peine… Confession, aveu, rhétorique des circonstances atténuantes avec supplément de questionnement moral. Se reconnaître comme coupable. Ressentiment et ascétisme. Passion de la condamnation, de la dénonciation, du « tu dois » . L’au-delà, le passé idéal, comme outil pour salir le présent, voire le futur – il s’agit bien là d’une morale de prêtres, d’une « métaphysique du bourreau » .
Cette volonté de punir va en effet jusqu’au délire le plus complet : l’amalgame des scientifiques actuels avec les scientifiques travaillant pour les nazis. L’agitation de l’épouvantail moral est ici particulièrement dégueulasse eu égard à la réalité de ce que fut l’hitlérisme :
« La banalité du mal
Dans Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, Hannah Arendt explique que la déportation et l’extermination des juifs se faisaient avec des gens pas forcément méchants. Ils faisaient juste leur travail. Le chauffeur de locomotive faisait juste son travail. L’aiguilleur faisait juste son travail. Comme le médecin, l’intendant, le fonctionnaire, etc. Et au final, il y a eu des millions de morts.
Ce qui est frappant, c’est qu’au procès de Nuremberg, il y avait des absents : les savants allemands qui avaient collaboré avec Hitler, nazis ou non. Ils avaient collaboré parce qu’Hitler leur donnait des moyens, des laboratoires, de la main-d’œuvre, des cobayes, de la matière première, etc. Pourquoi est-ce qu’ils n’étaient pas dans le box des accusés ? Parce qu’ils avaient été exfiltrés. Les Russes en avaient pris une partie, les Américains aussi, et même les Français ont exfiltré quelques savants allemands qui les ont aidés pour le programme spatial français. Au final, tout se passe comme si les scientifiques n’étaient jamais redevables des crimes qu’ils aident à commettre. Il serait temps qu’ils répondent de leurs actes au lieu de se défausser perpétuellement sur la société ou les élus. Avant d’être scientifiques, ils sont avant tout des êtres humains.
Les Renseignements généreux (inspiré d’une intervention du groupe PMO lors d’une soirée sur le puçage des animaux et des humains, Grenoble, 04/2006).
« La qualité du travail moderne, en entreprise comme en laboratoire referme les personnes sur leur petit domaine d’activité, sur leur vision du monde, – dans ces deux casernes, la pensée vise le résultat. L’objectif global de l’entreprise, par exemple la conception et la réalisation de missiles, n’est porté que par la minorité qui met en commun les différents résultats. Untel affirmera être en charge du téléguidage, un autre du fuselage, un autre du transport des matériaux dans les différents sites de production, passant sous secret l’essentiel de sa participation. L’organisation en réseau qui s’est développée corrélativement à la sophistication technologique est un puissant vecteur de cette déresponsabilisation.
Culture d’entreprise, culture scientifique, vases communicants entre eux-mêmes, vases clos sur eux-mêmes. L’enfermement mental du travail moderne mène en effet à la déresponsabilisation de l’activité du travailleur, ou du chercheur… Arendt, Anders, Dejours, on ne rappellera pas ici leurs analyses du cas Eichmann, parce qu’on n’a pas la place et puis on les connaît pas personnellement, mais il paraît qu’ils auraient parlé de ça…».
Une fraction de conScience du CUL (Comité universitaire de libération).
Valeurs humaines et besoins naturels : la famille et le travail
Et ces gens entendent nous donner des leçons de vie, nous apprendre quelles sont les vraies valeurs à respecter. La valeur de la responsabilité comme nous l’avons vu, mais celle-ci est avant tout une prescription d’état de conscience, une disposition morale, mais la conscience souffrante et culpabilisée n’est pas suffisante à guider seule nos conduites : il lui faut en effet son corollaire, la « maîtrise » .
Nos antitechnologie sont en effet des êtres terrifiés, leur monde tourne entièrement autour de son anéantissement : c’est à partir de leur propre débilité,
de leur propre « impuissance » (14) qu’ils théorisent et jugent. Le monde est ainsi « hostile » parce que « incontrôlable et incommensurable » , « incompréhensible, immaîtrisable, irrécupérable. » « La pensée se délite » (TT25) face au monde technologisé. Les antitechnologie tiennent en abjection toute « interdépendance » (autre que celle de la famille nous verrons), tout « processus qui les dépassent » (CDQ 83-84). Bien sûr, nous ne saurons pas exactement ce qu’il y a d’affreux dans ce dépassement, comment il fonctionne effectivement. On pourrait penser que c’est le simple fait d’être dépassé qui est affreux. Confronté à la « surenchère informationnelle » sur Internet le cerveau ne peut plus tenir. On part vraiment de l’impuissance et de la débandade, de la terreur du monde, de la débilité.
Internet et la télé font « venir le monde » à nous au lieu qu’on y aille. Les spectateurs sont choqués par les conséquences de leurs actes et l’hideuse altérité, ils expérimentent un « déphasage », une « déstructuration de notre rapport à l’espace et au temps » (15). Bruxelles et Marseille sont dans la banlieue parisienne ; « l’automatisation complète des portes » dans les trains n’inquiète personne : la liberté, la maîtrise, c’est de pouvoir tourner la poignée soi-même ?
Internet est d’ailleurs une des têtes les plus monstrueuses de l’hydre. Le problème de « l’irresponsabilité individuelle » sur Internet est terrifiant, les « normes comportementales » qui s’y jouent sont affreuses. Il y a une « communication » entre les hommes qui « ne les engage à rien » . Les sites de drague sont horribles parce qu’ils sont virtuels, avant il fallait aller en boîte pour serrer, c’était mieux. Oui, aller aux putes en vrai, c’est mieux, c’est plus humain que se branler sur Internet : on se sent coupable quand on rentre chez sa femme. A moins qu’il ne faille revenir aux mariages arrangées ? Mais non, la rencontre romantique a toujours été l’idéal. La littérature le prouve, lisez Manon Lescot ou Les Souffrances du jeune Werther.
« Les vertus morales sur lesquelles la société est fondée » ne se jouent en effet que dans la quotidienneté. Les rapports humains (qui ne sont plus comme avant) sont un des grands problèmes des antitechnologie.
Au quotidien justement, ce sont des airs outrés dès qu’un mot est prononcé plus haut que l’autre, ou que quelque chose comme un désaccord puisse se discuter vivement. Puis des procès en « mauvais rapports humains », de préférence à distance, comme dans le texte de dissolution autoproclamée du collectif parisien contre la biométrie.
Les auteurs du CDQ font ainsi l’apologie de la politesse et de la civilité, c’est-à-dire de valeurs purement policières (au dix-huitième siècle « pacifier » et « policer » sont des impératifs étatiques fondamentaux : pour l’État, même la bourgeoisie communale est trop « sale », « agitée » et « frondeuse »)(16).
Or, les anciens « liens sociaux locaux », sans lesquels les comportements « décents » relèvent « de l’héroïsme moral » ont disparu. Les auteurs de La Tyrannie technologique déplorent quant à eux « la disparition des rythmes de vie, des structures familiales et communautaires et des mythes qui leurs étaient associés » (21) et, avec Baudrillard, l’horreur de vivre « sans structure sociale profonde, sans système ordonné de relations et de valeurs » (98).
Or sur Internet, on n’est pas « obligé de laisser toutes ses qualités morales à la porte » mais ces qualités ne viennent pas d’Internet lui-même. Quand la « situation réelle », quant à elle, nous « empêche » d’en arriver à des « extrémités » telles que des « insultes » , sur Internet au contraire « une insulte ne coûte de toutes façons pas grand chose » – la « discussion de bistrot » permet en effet « sur le long terme » la possibilité que les méchants racistes par exemple aient à « rendre compte de leurs propos » … En les dénonçant aux flics ? (TT135). Face à de telles affirmations, on a envie de dire : quel est le rapport avec le shmilblick ? Ce n’est pas parce que se promener en montagne n’impose pas de ne pas jeter ses papiers gras par terre que la randonnée est horrible ? De plus, nos Critiques semblent penser qu’un système (coercitif ?) peut forger une bonne moralité des individus.
Ce n’est pas parce qu’une médiation ne nous apporte pas le contrôle social qui va avec qu’elle est négative, si ? « Internet ne provoque pas un comportement moral », allons jusqu’au bout : le reproche consiste en fait à sous-entendre qu’Internet est à la limite de les provoquer, ces comportements immoraux.
Et pourquoi donc ? A cause de l’anonymat et de l’impunité : on a beau jeu de critiquer la société de la transparence (TT) si c’est pour s’offusquer par ailleurs que les gens ne déclinent pas leur identité et ne soient pas punis s’ils insultent quelqu’un. Eh quoi ? Dans la « vraie vie » les gens se parlent bien ? Allez, dites-le : en tout cas ils le devraient !
Il faut donc des médiations à la moraline, avec du contrôle social humaniste, comme au bon vieux temps du contrôle social villageois (nous y reviendrons). Il faut des normes et des traditions pour ne pas se comporter comme un porc. Contrôlez-moi gentiment ou je serais un cochon. Horrifié par sa propre déchéance morale, qu’il sent en lui, l’antitechnologie, ce grand malade, est avide de dignité morale, nécessaire pour supporter son propre aspect au nom de la justice. Ils veulent que justice soit faite, que tous souffrent avec eux. Voilà d’où vient l’impératif de la maîtrise : de la certitude intime chez nos Critiques que leurs propres pulsions sont mauvaises, qu’ils sont eux-mêmes des porcs, leur volonté d’ascétisme vient de ce qu’ils savent qu’ils sont trop faibles pour vivre de manière « décente » sans qu’on les y force.
Car, on le sait, c’était mieux avant, avant les machines et le virtuel : « Y a plus de sincérité dans les choses.
Merde on peu pas tout dire à travers un sms, encore moins à travers un écran… (…) j’suis une victime de cette fichue société. J’ai un ordi, un portable … je sais pas pourquoi je me permets de dire ça. Peut-être parce que finalement c’est un peu pour faire comme tout le monde qu’on veut avoir tout ça… » (un internaute… sur un blog de Skyrock).
De même : « Je ne suis pas vieux j’ai 20 ans mais il y a 10 ans c’était tout différent et l’amitié y était plus forte j’en suis sûr sans les sms sans internet sans les skyblogs ! ! »
(un blogueur).
Que l’échelle soit variable, de l’homo habilis jusqu’à il y a dix ans, est moins important que l’évidence massive et jamais discutée que c’était mieux avant, qu’on avait de vrais rapports humains, etc. C’est la forme « technologie » qui transforme les rapports sociaux en rapports virtuels détestables. En effet, dans « l’échange marchand » sans trop de technologie « subsiste forcément » une « part d’humanité » (CDQ113). Il faut défendre les épiciers culturels tels que les libraires et les disquaires qui, contrairement aux sales prolos qui produisent de la merde, vendent de l’art qui sent la rose – et des disques artisanaux ou des livres recopiés à la main (TT36) ? C’est absurde ! Le rapport humain qui distingue le flic de la caméra de vidéosurveillance c’est l’immédiateté du coup de matraque dans la gueule ! Et il faudra encore qu’on nous explique d’où sortent ces vrais rapports humains résiduels malgré le totalitarisme technologique, le caractère « irrécupérable » du monde (EdN) et le fait que tous les gens soient des connards volontairement soumis au système ? Sauf les commerçants ? Comment, si tout le monde est un connard volontairement soumis au système ? Comment peut-on tenir à la fois que tout dans l’Économie est médié par les machines, ou dans le Système par l’Économie, et le fait que ce rapport constitue notre humanité ? Mais quelles sont ces valeurs humaines dont on nous rebat les oreilles ? C’est quoi cette « part » d’humanité dans la vente ? Où est-elle définie, discutée, comparée à l’artificialité contemporaine ?
Les seules réponses à ces questions sont l’apologie des anciennes sociétés, qu’elles soient préhistoriques chez Zerzan, pour qui avec le langage c’est déjà le début de la fin, ou qu’elles soient dans le Doubs il y a un siècle dans CDQ… Ce retour à un passé fictif, en le débarrassant de ses « dominations » réelles est la seule présentation positive d’une vraie nature humaine. Cette nostalgie partielle relève systématiquement de la fiction révisionniste. On pourrait leur accorder le loisir de piocher dans le passé pour ressusciter un Moyen Âge sans droit de cuissage. Cependant, pourquoi le détail de ces bonnes relations humaines n’est-il jamais détaillé ?
C’est que le passé fonctionne comme consolation, c’est un arrière-monde indémontrable : on nous parle souvent des valeurs humaines authentiques, on ne nous dit jamais lesquelles et comment elles s’articuleraient (à part le gimmick de « sans argent, sans économie » dont on pourrait demander quel est le rapport avec les machines ?). Ces vrais rapports humains ne sont ni définis, ni remis en cause. Ni discutés, ni discutables (ils sont en effets naturels). Ils étaient donc idéaux sans les machines ? Mais pourquoi ne nous dit-on jamais comment ? Les évidences massives du bien passé servent essentiellement à démontrer la présence du Diable. Le passé où les gens se parlaient vraiment n’est qu’un avatar du monde des idées, c’est le paradis perdu et promis des chrétiens, c’est une vengeance contre le présent.
Cette naturalité des bonnes valeurs humaines indiscutables est cependant déclinée sous les modalités du travail et de la famille. La minutie fait ici aussi cruellement défaut mais le fatras discursif idéologique est bien développé, laissant voir en creux certaines valeurs bien précises. Les « vertus » du citoyen idéal permettent en effet selon Lash (La Révolte des élites, cité dans CDQ43) d’acquérir des « habitudes démocratiques » : « autonomie et confiance en soi, responsabilité, initiative » grâce à la chance « d’exercer un métier ou la gestion d’un bien de petite taille ». Le « contrôle ouvrier sur les moyens de production » est synonyme de l’« acquisition des vertus civiques ». L’exercice du métier, comme forme de la maîtrise, est de même central dans les textes de l’EdN. L’artisanat permet en effet une autonomie des individus et leur garantit la possibilité de subvenir à leurs propres besoins naturels sans être à la merci du système. Or, dans le cadre de la société contemporaine « la satisfaction du travail accompli n’est bien souvent plus qu’une absence de honte, un soulagement de n’avoir pas – pour l’instant – failli ». Nos deux Critiques conspuent ainsi le « mythe de l’abondance », celui de la société « sans travail, sans effort et sans douleur ». Ainsi, la « perte d’autonomie » égale la « dépossession » et la « déqualification » : « la fierté qui accompagne la possession de savoir-faire propre » disparaît chez le bon travailleur, les beaux objets du passé et la « satisfaction et la patience qui leur étaient associés » sont devenus lettre morte. Une note de bas de page précise même qu’il ne s’agit pas de faire l’apologie du bon vieux temps : non, c’est faire l’apologie de la valeur travail, c’est partager avec les patrons la nostalgie du temps où les ouvriers étaient fiers de leur boulot (17). Vive le nouveau Stakhanov antitechnologie !
La discipline par le travail, voilà qui est intéressant mais une question nous brûle les lèvres : en miroir des « valeurs » nous venons de voir apparaître les « besoins » – lesquels ? Encore une fois, le flou est une méthode bien efficace, à moins qu’ils ne s’en remettent à notre seul bon sens ? La deuxième lame du rasoir d’Occam de la critique radicale est celle de la famille. « L’effondrement des structures familiales, redoublé par la détérioration des formes d’encadrement informel des enfants et des adolescents (personnes âgées sur le pas des portes, boutiquiers des rues commerçantes, voisins) » est une catastrophe (CDQ74). Nous reviendrons sur ce bon vieux contrôle social communal qui nous manque tellement. Notons juste pour l’instant qu’il est rare de voir de jeunes gauchistes faire preuve d’une forclusion machiste aussi flagrante.
« Certain-e-s » voient la marque de la « domination phallocrate » partout mais force est de constater que, pour autant que notre époque ne serait pas celle d’un féminisme réalisé il faut reconnaître que la belle époque de nos Critiques est, du point de vue des femmes, sans doute difficile à trouver si formidable que ça. Rappelons la condamnation de la pilule et de l’accouchement de confort par l’EdN.
Ainsi, quand la fondation Copernic propose de salarier le travail domestique des femmes, qui est pour l’heure gratuit, nos Critiques sont pris d’horreur : c’est la « suppression de toute gratuité » (CDQ56-57), la « soumission de la pensée de gauche aux catégories capitalistes du travail et de la richesse » . Une critique du revenu au nom de l’autonomie, du refus de l’accaparement par le contrôle social des richesses que nous créons « spontanément » et « gratuitement », l’affirmation que le fichage étatique est pire que la spontanéité des relations sociales dans la famille ou le couple, voilà qui est original. Nous ne tomberons pas dans des analyses économiques qui les ennuieraient sur la reproduction de la force de travail mais soyons sérieux un instant : en quoi, si le système technicien envahit notre quotidien, la sphère de la famille en serait-elle épargnée ? Le mythe de la société pour la société, de la vie privée comme dernier refuge de la liberté est pathétique (18).
Mais ne soyons pas mesquins, il est au moins un féministe au royaume des opposants à l’horreur technologique : Zerzan. En effet, « la disparition des grandes canines chez le mâle étaye fortement la thèse selon laquelle la femelle de l’espèce aurait opéré une sélection en faveur des mâles sociables et partageurs » … Comme tout bon religieux, Zerzan est finaliste : les canines courtes marquent un caractère doux, avoir les dents longues empêche d’être sociable et partageur. Bien. En tout cas, la « lutte des sexes » est ici bien présente : les femmes ont carrément le pouvoir de faire évoluer l’espèce grâce à leur cul !
Mais passons, pour tenter de récapituler un petit peu où nous en sommes. Pas très loin malheureusement. On sait qu’il existe de vrais rapports humains et de vraies valeurs humaines mais tout cela reste assez flou. Tout au plus sait-on qu’il faut regretter le bon vieux temps où l’on était fier de son métier et aimer les efforts et la douleur qui vont avec, qu’il faut être poli, sociable, partageur, qu’il faut avoir confiance en soi, être responsables, avoir le sens de l’initiative et respecter sa famille. On ne nous dit bien sûr pas en quoi ces « valeurs civiques » sont différentes de celles d’il y a un siècle, mais soit. Ceux d’entre vous qui ont eu le bonheur d’aller dans une école catholique ou simplement d’avoir expérimenté un instituteur vraiment républicain auront reconnu sans mal ce chapelet de prescriptions morales. Dans le Doubs, il y avait aussi l’instituteur et le curé : la grande nouveauté de nos nihilistes c’est de s’installer dans le négatif du jugement moral pour réenchanter le vieux monde du contrôle social chrétien, avec comme monde-vérité non plus l’au-delà du paradis promis mais le bond en avant vers un passé. Comme pour tout nihiliste, leur état de nature est une fiction floue, mais ici c’est une fiction du passé (19).
Le vrai homme naturel d’avant la technique et son cortège de nuisances, c’est en effet le chrétien ! On nous invite même à plutôt critiquer la technologie que l’Église : « Une fausse critique du phénomène religieux vise à faire croire que c’est dans l’immédiateté de la vie quotidienne que le sens des choses existe » (TT137). Il est certes « tout à fait possible de douter des paradis célestes » mais, bon…
Merci de votre permission et bravo pour l’arnaque rhétorique : en accolant « immédiateté » à « vie quotidienne », ce qui est loin d’être évident, vous arrivez à critiquer la méchante rapidité technologique mais aussi la vie, tout simplement. Et si ce n’est pas la vie qui donne « sens » aux choses, c’est bien un au-delà, un au-dessus : pas forcément le paradis chrétien mais bien le paradis prétechnologique. Les vraies valeurs humaines qu’ils regrettent donc sont la famille et le curé ! L’alternative c’est la fin du monde ou le nanisme, devenir aussi petits qu’eux. Leur pensée impuissante part en effet de la négation de tout ce que le désir peut porter de grand, la dénonciation de l’impuissance de la jeunesse est un désir d’impuissance. Se poser la question d’affects et de pulsions agencées de manière différente ne leur vient pas à l’esprit : il faut, pour sauver le monde et se sauver, se rapetisser. Il faut apprivoiser l’homme, limiter ses désirs, tuer ses passions. À partir de leur instinct en soutane ils condamnent le monde et leur conception de la maîtrise est de l’ordre de l’amputation : les anciens voulaient maîtriser leurs affects puissants, ils veulent que ces affects soient affaiblis, mesurés par leur minuscule concept de nature. Or, la nature qu’ils appellent de leurs vœux n’est ni égalitaire, ni douce, elle est terrible. Mais ils veulent la maîtriser, les modernes, les cartésiens. La nature n’est pas morale, n’est responsable de rien ! Il leur faut un abêtissement de l’homme pour que celui-ci se retrouve enfin à la place de Dieu, qu’il soit un « père juste et bon » .
Ce qu’ils appellent de leurs vœux c’est le vieil art du contrôle des conduites, transmis de la religion, du prêtre-pâtre, à l’État biopolitique. S’agit-il d’inventer de nouvelles formes de contrôle de soi, dans la communauté humanisée et naturalisée ? Certes, mais systématiquement en référence au passé. L’autonomie n’est pas un avenir mais toujours un paradis perdu mythique, qui n’avait pourtant rien de paradisiaque. Pourquoi donc cet acharnement à s’inspirer de l’autonomie passée, s’agit-il d’un simple manque d’invention ? La question de nouveaux rapports sociaux ne se pose même jamais, tout ce qui est nouveau est mauvais.
Leur homme idéal est donc un homme purement fictif et cette vérité de l’homme à atteindre, en tant qu’elle est la nature humaine passée moins la domination, est encore une nouvelle tentative d’amélioreurs de l’humanité. Il s’agit simplement de corriger les conduites, de se poser la question du contrôle : comment gérer les hommes ?
Le malheur de nos prophètes (de nos « préphètes » ?), c’est de ne pas voir que leurs valeurs sont constituées pour moitié de christianisme et pour moitié de fétichisation de modes d’assujettissement purement modernes dont l’invocation répétée de l’homme est le symptôme le plus criant. Homme, valeurs humaines, individus, autant de problématiques dont l’invention est consubstantielle à la modernité qu’ils critiquent, autant de concepts qui sont produits par le monde et les dispositifs de contrôle qu’ils entendent combattre (20) !
Communauté et autonomie
L’utopie antitechnologie est certes rétrospective mais c’est bien une utopie : on entend nous prescrire comment vivre. Ce qui manque en effet le plus à la contestation d’aujourd’hui, c’est d’avoir « un idéal à opposer » à la « domination » . Il s’agit donc d’organiser des espaces où les « vraies valeurs » puissent se vivre, où les individus soient « autonomes » (21) et puissent assouvir leurs « vrais besoins » (22). Rien de bien nouveau sous le soleil, c’est la prétention de l’alternative depuis trente ans que de se faire un petit bout de monde libéré.
« Nos collaborations avec le système sont multiples, comme nos dépendances. Certains y participent plus que d’autres. Certains, aujourd’hui, tentent de s’en sortir, de construire des savoirs autonomes, des savoirs pour eux, des savoirs correspondant à leurs goûts, à leurs désirs pratiques. Quand certains continuent à construire leurs sciences, leurs techniques, leurs jobs sans autre projet que de poursuivre, détruisant ce monde par leur adhésion aveugle à des mondes désen-sibilisants, d’autres tentent de fonder sur la base de sensibilités communes et de projets partagés des formes de vie et de connaissances qui, pour une fois, ne seraient pas séparés de leurs désirs éthiques et politiques. »
Une fraction de conScience du CUL
« Le monde actuel ne connaît pas d’en-dehors, on ne peut pas espérer le fuir. Il faut donc patiemment y constituer des milieux de vie où l’on puisse produire ses moyens de subsistance sans le concours de la machinerie industrielle, et où émergent de nouveaux rapports humains, dégagés d’elle. »
Appel de Raspail
« Le diable de l’économie autonomisée [peut être exorcisé] sur la base d’échanges majoritairement locaux, fondés sur des liens qui ne relèvent pas seulement ou pas principalement de l’intérêt économique. »
Le Cauchemar de Don Quichotte
On notera tout de même cette originalité de certains antitechnologie parisiens : celle d’accepter enfin qu’il n’y ait pas d’en dehors du monde actuel. Les promoteurs de l’alternative pensent en effet souvent qu’il est possible de vivre dans un autre monde que celui de ce qu’ils appellent la « domination » . Ainsi, le journal de Longo Maï prétend-il « laisser le salariat à ceux que ça intéresse », ce à quoi nous ne pouvons que souscrire : le jour où un juge voudra nous condamner, il nous suffira de lui répondre que nous préférons laisser la prison « à ceux que ça intéresse » (sic). Reste cette volonté de construire un contre-monde dont le fait qu’il soit en dehors ou pas n’est pas pertinent puisqu’il se constitue effectivement comme pseudo-extériorité. Il s’agit toujours de prétendre que l’on pourrait vivre différemment et que cette vie soit en elle-même porteuse de subversion.
« Comment rêver d’une société de sujets libres et soucieux du bien commun, tant que chacun est dépendant au quotidien, de par ses besoins les plus banals, d’une immense machinerie technologique et sociale ? » . En effet, il s’agit d’inventer des formes de vie quotidienne maîtrisée, d’organiser une production à petite échelle, etc. Ce qu’on ne comprend pas c’est en quoi ce mode de vie peut être libéré des « dominations » du système. Il faudra ensuite nous expliquer comment il lui nuira ?
Car, si le préalable à l’autonomie c’est l’absence du système, ça ne marche pas à moins de penser qu’on peut s’organiser un coin où l’on en soit effectivement libéré. Il est donc possible de se débarrasser par un acte de volonté des faux besoins que nous impose le système pour vivre une vie plus juste et plus pure ? Cette magie de la volonté qui rabat tous les problèmes sur la seule éthique est cohérente : il existe ici et maintenant quelques « héros » dont l’ascétisme leur permet de se libérer tout seuls, d’un trait de plume. En quoi cette libération est une indépendance quant au système n’est jamais explicité : ce n’est pas parce qu’on vit dans son trou que l’on n’est pas en rapport avec le reste du monde. Prétendre ne plus en être responsable est dès lors le comble de l’irresponsabilité : l’horrible système est en effet la condition de possibilité de l’alternative – il faut des maisons à squatter, des marchandises à voler, une bonne démocratie occidentale pollueuse et esclavagiste pour ne pas se faire tirer dessus par la police.
Prétendre se libérer de l’économie en cultivant son jardin et en volant des tomates si nécessaire est ridicule. Produire en fonction de ses « vrais besoins » dans des rapports « libérés de l’argent et de l’économie » est une arnaque. On voit mal en quoi la passion de l’usage des alternativiste a quoi que ce soit de menaçant pour le monde qu’ils condamnent. La valeur d’usage est un truc de publicitaire : l’encouragement à s’approprier des marchandises qui correspondent à tel ou tel usage ou besoin. Un usage libéré des choses ne peut pas exister dans un monde capitaliste. Premièrement, on ne peut trier les « besoins » par de simples critères moraux (à moins de réduire les besoins à manger, boire, dormir et chier) : les besoins sont socialement construits et prétendre pouvoir identifier les « vrais » des « faux », les « bons » des « mauvais », dans un monde qui est de plus soi-disant « irrécupérable », relève de la mauvaise foi ou de la prétention à posséder des super pouvoirs ou des méthodes thaumaturgiques de déprise du monde. Ensuite, penser que la production autonome est un bon moyen de résoudre la question est délirant. Il faudra encore qu’ils nous expliquent en quoi cela est une menace pour l’ordre établi.
Mais revenons à leur construction, qu’entendent-ils exactement par communauté ? La disparition de la « communauté » pose des problèmes de « responsabilité morale », de « dépendance », de « perte de maîtrise » …La communauté doit permettre des « liens humains qui ne se réduisent pas à la conjonction momentanée (23) d’intérêts individuels (qu’ils soient purement marchands, ou de type ‘‘affinitaire’’) » (la communauté durable, donc ?). Leur pensée communautaire est donc une « critique de l’interdépendance (24) et de l’irresponsabilité généralisées » . Certes, avouent-ils à demi-mot, il arrive que certaines communautés engendrent des « rapports de domination », mais il s’agit de simples contingences. À quoi sont-elles donc dues ? Aux rapports sociaux informés par la vie dans le capitalisme ? Non, ou plutôt oui mais en tant que les membres desdites communautés ne sont pas capables de s’en abstraire. Il s’agit donc de vivre avec des individus de qualité. Des gens vertueux. Mais, nous dit-on, la preuve que les communautés sont subversives c’est qu’elles suscitent une hystérie anti-communautaire, le fait qu’elle soit dénoncée montre que la communauté est une « dangereuse utopie » . Ah bon… et l’hystérie contre la vaccination au dix-huitième siècle, ça prouvait que la vaccination était dangereuse pour l’État ?
Un peu de bon sens, leurs communautés ne font peur à personne, si leurs squats sont expulsés ce n’est pas parce que l’État tremble de ses genoux cagneux en constatant la présence subversive de potagers mais parce qu’il y a des propriétaires, qu’il existe un truc qui s’appelle la propriété privée.
Un peu d’histoire donc pour prouver qu’ils ont raison. Dans le Doubs, au dix-neuvième siècle, on vit à la limite de l’aisance. Il est étonnant de voir à quel point nos anti-économistes sont fascinés par l’économie de subsistance, comme si elle réglait tous les problèmes d’un coup, comme si les rapports sociaux dépendaient effectivement de l’organisation de la production (horrible marxisme archaïque) mais qu’au bon vieux temps, cette organisation se soit révélée supérieure à celle des temps présents. Les rapports sociaux sont-ils donc réglés par les rapports de production ? Si oui, en quoi le modèle passé est-il réactualisable, en quoi est-il meilleur à part en tant qu’il ne pollue pas la planète (ce qui est discutable, leurs camarades plus ou moins primitivistes leur dirait que le dix-huitième c’est déjà foutu et que ça colle des maladies à tout le monde) ? C’est que le localisme, l’autocontrôle, la maîtrise sont des valeurs essentiellement morales. Ce sont des valeurs authentiquement humaines, non dénaturées par les machines qui séparent l’homme de son effort, de son travail, de sa douleur… Ne résistons pas à la tentation de continuer avec le Doubs. On apprend dans la longue citation qu’ils en font que les utopiques producteurs étaient capables d’augmenter les rendements, de sélectionner le bétail et les semences, d’accroître le territoire, pardon, le terroir (CDQ97-98). Malheureusement, cette croissance harmonieuse a été vaincue par les envahisseurs capitalistes, elle n’a pas du tout participé à sa constitution. Si on les avait laissés tranquilles, nos paysans se seraient autolimités à temps (en noyant les enfants ?). Ils auraient fait perdurer « une société juste et humaine » .
Mais si vivre ensemble n’est pas en soi subversif il faudra bien montrer que c’est la condition de possibilité de la contestation : elle permet certes de s’organiser pour aller draguer dans les luttes. La positivité des mouvements sociaux est en effet de permettre une « émergence de communauté de lutte » . C’est donc le « vivre ensemble » qui permet l’action « subversive », tarte à la crème affinitaire qui étend la confiance minimale nécessaire à l’organisation d’actions collectives au rang de principe de l’action elle-même et principe moral. Qu’il y ait une territorialité de l’action est indéniable mais il est aussi possible d’agir avec des gens que l’on ne connaît pas. À moins d’identifier subversion et illégalisme hardcore, à la manière anarchiste et de se limiter à croire que détruire un truc de temps en temps est le parangon de la rébellion.
Outre que cela n’implique pas le fait de cultiver le même potager c’est à la fois nier qu’il soit possible de s’insurger sans se connaître et une resucée romantique de la casse qui confond encore une fois adrénaline et subversion.
Il est nécessaire de s’organiser pour agir quand on prend des risques, certes. Vivre ensemble peut être une condition matérielle facilitante mais n’est pas la cause de la subversion ! Leur lecture de La Commune est ainsi mythomane, les gens ne vivaient pas ensemble, au terme où ils l’entendent, ils habitaient ensemble, la restructuration n’était pas achevée, restructuration effectivement purement moderne mais irréductible à la technologie (25).
Quant au faubourg Saint-Antoine qui faisait « peur », différemment « d’une banlieue sinistrée » et « explosive » d’aujourd’hui au « pouvoir » qui n’a « rien à craindre des ‘‘émeutes urbaines’’ contemporaines », ce n’est ni la « conscience politique forte », ni le « goût prononcé de la liberté », ni « l’indépendance économique des artisans » et « la sociabilité locale », ni « un mode de vie à défendre » dont tirer « fierté » et « courage » qui le caractérisaient, mais bien la même chose que les sales banlieues : les prolos, les étrangers, les délinquants. Si Napoléon III fait restructurer Paris par Haussmann, Belgrand et Alphand après la révolution de 1848, s’ils construisent deux casernes à l’entrée dudit faubourg, est-ce parce qu’ils ont peur de l’autonomie des artisans dans ce quartier majoritairement ouvrier et chômeur ? Est-ce pour empêcher les artisans autonomes de vivre dans leur quartier sans en sortir ?
« Non seulement Paris rend malade, étiole et tue. Mais, en même temps, il pousse à la déchéance. […] Il le fait par ces vieux logements, éternellement contaminés et criminels, par ces vieux quartiers qui poussent au crime, perpétuant et imposant une tradition criminelle […] Tel est le déterminisme de la ville, souligné et mesuré par les faits. Il apparaît en tant de témoignages de littérature pittoresque. En tant de documents judiciaires aussi. […] Hors la loi, devrait-on dire : et bien moins par cette criminalité accidentelle qui a du moins l’avantage de soumettre quelque-uns d’entre eux au joug de la cité, que par cette manière d’être qui, par définition et en quelque sorte biologiquement, est criminelle. »
Louis Chevalier, Classes laborieuses et Classes dangereuses, pp. 378-380.
« Les classes pauvres et vicieuses, ont toujours été et seront toujours la pépinière la plus productive de toutes les sortes de malfaiteurs ; ce sont elles que nous désignerons plus particulièrement sous le titre de classes dangereuses ; car, lors même que le vice n’est pas accompagné de la perversité, par cela qu’il s’allie avec la pauvreté dans le même individu, il est un juste sujet de crainte pour la société, il est dangereux. »
Frégier, chef de bureau à la préfecture de la Seine.
Les prolétaires « campent au sein de la société occidentale sans y être casés » (26), ce sont « d’autres barbares, aussi en dehors de la civilisation que les peuplades sauvages si bien peintes par Cooper. Seulement, les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous… » (27) Le point de vue de l’ennemi certes. Mais est-il différent aujourd’hui où la banlieue voit errer des « bêtes sauvages » (Raufer), des « racailles », etc. Et le prolétariat de l’époque se considère en effet de cette manière, il ne lui vient pas encore à l’idée de renverser la critique bourgeoise pour se proclamer comme la classe paisible et honnête, on ne rougit pas de l’illégalisme organisé qui est un des moyens principaux de subsistance. Chevalier montre que « l’opinion populaire elle-même accepte ces termes et ratifie ces jugements » (28), le prolétariat se pense encore comme une autre race, en guerre au sens propre contre la bourgeoisie.
Le pouvoir craint bien plus les sales banlieusards que vos communautés à la con. Ou alors vous voulez dire qu’elles ne sont pas révolutionnaires leurs émeutes ? Mais je vous rappelle que vous êtes réformistes, ne reprochez pas aux autres de ne pas faire ce que vous ne faites pas et que vous déclarez impossible. La politique des antitechnologie est une politique de la condamnation : pas de tactiques, juste l’information, la conscientisation et le recrutement. Simplement montrer l’exemple et donner des leçons. L’action directe n’en est que la forme radicale, dans une perspective commune avec les anarchistes : elle a le double mérite d’être bonne en soi, de prouver sa valeur d’activiste, et de faire la fameuse propagande par le fait :
« Voyez, nous en sommes capables, vous en êtes capables et si vous ne le faites pas, honte à vous. » Certes, certains groupes antitechnologie entendent mener des luttes concrètes et efficaces. Mais, même en fermant une centrale nucléaire, en quoi cela change quoi que ce soit au système de leur propre point de vue ? En quoi cela permet-il aux gens libérés de cette menace d’avoir des vrais rapports humains et de vrais besoins satisfaits ?
Il est d’ailleurs étrange de voir que pour des gens qui ont sans cesse le mot communauté (ou « Commune » dans l’Appel) à la bouche cela se traduise dans les faits par des magouilles dans les couloirs et l’appropriation des luttes dans des recyclages privés et le recrutement.
Un simple exemple, l’occupation de l’EHESS pendant le mouvement contre le CPE. L’assemblée générale, la communauté de lutte réunie à cette occasion donc, décide que tous les textes devront être discutés collectivement. La nuit même, les antitechnologie qui ne s’y sont même pas opposés verbalement signent un texte à propos de leurs lubies et le signent de manière à ce que tout le monde pense qu’il émane des occupants (ils l’intitulent « Appel de Raspail », d’après le nom de la rue du lieu occupé : dès lors, dans le journal La Décroissance par exemple, l’occupation est pratiquement attribuée aux signataires de ce texte).
Merci pour l’autonomie, la responsabilité et les valeurs humaines.
—
(1). Mathieu Amiech, Julien Mattern, Le Cauchemar de Don Quichotte. Nous simplifierons la citation en écrivant CDQ dans le reste du texte.
(2). Cédric Biagini, Guillaume Carnino, Celia Izoard, Pièces et main-d’œuvre, La Tyrannie technologique, TT dans la suite du texte.
(3). Ainsi la redoutable question du « bon vieux temps » ne se pose pas également pour les auteurs du CDQ, tout à leur fascination pour les paysans du Doubs au XIXe siècle, qui précisent bien qu’ils ne critiquent pas toutes les machines, ce qui ferait vomir un Zerzan pour lequel tout est foutu depuis que l’homo habilis a disparu, et se lancent dans une défense de la petite propriété privée bien plus droitière que les gauchistes anarchistes tenants du primitivisme. Les auteurs de La Tyrannie technologique quant à eux dressent le catalogue des méchantes technologies, en disant qu’il faut critiquer toutes les technologies, « anciennes » comme « nouvelles », et en défendant parfois les disquaires. Néanmoins, malgré ce différend, tous parlent de responsabilité à peu près dans les mêmes termes. Nous montrerons aussi, si nous en avons l’occasion, qu’entre le micro-libéralisme des uns et l’anarcho-individualisme des autres peuvent se tisser d’étranges liens.
(4). Nous empruntons cette méthode aux auteurs du CDQ qui montrent habilement dans une note de bas de page qu’on peut relier Durkheim, Nietzsche, Hannah Arendt, Heidegger ou Carl Schmitt puisqu’ils se sont lus les uns les autres par exemple. Nous tenterons quant à nous d’éclaircir le bouillon, comme nous venons de le préciser, si nécessaire.
(5). Quant à nous, nous assumons : nous porterons bien ici des jugements de « valeur » puisqu’elles sont si importantes pour tous nos Critiques. Encore une fois, nous entendons les prendre au mot : quelle éthique doit-on se donner dans ce monde et quel monde idéal nous décrit-on ?
(6). Nos deux critiques ont beau par ailleurs représenter l’aile droite de la mouvance antitechnologique, cette condamnation de la collaboration est plus coutumière chez les anarchistes qui eux pensent cependant que le segment vol/squat, adossé à une bonne dose de mythologie canaille et d’esthétique du bris de vitrine, les placent de fait hors et contre le monde de la domination. Quand cela ne se réduit pas à une apologie, simple mais radicale (« chuis pas comme tout le monde moi » ), de « l’alternative » que nous examinerons plus loin dans le paragraphe sur la communauté, il s’agit souvent d’affecter de croire que l’illégalisme est immédiatement révolutionnaire, que brûler une poubelle et « baiser l’État » sont synonymes (comme notre ami Rhoff, le rappeur qui baise l’État depuis tout petit, notamment en ne voulant pas payer de taxes). Que, contrairement à ce qu’affirment les politiciens, le capitalisme supporte une dose d’illégalisme, est inaudible. Il ne s’agit pas ici de dire cependant que l’existence d’un délinquant ou celle d’un policier ont la même valeur, mais d’affirmer que les postures individuelles ou pseudo-collectives à quatre qui se connaissent ne portent rien de dangereux pour le système. Certains anarchistes quant à eux sont simplement « contre la révolution » parce que « c’est un truc de stal autoritaire », et posent donc comme « rebelles » ou « révoltés », mais là n’est pas notre propos.
(7). Je me permets de rétablir l’orthographe et la grammaire de ce résistant au système technique qui écrit pourtant en novlangue SMS.
(8). Le Téléphone portable, gadget de destruction massive, PMO.
(9). Même les soi-disant « militants » (c’est-à-dire ceux qui militent contre autre chose que les machines), quand bien même ils se sentent apaisés sous le prétexte qu’ils empêchent l’expulsion de sans-papiers où qu’ils participent à une lutte « économique » contre une nouvelle dégradation des conditions de l’exploitation, sont coupables au même titre que les autres : « Comment peut-on prétendre s’opposer au capitalisme, lorsqu’on s’accommode, jusqu’à la fascination du genre d’existence qu’il procure et de ce qu’il fait accomplir aux hommes ?» (p.47). CDQ montre ainsi les aspects « schizophréniques » de la contestation : consommer sur Internet et militer contre le capitalisme (parfois avec un portable en poche) sont contradictoires. On trouvera le même type de critique dans l’Appel : il existerait donc quelque part la possibilité de vivre en toute pureté sans collaborer à ce monde. Cette question sera examinée dans la partie sur la communauté.
(10). Le Téléphone portable, gadget de destruction massive, PMO.
(11). Bien loin d’eux l’idée de pouvoir dire « nous sommes tous des ouvrières du Honduras », pour reprendre un exemple de CDQ : d’abord parce que s’identifier à un salaud d’ouvrier qui veut toujours plus de confort est une hérésie, ensuite parce qu’ils récusent que les vieux camps du capital et du prolétariat existent.
(12). On notera cependant un lexique fort méprisant pour désigner les « technophiles » dans l’ensemble de cette littérature. La Tyrannie technologique décroche à notre sens le pompon de l’inventivité en les qualifiant de « troupeau de zombies », associant ainsi et le mouton et le mort-vivant, deux figures parmi les plus amicales.
(13). Nietzsche, Crépuscule des idoles, §7.
(14). Il serait amusant de faire le recensement dans CDQ du mot « impuissance » et de son corollaire « débandade »… On retrouve cette thématique de l’impuissance dans La Tyrannie technologique, pp. 6, 95-97, 112, 115, etc. De même, le Groupe Oblomoff, in Le futur triomphe mais nous n’avons pas d’avenir.
(15). On trouvera aussi des pages hilarantes sur le sujet dans La Tyrannie technologique, pp. 127-131.
(16). Pour qui a envie de chercher, il est facile de trouver sur Internet les dispositifs de police du langage et des comportements prônés par les militants de l’alternative dont les opposants à l’industrie sont ici idéologiquement proches. Sous prétexte de luttes « anti-autoritaires », il s’agit de parodier les instituteurs de la Troisième République en édictant des règles de conduite contre tout ce qui n’est pas pacifié ni neutralisé. Dans certains squats, c’est comme à l’Assemblée nationale, il ne faut pas parler trop fort…
(17). Amiech et Mattern ont ceci de particulier qu’ils en profitent carrément pour réhabiliter les professions libérales : « L’idée de travailler à son compte apparaît comme le comble de l’égoïsme, de la réaction, ou comme une adhésion implicite à l’idéologie néo-libérale. » Or, le « producteur indépendant, maître de son outil de travail, petit propriétaire » était « l’idéal politique » de la démocratie américaine au dix-neuvième siècle (et de sa version consumériste des années 1950, ce qu’ils oublient) et de la République française jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Vive la Convention et la Troisième République, la bonne valeur travail comme meilleure discipline… Ici, ils sont évidemment en désaccord avec les primitivistes par exemple, pour qui le seul « travail » qui vaille est celui
de chasseur-cueilleur.
(18). De même, le problème du contrôle social à l’école vient du fait que les profs sont payés pour le faire, ils ne peuvent donc pas être responsables : la responsabilité c’est le contrôle exercé gratuitement !
(19). Le passé mythique comme « souvenir de l’enfance magnifié » qui « permet à l’individu de grandir » (CDQ 62-63).
(20). L’Homme est en effet une invention purement moderne, une problématique âgée de deux siècles : dans les interstices de la transformation du savoir à cette époque se glisse la question de l’homme, à la fois objet de savoir et condition de possibilité de tout savoir. Et c’est cette invention de l’Homme qui va permettre aux sciences humaines dont ils sont, quoi qu’ils en disent, les tenants plus ou moins critiques, de proliférer. Les « vraies valeurs humaines » c’est le repérage et le contrôle des normes par le pouvoir, l’individu c’est l’objet du savoir et du pouvoir des médecins, des flics, des psys et de la pénitentiaire. Cf. Foucault,
Les Mots et les Choses, et Surveiller et punir, notamment.
(21). Que seuls les individus puissent être dits autonomes n’est pas évident dans l’histoire du mouvement révolutionnaire. L’anarchisme-individualisme rejoint ici l’idéalisme qui pense les individus « moralement libres » sans tenir compte du contexte. Que l’autonomie individuelle règle la pratique collective est une conception exsangue : une insurrection ne peut pas se réduire à ce que font les individus qui y participent. La réduction de la politique à la question éthique, quand elle n’est pas une posture, est un aveu d’impuissance : l’illusion qu’il est possible de changer le monde dans son coin, l’illusion qu’il est possible de vivre à côté, au-dessus, au-delà du monde. L’autonomie dans les luttes a toujours été un problème collectif : affirmation de la puissance distincte du prolétariat, de sa place centrale dans la contradiction du capitalisme et, partant, de sa capacité à se débarrasser du capital ; autonomie comme auto-organisation, à distance des syndicats, des partis et des organisations permanentes – c’est-à-dire organisation dans et pour la lutte, où la lutte elle-même est centrale, pas l’organisation.
(22). Il n’y a bien sûr rien à dire sur le contrôle social communal, sur le rôle du prêtre, de l’épicier et des vieux qui surveillent tout le monde. Si ça leur manque tellement qu’ils viennent vivre dans un village algérien ou corse. Le bonheur d’être fliqué par la famille et les vieux, nous leur conseillons d’essayer : il est vrai que quand la rumeur marche plus vite que les gens, cela garantit de bons rapports humains.
(23). Parce que si les intérêts individuels ne sont pas « momentanés » c’est bon ? Vive les communautés durables…
(24). Et que dire de la perte de la famille ? Il n’y a pas d’interdépendance dans la famille ? Est-ce qu’il y a des rapports sociaux indépendants, qui laissent l’individu intègre
et pur ? On retrouve ici l’angoisse de la perte de maîtrise ; même l’amitié et l’amour doivent n’engager à rien, il ne faut pas que le noyau individuel puisse être envahi par quelque lien que ce soit. La communauté, au sens strict, c’est pourtant une mise en commun où chacun abandonne quelque chose au groupe. Étymologiquement, nos Critiques prônent donc plutôt l’immunité : ne me touchez pas, que rien ne me touche !
(25). Mais quel est le rapport avec la technologie ? L’absence des populations de l’espace public est organisé dès le dix-huitième siècle par la police, pas par la machine… Les rues ne sont pas vidées parce que les gens sont devant leurs machines, c’est pour les mettre devant leurs machines qu’on vide les rues : ce sont des lois qui organisent le quadrillage des villes, l’interdiction de poursuivre les activités domestiques dans la rue, qui les organisent comme un espace de circulation. Aux dernières nouvelles, c’est bien la police et les architectes qui ont commencé à restructurer l’espace urbain. Les caméras par exemple ne sont qu’une poursuite d’une logique policière et pas le principe même du contrôle. Elles sont installées dans une volonté panoptique typique du dix-huitième siècle dont le critère n’est pas une valeur technologique au sens strict mais bien celui de l’efficacité, valeur policière s’il en est. C’est un peu comme si l’on prenait les concepts foucaldiens de « technologies de pouvoir » et de « machines » de contrôle pour les retranscrire au premier degré en les confondant avec tout ce qui est vaguement mécanique et électronique…
(26). Auguste Comte, Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la religion de l’humanité, 4 volumes, Paris, 1852-1854, p. 411.
(27). Eugène Sue, Les Mystères de Paris.
(28). Louis Chevalier, Classes laborieuses et Classes dangereuses, Paris, Plon, 1958, réédition Perrin, 2002, p. 497.
Tract
Nous publions le texte intitulé Pour en finir avec la bête immonde déguisée en Ipod diffusé à l’occasion du débat organisé le mercredi 20 juin 2007 au CICP à Paris autour de la sortie de l’ouvrage – très sérieux – Pour en finir avec la tyrannie technologique, publié aux éditions L’Échappée. Quelques précisions accompagneront utilement sa lecture.
Il nous faut d’abord signaler que ce texte n’a pas été discuté ni écrit par l’ensemble des participants au dossier. Il n’émane, disons, que des plus agacés de ceux qu’avaient énervés les manœuvres au sein du collectif antibiométrie parisien, dans lequel ils avaient fait l’expérience de l’impossibilité d’énoncer autre chose qu’une critique des machines (toute allusion au contrôle et à l’exploitation y étant balayée comme restes paléomarxistes), mais également d’espérer un tant soit peu de fonctionnement collectif tout simplement correct en ce qui concerne l’organisation des actions et l’élaboration des textes. Les auteurs de ce pastiche voulaient, et c’est aussi ce qui motive leur participation à ce dossier, attirer l’attention à la fois sur certaines thèses antitechs et sur certains comportements autoritaires qui contredisent manifestement les prétentions libératrices censées les inspirer. Outre les allusions aux déboires du collectif en question, les thèses défendues et les exemples choisis par les auteurs de l’ouvrage contre la « tyrannie technologique » y sont tournés en dérision.
Cette tonalité parodique a posé question à certains. Elle ne permet certes pas de déployer une critique sérieuse ni d’avancer des démonstrations argumentées. En revanche, et c’était sa raison d’être, elle montre qu’en exagérant très peu les énoncés, on arrive vite à des propositions proprement inacceptables, et elle permet de rire un peu (selon l’humeur), ce qui a fait beaucoup de bien à ses auteurs extrêmement lassés des débats impossibles et des magouilles diverses au sein du collectif. Il apparaît du reste que l’aspect parodique n’a pas toujours été compris, ce qui pourrait être considéré comme un signe d’échec de l’exercice choisi. Car les auteurs pensaient avoir été suffisamment grossiers (sans ajouter tellement à la grossièreté des positions piochées pour la plupart telles quelles dans Le Cauchemar de Don Quichotte), pour que l’ironie soit évidente. Or, suite à la diffusion de ce texte sur Internet, les commentaires les plus intéressants furent les plus stupéfiants : ils acceptaient et louaient la pertinence des propositions les plus extravagantes du texte, en en refusant seulement une ou deux car tout de même un peu exagérées, ou affirmaient simplement son intérêt (1).
Ces réactions nous semblent avoir une certaine pertinence : de fait, au royaume de l’antitechnologie, des propositions ordurièrement racistes, ouvertement sexistes ou bêtement réactionnaires peuvent très bien s’assortir avec l’ensemble du décor, sans même paraître caricaturales.
L’un des commentaires, signé TS, est d’une tout autre nature (2). Il est manifestement écrit par quelqu’un qui pense nous avoir compris et démasqués. Il veut précisément nous faire passer, auprès de ses camarades moins avertis, pour des militants congénitalement insensibles aux problèmes que soulève la vie d’un collectif. Il ne signifie rien d’autre que ceci : « On a autre chose à faire que de s’intéresser à ces gens. Ils appartiennent à une secte — les paléomarxistes — et tout le monde sait qu’il est impossible de faire quoique ce soit avec des sectaires, surtout lorsqu’ils sont impudiques (ils étalent les problèmes privés d’un collectif sur Internet) et progressistes. » Nous espérons avoir clairement montré dans l’ensemble de ce dossier que notre méfiance vis-à-vis de la critique des machines n’est pas issue d’une admiration confiante dans leur avènement. Rabattre nos points de vue sur un marxisme caricatural défendant le progrès par la technique qui libérera l’ouvrier de la chaîne est d’une particulière mauvaise foi. Nous reconnaissons volontiers que cette pochade ne méritait pas une réponse approfondie, mais nous espérons néanmoins que l’auteur de celle-ci ne croit pas y avoir tout dit et qu’il ou elle voudra bien réagir autrement aux textes de ce dossier.
—
Notes :
(1). « Parenthèse. Ce texte est écrit par un mec ! Citer la péridurale comme une déresponsabilisation est complètement stupide. Je propose à l’auteur de se faire élargir le fondement sans se faire anesthésier, il comprendra alors l’idiotie de cette phrase. Cependant, sur le fond je suis d’accord avec ce texte mais la forme est ridicule. J’ai même du mal à le comprendre. Veuillez m’excuser si je n’ai pas compris le trop plein de cynisme de ce texte et n’hésiter pas à m’éclairer… »; et encore : « Oui mais j’ai lu le livre, je suis allé à la conf’ j’ai un iPod eh ouais car pour ceux qui ont pas bien compris le sujet ca parle de la tyrannie technologique et de la tournure que cela a pris ca n’est pas un appel au traditionalisme, l’article est bien, c’est à dire attention à la prolifération du ‘‘tout technologique’’ pas à la technologie elle-même ni à la technique. Donc avoir un iPod ne vous empêche pas d’être d’accord avec l’idée du livre ou du débat. »; ou même: « Eh, les modés… faut le ‘‘publier’’ ce texte au lieu de le laisser dans les ‘‘proposés’’… ».
(2). « Un texte méchant pour régler des comptes. Dirait un règlement de compte interne entre militants contre la biométrie. Seuls comprendront ceux qui on connu les réunions antibiométrie au CICP en 2005-2006. La tendance scientiste productiviste, attachée au vieux marxisme du 19e s’ est sentie virée par la tendance qui ne croit pas au progrès par les machines et le ‘‘déferlement technologique’’ (concept de Tibon-Cornillot). Et ces marxistes de la vieille école se venge par ce texte crypté, plein d’ allusions mesquines, avec l’ ironie qu’il faut pour blesser. Ces marxistes là on loupé le coche de Illich, Ellul, Charbonneau, G. Anders, Orwell, Michéa, Mandosio, Louart, Riesel. Ils croient encore au mythe de la ‘‘technique salvatrice’’, comme le vieux Gorz devenu fana des Digital Fabbers. TS. »