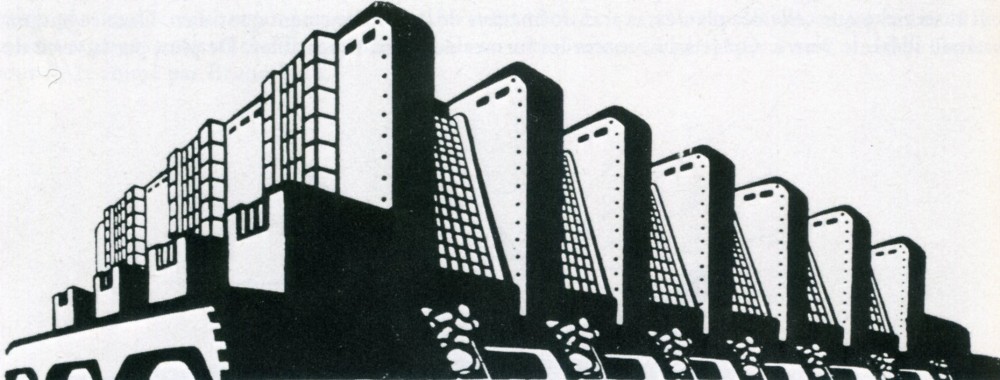Responsabilité et autonomie dans le catéchisme antitechnologie
Cette réflexion se fonde sur un certain nombre de textes : Le Cauchemar de Don Quichotte (1) en est une des sources principales, de même que les textes de l’Encyclopédie des Nuisances (EdN) et autres tracts de Pièces et Main-d’œuvre (PMO), du défunt Collectif universitaire d’agitation (CUL), de son descendant le Groupe Oblomoff, et de La Tyrannie technologique (2). Toutes ces démarches critiques ont des caractères communs et des différences. Nous nous intéresserons à ce qui constitue chez eux un propos plus ou moins cohérent, dont l’homogénéité est renforcée par leurs relations interpersonnelles et leur participation aux mêmes luttes : responsabilité, rapports humains et communauté, donc. Nous puiserons par ailleurs dans d’autres textes de l’antitechnologie avec lesquels ils ne sont sans doute pas en accord sur tous les points (3) mais qui nous éclaireront sur les mêmes sujets. Puisque les Critiques précédemment cités font par ailleurs la promotion de cette pensée, ils ne nous en voudront pas de les rapprocher d’une mouvance avec laquelle ils ont de nombreux points d’accord, certes, mais aussi des différences que nous marquerons quand cela nous semblera nécessaire (4).
Résumons. Tout discours « économiste » participe de l’idéologie technicienne. Toute réflexion qui centrerait la question de l’organisation de la production autour du vieux concept d’exploitation passerait à côté du problème : l’autonomisation du monde de la technique. Il conviendra donc ici d’éviter l’écueil de tomber dans le marxisme le plus plat et le discours vide sur la guerre des classes. D’abord parce que l’objet même de cette réflexion serait pris dans l’illusion qui détourne notre regard de la centralité du problème de la technique. Ensuite parce que la méthode elle-même porterait en germe un regard falsifié sur le monde : penser à partir de l’exploitation c’est d’ores et déjà se glisser dans le discours de l’ennemi, lui accorder de se battre sur son propre terrain, se voir contraint à partager ses présupposés « progressistes ».
En effet, comment croire encore que la lutte des classes soit une dynamique autre que celle de la reconduction du monde industriel et de l’idéologie du progrès ? Quand on constate que ceux qu’on appelait hier encore les prolétaires sont les premiers à « désirer » téléphones portables dernière génération, écrans plasma et autres gadgets high-tech ? La question des vrais besoins, de l’existence libérée, de la possibilité de prendre sa place dans « le mouvement bariolé de la vie » (Zerzan) ou de retrouver « l’ancien monde de la nature humanisée » (Encyclopédie des Nuisances) ne peut se poser en termes de lutte des classes, tant il est vrai que, tous, nous sommes soumis à l’idéologie industrielle.
Suivons donc leurs préceptes, ne tombons pas dans le piège : il s’agira ici de faire le moins possible d’analyses économiques. Nous tenterons au contraire de renouer avec d’anciennes méthodes, datant d’un temps moins artificialisé que le nôtre. Nous ne risquerons pas de perdre notre âme à ne pas considérer la technique comme un problème central et nous tenterons donc de nous poser une question purement éthique : quelles sont les « valeurs humaines », les « modes de vie », la « morale » que nous proposent, nous promettent (ou, mieux, nous permettent pour éviter l’usage risqué du futur), les discours antitechnologiques ? Nous esquiverons les problèmes absurdes du marxisme et des autres théories critiques dont on peut le rapprocher en nous rappelant que les faits sont avant tous des faits « moraux » . Ainsi, notre méthode sera-t-elle celles de ceux que l’on appelait « psychologues » ou « moralistes » au dix-septième siècle : à quels instincts, désirs et affects président donc les jugements, concepts et utopies de l’antitechnologie ? Vers quoi font signe les problèmes de « responsabilité individuelle et collective », de « valeurs » ou « rapports humains », de « communauté » ?
Contre les irresponsables
Nous avons exposé notre méthode, examinons la leur. Certains sont plus précautionneux que d’autres en ce domaine, notamment les auteurs du CDQ, puisqu’ils tiennent à préciser qu’ils n’entendent pas juger les gens et leurs opinions, faire preuve de manichéisme, ou prétendre à une quelconque pureté. La démarche est honorable mais la répétition de telles affirmations confrontée à l’épaisseur du texte nous ferait presque soupçonner qu’il s’agit avant tout de se dédouaner. Rien de mieux en effet que de mettre entre parenthèses un jugement de valeur par la dénégation qu’il s’agisse de cela (5).
Ainsi, leur démarche autocritique de l’introduction entend s’interdire toute position aristocratique. Avouer « regarder avec plaisir des matchs de football à la télévision », symbole exemplaire résumant à lui tout seul l’horreur de ce monde, est ainsi particulièrement courageux. Nos Critiques ne nient pas en effet leur culpabilité dans ce monde où la lutte contre le confort industriel nécessite un ascétisme crâne, « des efforts quasi héroïques » pour « vivre de la manière la plus autonome possible » par rapport à ce système hideux. Et de même : « la technologie » est un sujet « tabou suscitant immédiatement l’atrophie du jugement moral » (TT14), or nos contemporains sont « dépourvus d’armature morale » (TT18).
Mais qui peut donc être un héros dans ce monde où nous sommes tous coupables ? On serait tenté de répondre : personne – mais ce serait nier que si nous sommes tous « responsables » de l’horreur technologique, nous ne le sommes pas tous de la même manière. Il y a des héros, qui agissent, qui essaient de s’en sortir qui, au moins, ont conscience de la faute et de l’effort nécessaire, du péché et de la tâche à accomplir.
Car cette soumission aux impératifs du monde moderne n’est pas qu’un sort subi, elle nécessite notre participation consciente : CDQ l’affirme, leur traité pourrait s’appeler De notre servitude volontaire car le rapport que nous entretenons avec le système est celui « d’une adhésion enthousiaste » au « confort industriel moderne » . « Tout le monde » a donc une « part active » dans la « dégradation du monde » (TT18). Le fait même de ne pas agir contre le monde industriel, de ne pas au moins le dénoncer, est constitutif de la faute : le « désengagement » est en effet un engagement : on participe « activement au cours présent des choses en travaillant et en consommant » (CDQ78).
Ainsi, « tout le monde fait de la politique, même sans le savoir, notamment en acceptant que la vie quotidienne soit de plus en plus façonnée par la fuite en avant des besoins artificiels et illusoires. Chacun entérine ainsi la très réelle destruction de la nature et des sociétés humaines qui est son corollaire inévitable » . Ce sont eux qui soulignent : en effet, un des modes essentiels de notre collaboration avec ce monde est l’action passive d’acceptation, l’auto-aveuglement « volontaire » face à la « responsabilité » que nous avons dans son existence et son renforcement. Le « même sans le savoir » est ce qui articule notre culpabilité : car nous ne pouvons pas ne pas voir le monde dans lequel nous vivons et que notre mode de vie est cause de ce monde , par la volonté de ne pas voir, nous le cautionnons, le construisons, le consolidons (6). En effet, pour préserver notre « confort mental », et par une terrible « paresse », nous préférons ne pas voir l’évidence, nous nous comportons comme des enfants gâtés mais dont la satisfaction des caprices provoque l’existence d’un monde diabolique, voire chez l’EdN ne provoquera rien de moins que la destruction du monde. Majesté de la critique que de dévoiler que les comportements les plus anodins ont les conséquences les plus monstrueuses : qu’importe que l’essentiel de la pollution par exemple soit le résultat de stratégies industrielles et agricoles sur lesquelles nous ne décidons pas de fait, en recentrant le problème de la production sur celui de la consommation c’est notre comportement qui est la cause en soi de l’apocalypse technologique – nous décidons de consommer, donc on produit pour nous satisfaire. On nous dit par ailleurs que nous sommes soumis à la pub, dans une grande confusion post-situationniste de la plus belle espèce qui arrive à tenir à la fois la dictature totalitaire de la réclame et notre consentement volontaire à ses injonctions.
Mais passons, pour essayer de comprendre comment fonctionne notre irresponsabilité consumériste. Elle s’articule en fait sur une pseudo-dialectique entre la conscience du crime et le confort de s’y laisser entraîner :
« Car c’est chaque fois de manière à nous dispenser de savoir exactement ce que l’on fait, d’en avoir la pleine intelligence ; en nous fournissant le confort de n’avoir pas à être entièrement conscients de nos actes et d’en éprouver les déterminations contraires: de n’avoir pas, en quelque sorte, à être là en personne. C’est toujours une infantilisation, que ce soit par le voyage instantané en avion ou le paiement avec une carte de crédit, le récepteur d’image à domicile ou la lecture assistée par ordinateur ; par la contraception hormonale ou l’accouchement de confort sous péridurale. »
EdN, Remarques sur l’agriculture génétiquement modifiée et la dégradation des espèces.
« Du matin au soir, nous vivons perpétuellement entourés d’objets techniques de plus en plus sophistiqués. Dès le plus jeune âge, nous apprenons à établir avec eux des relations d’automatisme, sans réfléchir aux conséquences de nos habitudes. En démarrant sa voiture, qui pense à la pollution qu’elle rejette ? En allumant la télévision, qui se soucie de ses effets psychiques ? En achetant un ordinateur, qui réfléchit à son devenir une fois usagé ? La publicité est la première à occulter les questions morales et politiques que soulève la technologie. »
Les Argumentocs, Les Renseignements généreux, octobre 2006.
« Mais ils refusent de l’envisager de manière frontale, d’y réfléchir posément et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, pour s’épargner la peine d’avoir à formuler une condamnation morale de leur propre rôle dans cette société. Ce malaise laisse entrevoir la possibilité d’une révolte de ceux qui, parmi eux, auraient conservé un sens moral assez sain. »
Un chercheur « dissident » de Sauvons la recherche, à propos de ses collègues, sur le site de l’OCL.
« Peut être que tu as cette réaction, car il est trop difficile pour toi de te remettre en question, de remettre en question ton rapport à la consommation, à la machine, et en fait sortir de tes petites habitudes. C’est difficile de se poser des questions qui remettent en cause son mode de vie et ce qu’on considère comme acquis. »
Commentaire d’une réponse « pro-machine » à un texte antitechnologique sur Internet (7).
Ne pas savoir ce que l’on fait est permis par le « confort » que nous offre le monde technicien. Ce confort nous permet de ne pas éprouver les « déterminations contraires », c’est-à-dire les conséquences de nos actes : nous nous laissons donc, par pur goût de la jouissance, retomber en enfance, être complètement à la merci du système. Toutes ces citations partagent le même vocabulaire, celui de la responsabilité et le même thème, celui de la faute morale. Ils partagent aussi une position de surplomb, un désir de faire la leçon à ceux qui se laissent embrigader par le confort. La question est de fait « qui se soucie des conséquences à part nous ? ». Les antitechnologie sont les seuls capables de « remettre en question » le confort du mode de vie contemporain. Ne pas avoir de portable est ainsi un exploit moral, une résistance héroïque confrontée à la moquerie des contemporains (8).
Évidemment, cette posture de supériorité morale n’est pas exclusive : elle laisse l’occasion à celui qui aura le « courage » d’ouvrir les yeux et « l’héroïsme » de renoncer à la jouissance de reconnaître son erreur et de les rejoindre. Il est possible à tous de développer « une conscience plus claire (forcément douloureuse) » d’être des salauds qui bossent pour le pouvoir (CDQ127) et, une fois purifié par le passage de la culpabilité et de la souffrance morale, de se convertir à la pureté – comme dans toutes les religions !
Mais quelle est cette responsabilité dont on nous parle ? Il y a des « avantages » au système nous l’avons vu. Or, « dans chacun de nos gestes de la vie quotidienne, pour répondre à chacun de nos besoins, nous déclenchons (ou nous utilisons) des processus auxquels nous ne pensons pas ». Nous n’avons en effet pas conscience de nos actes, plus encore, nous profitons « volontairement », avec plaisir, de « l’exonération de nos responsabilités ». Nous participons donc tous d’une « irresponsabilité courante de la vie moderne » (CDQ 84-86) : d’une part, nous sommes tous responsables du monde horrible que nous façonnons, d’autre part nous récusons cette responsabilité grâce au confort que nous offre ledit monde (9). Or, « chaque fois que vous passez un coup de fil sur votre portable, vous jouez avec la santé des habitants du Grésivaudan, avec la vie des Congolais et celle des derniers grands singes de la planète » nous disent Pièces et main-d’œuvre (10).
Mais les « médiations technologiques » ont le pouvoir « d’éloigner » les nuisances, c’est-à-dire la prochaine fin du monde et l’horreur de l’exploitation du Tiers-monde.
Le rapport aux marchandises est ainsi décrit dans les termes de la dépendance, de l’accroc, du drogué, du malade…
le technologisme est une maladie morale. On notera que le problème n’est jamais l’exploitation mais bien que nous puissions nous éloigner de cette conséquence déplaisante de notre mode de vie par le confort satisfait.
Or, « le prix de notre confort » est un concept de petit-bourgeois qui vit en effet confortablement dans ce monde. L’écrasante majorité de ce qu’on appelait autrefois prolétariat (désolé du gros mot) est « consciente » de vivre dans ce monde comme exploitée. Son problème n’est pas d’être « éloignée » de ces réalités sordides mais d’y être directement confrontée. Il s’agit ici d’une éthique pour petits-bourgeois dont la conscience de l’horreur du monde est celle de la téléprésence, celles de spectateurs des conséquences forcément lointaines, mais bien trop proches dans leur spectacle, de leur confort : le malheur des pauvres du tiers-monde, le futur comme catastrophe inévitable. Curieusement, il n’y a là rien de présent, d’intime, à condamner, il s’agit toujours d’un ailleurs. La seule présence à cette situation de nos pourfendeurs du système est la conscience malheureuse et l’identification impossible au prolétariat (11). Ils n’ont pas d’expérience du monde !
Tout est ramené à la consommation, d’où l’anti-économisme : les machines produisent et se consomment. On consomme, donc on produit.
D’un côté donc, la simple consommation est un acte coupable (CDQ 79), de l’autre, la plupart des antitechnologie avouent ne pas pouvoir ne pas y participer. Ce qui fait la différence c’est le supplément de conscience coupable qui dédouane et excuse. D’autres, moins radicaux, posent un « on n’a pas le choix » dans un monde tel que le nôtre, parodiant certains marxistes (qui, s’ils sont opposés au salariat n’en admettent pas moins qu’ils sont obligés de travailler ou de squatter/voler et partant d’être « de ce monde »), mais en oubliant que, contrairement à la nécessité matérielle de vivre dans un monde réglé par le travail, s’il ne s’agit que d’une manière de vivre, d’un impératif moral à tenir pour ne pas être coupable, personne ne les oblige à diffuser leurs textes sur Internet. La cohérence pensée/action impossible est déverrouillée par une magouille purement rhétorique : « Pourquoi voudriez-vous nous interdire de parler ?», ou « On sait qu’on ne peut pas battre l’ennemi avec ses armes mais bon », certains allant jusqu’à une sorte de calcul rationnel des moyens et effets où la conscientisation équilibre la « nuisance » d’utiliser un média maléfique – une sorte de comptabilité des bonnes et mauvaises actions, soutenue par l’excuse de la conscience du problème moral, bref, la culpabilité.
Critique qui se veut non « aristocratique » (12). Les auteurs du CDQ identifient ainsi la « pensée de gauche » à la « réduction des inégalités » . Fort heureusement, nous ne sommes pas de gauche et les prolétaires en lutte eux non plus : ils ne cherchent pas l’égalité dans le confort mais luttent contre leur condition d’exploités. Mais comme s’ils bénéficiaient tous du niveau de confort de nos écrivains le monde courrait à sa perte, il est urgent qu’ils cessent de réclamer des sous ou du temps libre aux dépens de plus prolétaires qu’eux. La question ne se pose que dans une urgence réformiste : comment faire les « petits pas » qui nous permettront à tous d’être pauvres ?
Malheureusement, seuls nos rebelles en lutte contre les machines sont conscients et responsables de leurs actes. C’est que leur volonté doit être plus forte ou plus pure que la nôtre qui refusons de voir les conséquences de nos vies confortables. Voilà en effet la nécessité du caractère « volontaire » de la soumission confortable au Mal : se poser en donneurs de leçons, en héros, en juges de leurs contemporains. Et de s’offusquer que « l’idée de responsabilité tend à devenir une notion purement juridique », dès lors, il n’est pas étonnant que « prospèrent » les « comportements de voyou et de casse-cou » dont la seule réponse du système (quelle autre pourrait-il donner ?) est le « renforcement du contrôle social » . Voilà qui est ironique. Passons sur la dénonciation des « voyous », nous y reviendrons plus tard. Mais c’est faire preuve d’une drôle d’inconséquence que de penser que l’apologie de la « responsabilité » peut mener à autre chose que son recyclage juridique et pénitentiaire… La responsabilité et le justicialisme fonctionnent sur le même présupposé, sur le même désir, sur le même besoin : punir.
Il faut un en effet une « liberté » comme « pouvoir moral » et conscience des « limites » (TT38), un « libre arbitre » (13), il faut rendre l’humanité « responsable » pour pouvoir la « punir » et la « juger » : « La doctrine de la volonté a été inventée afin de punir, c’est-à-dire avec l’intention de trouver un coupable. » C’est une « invention » de prêtre. Les hommes ont été considérés comme « libres » pour pouvoir être jugés et punis – pour pouvoir être coupables. Monde moral, péché, peine… Confession, aveu, rhétorique des circonstances atténuantes avec supplément de questionnement moral. Se reconnaître comme coupable. Ressentiment et ascétisme. Passion de la condamnation, de la dénonciation, du « tu dois » . L’au-delà, le passé idéal, comme outil pour salir le présent, voire le futur – il s’agit bien là d’une morale de prêtres, d’une « métaphysique du bourreau » .
Cette volonté de punir va en effet jusqu’au délire le plus complet : l’amalgame des scientifiques actuels avec les scientifiques travaillant pour les nazis. L’agitation de l’épouvantail moral est ici particulièrement dégueulasse eu égard à la réalité de ce que fut l’hitlérisme :
« La banalité du mal
Dans Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, Hannah Arendt explique que la déportation et l’extermination des juifs se faisaient avec des gens pas forcément méchants. Ils faisaient juste leur travail. Le chauffeur de locomotive faisait juste son travail. L’aiguilleur faisait juste son travail. Comme le médecin, l’intendant, le fonctionnaire, etc. Et au final, il y a eu des millions de morts.
Ce qui est frappant, c’est qu’au procès de Nuremberg, il y avait des absents : les savants allemands qui avaient collaboré avec Hitler, nazis ou non. Ils avaient collaboré parce qu’Hitler leur donnait des moyens, des laboratoires, de la main-d’œuvre, des cobayes, de la matière première, etc. Pourquoi est-ce qu’ils n’étaient pas dans le box des accusés ? Parce qu’ils avaient été exfiltrés. Les Russes en avaient pris une partie, les Américains aussi, et même les Français ont exfiltré quelques savants allemands qui les ont aidés pour le programme spatial français. Au final, tout se passe comme si les scientifiques n’étaient jamais redevables des crimes qu’ils aident à commettre. Il serait temps qu’ils répondent de leurs actes au lieu de se défausser perpétuellement sur la société ou les élus. Avant d’être scientifiques, ils sont avant tout des êtres humains.
Les Renseignements généreux (inspiré d’une intervention du groupe PMO lors d’une soirée sur le puçage des animaux et des humains, Grenoble, 04/2006).
« La qualité du travail moderne, en entreprise comme en laboratoire referme les personnes sur leur petit domaine d’activité, sur leur vision du monde, – dans ces deux casernes, la pensée vise le résultat. L’objectif global de l’entreprise, par exemple la conception et la réalisation de missiles, n’est porté que par la minorité qui met en commun les différents résultats. Untel affirmera être en charge du téléguidage, un autre du fuselage, un autre du transport des matériaux dans les différents sites de production, passant sous secret l’essentiel de sa participation. L’organisation en réseau qui s’est développée corrélativement à la sophistication technologique est un puissant vecteur de cette déresponsabilisation.
Culture d’entreprise, culture scientifique, vases communicants entre eux-mêmes, vases clos sur eux-mêmes. L’enfermement mental du travail moderne mène en effet à la déresponsabilisation de l’activité du travailleur, ou du chercheur… Arendt, Anders, Dejours, on ne rappellera pas ici leurs analyses du cas Eichmann, parce qu’on n’a pas la place et puis on les connaît pas personnellement, mais il paraît qu’ils auraient parlé de ça…».
Une fraction de conScience du CUL (Comité universitaire de libération).
Valeurs humaines et besoins naturels : la famille et le travail
Et ces gens entendent nous donner des leçons de vie, nous apprendre quelles sont les vraies valeurs à respecter. La valeur de la responsabilité comme nous l’avons vu, mais celle-ci est avant tout une prescription d’état de conscience, une disposition morale, mais la conscience souffrante et culpabilisée n’est pas suffisante à guider seule nos conduites : il lui faut en effet son corollaire, la « maîtrise » .
Nos antitechnologie sont en effet des êtres terrifiés, leur monde tourne entièrement autour de son anéantissement : c’est à partir de leur propre débilité,
de leur propre « impuissance » (14) qu’ils théorisent et jugent. Le monde est ainsi « hostile » parce que « incontrôlable et incommensurable » , « incompréhensible, immaîtrisable, irrécupérable. » « La pensée se délite » (TT25) face au monde technologisé. Les antitechnologie tiennent en abjection toute « interdépendance » (autre que celle de la famille nous verrons), tout « processus qui les dépassent » (CDQ 83-84). Bien sûr, nous ne saurons pas exactement ce qu’il y a d’affreux dans ce dépassement, comment il fonctionne effectivement. On pourrait penser que c’est le simple fait d’être dépassé qui est affreux. Confronté à la « surenchère informationnelle » sur Internet le cerveau ne peut plus tenir. On part vraiment de l’impuissance et de la débandade, de la terreur du monde, de la débilité.
Internet et la télé font « venir le monde » à nous au lieu qu’on y aille. Les spectateurs sont choqués par les conséquences de leurs actes et l’hideuse altérité, ils expérimentent un « déphasage », une « déstructuration de notre rapport à l’espace et au temps » (15). Bruxelles et Marseille sont dans la banlieue parisienne ; « l’automatisation complète des portes » dans les trains n’inquiète personne : la liberté, la maîtrise, c’est de pouvoir tourner la poignée soi-même ?
Internet est d’ailleurs une des têtes les plus monstrueuses de l’hydre. Le problème de « l’irresponsabilité individuelle » sur Internet est terrifiant, les « normes comportementales » qui s’y jouent sont affreuses. Il y a une « communication » entre les hommes qui « ne les engage à rien » . Les sites de drague sont horribles parce qu’ils sont virtuels, avant il fallait aller en boîte pour serrer, c’était mieux. Oui, aller aux putes en vrai, c’est mieux, c’est plus humain que se branler sur Internet : on se sent coupable quand on rentre chez sa femme. A moins qu’il ne faille revenir aux mariages arrangées ? Mais non, la rencontre romantique a toujours été l’idéal. La littérature le prouve, lisez Manon Lescot ou Les Souffrances du jeune Werther.
« Les vertus morales sur lesquelles la société est fondée » ne se jouent en effet que dans la quotidienneté. Les rapports humains (qui ne sont plus comme avant) sont un des grands problèmes des antitechnologie.
Au quotidien justement, ce sont des airs outrés dès qu’un mot est prononcé plus haut que l’autre, ou que quelque chose comme un désaccord puisse se discuter vivement. Puis des procès en « mauvais rapports humains », de préférence à distance, comme dans le texte de dissolution autoproclamée du collectif parisien contre la biométrie.
Les auteurs du CDQ font ainsi l’apologie de la politesse et de la civilité, c’est-à-dire de valeurs purement policières (au dix-huitième siècle « pacifier » et « policer » sont des impératifs étatiques fondamentaux : pour l’État, même la bourgeoisie communale est trop « sale », « agitée » et « frondeuse »)(16).
Or, les anciens « liens sociaux locaux », sans lesquels les comportements « décents » relèvent « de l’héroïsme moral » ont disparu. Les auteurs de La Tyrannie technologique déplorent quant à eux « la disparition des rythmes de vie, des structures familiales et communautaires et des mythes qui leurs étaient associés » (21) et, avec Baudrillard, l’horreur de vivre « sans structure sociale profonde, sans système ordonné de relations et de valeurs » (98).
Or sur Internet, on n’est pas « obligé de laisser toutes ses qualités morales à la porte » mais ces qualités ne viennent pas d’Internet lui-même. Quand la « situation réelle », quant à elle, nous « empêche » d’en arriver à des « extrémités » telles que des « insultes » , sur Internet au contraire « une insulte ne coûte de toutes façons pas grand chose » – la « discussion de bistrot » permet en effet « sur le long terme » la possibilité que les méchants racistes par exemple aient à « rendre compte de leurs propos » … En les dénonçant aux flics ? (TT135). Face à de telles affirmations, on a envie de dire : quel est le rapport avec le shmilblick ? Ce n’est pas parce que se promener en montagne n’impose pas de ne pas jeter ses papiers gras par terre que la randonnée est horrible ? De plus, nos Critiques semblent penser qu’un système (coercitif ?) peut forger une bonne moralité des individus.
Ce n’est pas parce qu’une médiation ne nous apporte pas le contrôle social qui va avec qu’elle est négative, si ? « Internet ne provoque pas un comportement moral », allons jusqu’au bout : le reproche consiste en fait à sous-entendre qu’Internet est à la limite de les provoquer, ces comportements immoraux.
Et pourquoi donc ? A cause de l’anonymat et de l’impunité : on a beau jeu de critiquer la société de la transparence (TT) si c’est pour s’offusquer par ailleurs que les gens ne déclinent pas leur identité et ne soient pas punis s’ils insultent quelqu’un. Eh quoi ? Dans la « vraie vie » les gens se parlent bien ? Allez, dites-le : en tout cas ils le devraient !
Il faut donc des médiations à la moraline, avec du contrôle social humaniste, comme au bon vieux temps du contrôle social villageois (nous y reviendrons). Il faut des normes et des traditions pour ne pas se comporter comme un porc. Contrôlez-moi gentiment ou je serais un cochon. Horrifié par sa propre déchéance morale, qu’il sent en lui, l’antitechnologie, ce grand malade, est avide de dignité morale, nécessaire pour supporter son propre aspect au nom de la justice. Ils veulent que justice soit faite, que tous souffrent avec eux. Voilà d’où vient l’impératif de la maîtrise : de la certitude intime chez nos Critiques que leurs propres pulsions sont mauvaises, qu’ils sont eux-mêmes des porcs, leur volonté d’ascétisme vient de ce qu’ils savent qu’ils sont trop faibles pour vivre de manière « décente » sans qu’on les y force.
Car, on le sait, c’était mieux avant, avant les machines et le virtuel : « Y a plus de sincérité dans les choses.
Merde on peu pas tout dire à travers un sms, encore moins à travers un écran… (…) j’suis une victime de cette fichue société. J’ai un ordi, un portable … je sais pas pourquoi je me permets de dire ça. Peut-être parce que finalement c’est un peu pour faire comme tout le monde qu’on veut avoir tout ça… » (un internaute… sur un blog de Skyrock).
De même : « Je ne suis pas vieux j’ai 20 ans mais il y a 10 ans c’était tout différent et l’amitié y était plus forte j’en suis sûr sans les sms sans internet sans les skyblogs ! ! »
(un blogueur).
Que l’échelle soit variable, de l’homo habilis jusqu’à il y a dix ans, est moins important que l’évidence massive et jamais discutée que c’était mieux avant, qu’on avait de vrais rapports humains, etc. C’est la forme « technologie » qui transforme les rapports sociaux en rapports virtuels détestables. En effet, dans « l’échange marchand » sans trop de technologie « subsiste forcément » une « part d’humanité » (CDQ113). Il faut défendre les épiciers culturels tels que les libraires et les disquaires qui, contrairement aux sales prolos qui produisent de la merde, vendent de l’art qui sent la rose – et des disques artisanaux ou des livres recopiés à la main (TT36) ? C’est absurde ! Le rapport humain qui distingue le flic de la caméra de vidéosurveillance c’est l’immédiateté du coup de matraque dans la gueule ! Et il faudra encore qu’on nous explique d’où sortent ces vrais rapports humains résiduels malgré le totalitarisme technologique, le caractère « irrécupérable » du monde (EdN) et le fait que tous les gens soient des connards volontairement soumis au système ? Sauf les commerçants ? Comment, si tout le monde est un connard volontairement soumis au système ? Comment peut-on tenir à la fois que tout dans l’Économie est médié par les machines, ou dans le Système par l’Économie, et le fait que ce rapport constitue notre humanité ? Mais quelles sont ces valeurs humaines dont on nous rebat les oreilles ? C’est quoi cette « part » d’humanité dans la vente ? Où est-elle définie, discutée, comparée à l’artificialité contemporaine ?
Les seules réponses à ces questions sont l’apologie des anciennes sociétés, qu’elles soient préhistoriques chez Zerzan, pour qui avec le langage c’est déjà le début de la fin, ou qu’elles soient dans le Doubs il y a un siècle dans CDQ… Ce retour à un passé fictif, en le débarrassant de ses « dominations » réelles est la seule présentation positive d’une vraie nature humaine. Cette nostalgie partielle relève systématiquement de la fiction révisionniste. On pourrait leur accorder le loisir de piocher dans le passé pour ressusciter un Moyen Âge sans droit de cuissage. Cependant, pourquoi le détail de ces bonnes relations humaines n’est-il jamais détaillé ?
C’est que le passé fonctionne comme consolation, c’est un arrière-monde indémontrable : on nous parle souvent des valeurs humaines authentiques, on ne nous dit jamais lesquelles et comment elles s’articuleraient (à part le gimmick de « sans argent, sans économie » dont on pourrait demander quel est le rapport avec les machines ?). Ces vrais rapports humains ne sont ni définis, ni remis en cause. Ni discutés, ni discutables (ils sont en effets naturels). Ils étaient donc idéaux sans les machines ? Mais pourquoi ne nous dit-on jamais comment ? Les évidences massives du bien passé servent essentiellement à démontrer la présence du Diable. Le passé où les gens se parlaient vraiment n’est qu’un avatar du monde des idées, c’est le paradis perdu et promis des chrétiens, c’est une vengeance contre le présent.
Cette naturalité des bonnes valeurs humaines indiscutables est cependant déclinée sous les modalités du travail et de la famille. La minutie fait ici aussi cruellement défaut mais le fatras discursif idéologique est bien développé, laissant voir en creux certaines valeurs bien précises. Les « vertus » du citoyen idéal permettent en effet selon Lash (La Révolte des élites, cité dans CDQ43) d’acquérir des « habitudes démocratiques » : « autonomie et confiance en soi, responsabilité, initiative » grâce à la chance « d’exercer un métier ou la gestion d’un bien de petite taille ». Le « contrôle ouvrier sur les moyens de production » est synonyme de l’« acquisition des vertus civiques ». L’exercice du métier, comme forme de la maîtrise, est de même central dans les textes de l’EdN. L’artisanat permet en effet une autonomie des individus et leur garantit la possibilité de subvenir à leurs propres besoins naturels sans être à la merci du système. Or, dans le cadre de la société contemporaine « la satisfaction du travail accompli n’est bien souvent plus qu’une absence de honte, un soulagement de n’avoir pas – pour l’instant – failli ». Nos deux Critiques conspuent ainsi le « mythe de l’abondance », celui de la société « sans travail, sans effort et sans douleur ». Ainsi, la « perte d’autonomie » égale la « dépossession » et la « déqualification » : « la fierté qui accompagne la possession de savoir-faire propre » disparaît chez le bon travailleur, les beaux objets du passé et la « satisfaction et la patience qui leur étaient associés » sont devenus lettre morte. Une note de bas de page précise même qu’il ne s’agit pas de faire l’apologie du bon vieux temps : non, c’est faire l’apologie de la valeur travail, c’est partager avec les patrons la nostalgie du temps où les ouvriers étaient fiers de leur boulot (17). Vive le nouveau Stakhanov antitechnologie !
La discipline par le travail, voilà qui est intéressant mais une question nous brûle les lèvres : en miroir des « valeurs » nous venons de voir apparaître les « besoins » – lesquels ? Encore une fois, le flou est une méthode bien efficace, à moins qu’ils ne s’en remettent à notre seul bon sens ? La deuxième lame du rasoir d’Occam de la critique radicale est celle de la famille. « L’effondrement des structures familiales, redoublé par la détérioration des formes d’encadrement informel des enfants et des adolescents (personnes âgées sur le pas des portes, boutiquiers des rues commerçantes, voisins) » est une catastrophe (CDQ74). Nous reviendrons sur ce bon vieux contrôle social communal qui nous manque tellement. Notons juste pour l’instant qu’il est rare de voir de jeunes gauchistes faire preuve d’une forclusion machiste aussi flagrante.
« Certain-e-s » voient la marque de la « domination phallocrate » partout mais force est de constater que, pour autant que notre époque ne serait pas celle d’un féminisme réalisé il faut reconnaître que la belle époque de nos Critiques est, du point de vue des femmes, sans doute difficile à trouver si formidable que ça. Rappelons la condamnation de la pilule et de l’accouchement de confort par l’EdN.
Ainsi, quand la fondation Copernic propose de salarier le travail domestique des femmes, qui est pour l’heure gratuit, nos Critiques sont pris d’horreur : c’est la « suppression de toute gratuité » (CDQ56-57), la « soumission de la pensée de gauche aux catégories capitalistes du travail et de la richesse » . Une critique du revenu au nom de l’autonomie, du refus de l’accaparement par le contrôle social des richesses que nous créons « spontanément » et « gratuitement », l’affirmation que le fichage étatique est pire que la spontanéité des relations sociales dans la famille ou le couple, voilà qui est original. Nous ne tomberons pas dans des analyses économiques qui les ennuieraient sur la reproduction de la force de travail mais soyons sérieux un instant : en quoi, si le système technicien envahit notre quotidien, la sphère de la famille en serait-elle épargnée ? Le mythe de la société pour la société, de la vie privée comme dernier refuge de la liberté est pathétique (18).
Mais ne soyons pas mesquins, il est au moins un féministe au royaume des opposants à l’horreur technologique : Zerzan. En effet, « la disparition des grandes canines chez le mâle étaye fortement la thèse selon laquelle la femelle de l’espèce aurait opéré une sélection en faveur des mâles sociables et partageurs » … Comme tout bon religieux, Zerzan est finaliste : les canines courtes marquent un caractère doux, avoir les dents longues empêche d’être sociable et partageur. Bien. En tout cas, la « lutte des sexes » est ici bien présente : les femmes ont carrément le pouvoir de faire évoluer l’espèce grâce à leur cul !
Mais passons, pour tenter de récapituler un petit peu où nous en sommes. Pas très loin malheureusement. On sait qu’il existe de vrais rapports humains et de vraies valeurs humaines mais tout cela reste assez flou. Tout au plus sait-on qu’il faut regretter le bon vieux temps où l’on était fier de son métier et aimer les efforts et la douleur qui vont avec, qu’il faut être poli, sociable, partageur, qu’il faut avoir confiance en soi, être responsables, avoir le sens de l’initiative et respecter sa famille. On ne nous dit bien sûr pas en quoi ces « valeurs civiques » sont différentes de celles d’il y a un siècle, mais soit. Ceux d’entre vous qui ont eu le bonheur d’aller dans une école catholique ou simplement d’avoir expérimenté un instituteur vraiment républicain auront reconnu sans mal ce chapelet de prescriptions morales. Dans le Doubs, il y avait aussi l’instituteur et le curé : la grande nouveauté de nos nihilistes c’est de s’installer dans le négatif du jugement moral pour réenchanter le vieux monde du contrôle social chrétien, avec comme monde-vérité non plus l’au-delà du paradis promis mais le bond en avant vers un passé. Comme pour tout nihiliste, leur état de nature est une fiction floue, mais ici c’est une fiction du passé (19).
Le vrai homme naturel d’avant la technique et son cortège de nuisances, c’est en effet le chrétien ! On nous invite même à plutôt critiquer la technologie que l’Église : « Une fausse critique du phénomène religieux vise à faire croire que c’est dans l’immédiateté de la vie quotidienne que le sens des choses existe » (TT137). Il est certes « tout à fait possible de douter des paradis célestes » mais, bon…
Merci de votre permission et bravo pour l’arnaque rhétorique : en accolant « immédiateté » à « vie quotidienne », ce qui est loin d’être évident, vous arrivez à critiquer la méchante rapidité technologique mais aussi la vie, tout simplement. Et si ce n’est pas la vie qui donne « sens » aux choses, c’est bien un au-delà, un au-dessus : pas forcément le paradis chrétien mais bien le paradis prétechnologique. Les vraies valeurs humaines qu’ils regrettent donc sont la famille et le curé ! L’alternative c’est la fin du monde ou le nanisme, devenir aussi petits qu’eux. Leur pensée impuissante part en effet de la négation de tout ce que le désir peut porter de grand, la dénonciation de l’impuissance de la jeunesse est un désir d’impuissance. Se poser la question d’affects et de pulsions agencées de manière différente ne leur vient pas à l’esprit : il faut, pour sauver le monde et se sauver, se rapetisser. Il faut apprivoiser l’homme, limiter ses désirs, tuer ses passions. À partir de leur instinct en soutane ils condamnent le monde et leur conception de la maîtrise est de l’ordre de l’amputation : les anciens voulaient maîtriser leurs affects puissants, ils veulent que ces affects soient affaiblis, mesurés par leur minuscule concept de nature. Or, la nature qu’ils appellent de leurs vœux n’est ni égalitaire, ni douce, elle est terrible. Mais ils veulent la maîtriser, les modernes, les cartésiens. La nature n’est pas morale, n’est responsable de rien ! Il leur faut un abêtissement de l’homme pour que celui-ci se retrouve enfin à la place de Dieu, qu’il soit un « père juste et bon » .
Ce qu’ils appellent de leurs vœux c’est le vieil art du contrôle des conduites, transmis de la religion, du prêtre-pâtre, à l’État biopolitique. S’agit-il d’inventer de nouvelles formes de contrôle de soi, dans la communauté humanisée et naturalisée ? Certes, mais systématiquement en référence au passé. L’autonomie n’est pas un avenir mais toujours un paradis perdu mythique, qui n’avait pourtant rien de paradisiaque. Pourquoi donc cet acharnement à s’inspirer de l’autonomie passée, s’agit-il d’un simple manque d’invention ? La question de nouveaux rapports sociaux ne se pose même jamais, tout ce qui est nouveau est mauvais.
Leur homme idéal est donc un homme purement fictif et cette vérité de l’homme à atteindre, en tant qu’elle est la nature humaine passée moins la domination, est encore une nouvelle tentative d’amélioreurs de l’humanité. Il s’agit simplement de corriger les conduites, de se poser la question du contrôle : comment gérer les hommes ?
Le malheur de nos prophètes (de nos « préphètes » ?), c’est de ne pas voir que leurs valeurs sont constituées pour moitié de christianisme et pour moitié de fétichisation de modes d’assujettissement purement modernes dont l’invocation répétée de l’homme est le symptôme le plus criant. Homme, valeurs humaines, individus, autant de problématiques dont l’invention est consubstantielle à la modernité qu’ils critiquent, autant de concepts qui sont produits par le monde et les dispositifs de contrôle qu’ils entendent combattre (20) !
Communauté et autonomie
L’utopie antitechnologie est certes rétrospective mais c’est bien une utopie : on entend nous prescrire comment vivre. Ce qui manque en effet le plus à la contestation d’aujourd’hui, c’est d’avoir « un idéal à opposer » à la « domination » . Il s’agit donc d’organiser des espaces où les « vraies valeurs » puissent se vivre, où les individus soient « autonomes » (21) et puissent assouvir leurs « vrais besoins » (22). Rien de bien nouveau sous le soleil, c’est la prétention de l’alternative depuis trente ans que de se faire un petit bout de monde libéré.
« Nos collaborations avec le système sont multiples, comme nos dépendances. Certains y participent plus que d’autres. Certains, aujourd’hui, tentent de s’en sortir, de construire des savoirs autonomes, des savoirs pour eux, des savoirs correspondant à leurs goûts, à leurs désirs pratiques. Quand certains continuent à construire leurs sciences, leurs techniques, leurs jobs sans autre projet que de poursuivre, détruisant ce monde par leur adhésion aveugle à des mondes désen-sibilisants, d’autres tentent de fonder sur la base de sensibilités communes et de projets partagés des formes de vie et de connaissances qui, pour une fois, ne seraient pas séparés de leurs désirs éthiques et politiques. »
Une fraction de conScience du CUL
« Le monde actuel ne connaît pas d’en-dehors, on ne peut pas espérer le fuir. Il faut donc patiemment y constituer des milieux de vie où l’on puisse produire ses moyens de subsistance sans le concours de la machinerie industrielle, et où émergent de nouveaux rapports humains, dégagés d’elle. »
Appel de Raspail
« Le diable de l’économie autonomisée [peut être exorcisé] sur la base d’échanges majoritairement locaux, fondés sur des liens qui ne relèvent pas seulement ou pas principalement de l’intérêt économique. »
Le Cauchemar de Don Quichotte
On notera tout de même cette originalité de certains antitechnologie parisiens : celle d’accepter enfin qu’il n’y ait pas d’en dehors du monde actuel. Les promoteurs de l’alternative pensent en effet souvent qu’il est possible de vivre dans un autre monde que celui de ce qu’ils appellent la « domination » . Ainsi, le journal de Longo Maï prétend-il « laisser le salariat à ceux que ça intéresse », ce à quoi nous ne pouvons que souscrire : le jour où un juge voudra nous condamner, il nous suffira de lui répondre que nous préférons laisser la prison « à ceux que ça intéresse » (sic). Reste cette volonté de construire un contre-monde dont le fait qu’il soit en dehors ou pas n’est pas pertinent puisqu’il se constitue effectivement comme pseudo-extériorité. Il s’agit toujours de prétendre que l’on pourrait vivre différemment et que cette vie soit en elle-même porteuse de subversion.
« Comment rêver d’une société de sujets libres et soucieux du bien commun, tant que chacun est dépendant au quotidien, de par ses besoins les plus banals, d’une immense machinerie technologique et sociale ? » . En effet, il s’agit d’inventer des formes de vie quotidienne maîtrisée, d’organiser une production à petite échelle, etc. Ce qu’on ne comprend pas c’est en quoi ce mode de vie peut être libéré des « dominations » du système. Il faudra ensuite nous expliquer comment il lui nuira ?
Car, si le préalable à l’autonomie c’est l’absence du système, ça ne marche pas à moins de penser qu’on peut s’organiser un coin où l’on en soit effectivement libéré. Il est donc possible de se débarrasser par un acte de volonté des faux besoins que nous impose le système pour vivre une vie plus juste et plus pure ? Cette magie de la volonté qui rabat tous les problèmes sur la seule éthique est cohérente : il existe ici et maintenant quelques « héros » dont l’ascétisme leur permet de se libérer tout seuls, d’un trait de plume. En quoi cette libération est une indépendance quant au système n’est jamais explicité : ce n’est pas parce qu’on vit dans son trou que l’on n’est pas en rapport avec le reste du monde. Prétendre ne plus en être responsable est dès lors le comble de l’irresponsabilité : l’horrible système est en effet la condition de possibilité de l’alternative – il faut des maisons à squatter, des marchandises à voler, une bonne démocratie occidentale pollueuse et esclavagiste pour ne pas se faire tirer dessus par la police.
Prétendre se libérer de l’économie en cultivant son jardin et en volant des tomates si nécessaire est ridicule. Produire en fonction de ses « vrais besoins » dans des rapports « libérés de l’argent et de l’économie » est une arnaque. On voit mal en quoi la passion de l’usage des alternativiste a quoi que ce soit de menaçant pour le monde qu’ils condamnent. La valeur d’usage est un truc de publicitaire : l’encouragement à s’approprier des marchandises qui correspondent à tel ou tel usage ou besoin. Un usage libéré des choses ne peut pas exister dans un monde capitaliste. Premièrement, on ne peut trier les « besoins » par de simples critères moraux (à moins de réduire les besoins à manger, boire, dormir et chier) : les besoins sont socialement construits et prétendre pouvoir identifier les « vrais » des « faux », les « bons » des « mauvais », dans un monde qui est de plus soi-disant « irrécupérable », relève de la mauvaise foi ou de la prétention à posséder des super pouvoirs ou des méthodes thaumaturgiques de déprise du monde. Ensuite, penser que la production autonome est un bon moyen de résoudre la question est délirant. Il faudra encore qu’ils nous expliquent en quoi cela est une menace pour l’ordre établi.
Mais revenons à leur construction, qu’entendent-ils exactement par communauté ? La disparition de la « communauté » pose des problèmes de « responsabilité morale », de « dépendance », de « perte de maîtrise » …La communauté doit permettre des « liens humains qui ne se réduisent pas à la conjonction momentanée (23) d’intérêts individuels (qu’ils soient purement marchands, ou de type ‘‘affinitaire’’) » (la communauté durable, donc ?). Leur pensée communautaire est donc une « critique de l’interdépendance (24) et de l’irresponsabilité généralisées » . Certes, avouent-ils à demi-mot, il arrive que certaines communautés engendrent des « rapports de domination », mais il s’agit de simples contingences. À quoi sont-elles donc dues ? Aux rapports sociaux informés par la vie dans le capitalisme ? Non, ou plutôt oui mais en tant que les membres desdites communautés ne sont pas capables de s’en abstraire. Il s’agit donc de vivre avec des individus de qualité. Des gens vertueux. Mais, nous dit-on, la preuve que les communautés sont subversives c’est qu’elles suscitent une hystérie anti-communautaire, le fait qu’elle soit dénoncée montre que la communauté est une « dangereuse utopie » . Ah bon… et l’hystérie contre la vaccination au dix-huitième siècle, ça prouvait que la vaccination était dangereuse pour l’État ?
Un peu de bon sens, leurs communautés ne font peur à personne, si leurs squats sont expulsés ce n’est pas parce que l’État tremble de ses genoux cagneux en constatant la présence subversive de potagers mais parce qu’il y a des propriétaires, qu’il existe un truc qui s’appelle la propriété privée.
Un peu d’histoire donc pour prouver qu’ils ont raison. Dans le Doubs, au dix-neuvième siècle, on vit à la limite de l’aisance. Il est étonnant de voir à quel point nos anti-économistes sont fascinés par l’économie de subsistance, comme si elle réglait tous les problèmes d’un coup, comme si les rapports sociaux dépendaient effectivement de l’organisation de la production (horrible marxisme archaïque) mais qu’au bon vieux temps, cette organisation se soit révélée supérieure à celle des temps présents. Les rapports sociaux sont-ils donc réglés par les rapports de production ? Si oui, en quoi le modèle passé est-il réactualisable, en quoi est-il meilleur à part en tant qu’il ne pollue pas la planète (ce qui est discutable, leurs camarades plus ou moins primitivistes leur dirait que le dix-huitième c’est déjà foutu et que ça colle des maladies à tout le monde) ? C’est que le localisme, l’autocontrôle, la maîtrise sont des valeurs essentiellement morales. Ce sont des valeurs authentiquement humaines, non dénaturées par les machines qui séparent l’homme de son effort, de son travail, de sa douleur… Ne résistons pas à la tentation de continuer avec le Doubs. On apprend dans la longue citation qu’ils en font que les utopiques producteurs étaient capables d’augmenter les rendements, de sélectionner le bétail et les semences, d’accroître le territoire, pardon, le terroir (CDQ97-98). Malheureusement, cette croissance harmonieuse a été vaincue par les envahisseurs capitalistes, elle n’a pas du tout participé à sa constitution. Si on les avait laissés tranquilles, nos paysans se seraient autolimités à temps (en noyant les enfants ?). Ils auraient fait perdurer « une société juste et humaine » .
Mais si vivre ensemble n’est pas en soi subversif il faudra bien montrer que c’est la condition de possibilité de la contestation : elle permet certes de s’organiser pour aller draguer dans les luttes. La positivité des mouvements sociaux est en effet de permettre une « émergence de communauté de lutte » . C’est donc le « vivre ensemble » qui permet l’action « subversive », tarte à la crème affinitaire qui étend la confiance minimale nécessaire à l’organisation d’actions collectives au rang de principe de l’action elle-même et principe moral. Qu’il y ait une territorialité de l’action est indéniable mais il est aussi possible d’agir avec des gens que l’on ne connaît pas. À moins d’identifier subversion et illégalisme hardcore, à la manière anarchiste et de se limiter à croire que détruire un truc de temps en temps est le parangon de la rébellion.
Outre que cela n’implique pas le fait de cultiver le même potager c’est à la fois nier qu’il soit possible de s’insurger sans se connaître et une resucée romantique de la casse qui confond encore une fois adrénaline et subversion.
Il est nécessaire de s’organiser pour agir quand on prend des risques, certes. Vivre ensemble peut être une condition matérielle facilitante mais n’est pas la cause de la subversion ! Leur lecture de La Commune est ainsi mythomane, les gens ne vivaient pas ensemble, au terme où ils l’entendent, ils habitaient ensemble, la restructuration n’était pas achevée, restructuration effectivement purement moderne mais irréductible à la technologie (25).
Quant au faubourg Saint-Antoine qui faisait « peur », différemment « d’une banlieue sinistrée » et « explosive » d’aujourd’hui au « pouvoir » qui n’a « rien à craindre des ‘‘émeutes urbaines’’ contemporaines », ce n’est ni la « conscience politique forte », ni le « goût prononcé de la liberté », ni « l’indépendance économique des artisans » et « la sociabilité locale », ni « un mode de vie à défendre » dont tirer « fierté » et « courage » qui le caractérisaient, mais bien la même chose que les sales banlieues : les prolos, les étrangers, les délinquants. Si Napoléon III fait restructurer Paris par Haussmann, Belgrand et Alphand après la révolution de 1848, s’ils construisent deux casernes à l’entrée dudit faubourg, est-ce parce qu’ils ont peur de l’autonomie des artisans dans ce quartier majoritairement ouvrier et chômeur ? Est-ce pour empêcher les artisans autonomes de vivre dans leur quartier sans en sortir ?
« Non seulement Paris rend malade, étiole et tue. Mais, en même temps, il pousse à la déchéance. […] Il le fait par ces vieux logements, éternellement contaminés et criminels, par ces vieux quartiers qui poussent au crime, perpétuant et imposant une tradition criminelle […] Tel est le déterminisme de la ville, souligné et mesuré par les faits. Il apparaît en tant de témoignages de littérature pittoresque. En tant de documents judiciaires aussi. […] Hors la loi, devrait-on dire : et bien moins par cette criminalité accidentelle qui a du moins l’avantage de soumettre quelque-uns d’entre eux au joug de la cité, que par cette manière d’être qui, par définition et en quelque sorte biologiquement, est criminelle. »
Louis Chevalier, Classes laborieuses et Classes dangereuses, pp. 378-380.
« Les classes pauvres et vicieuses, ont toujours été et seront toujours la pépinière la plus productive de toutes les sortes de malfaiteurs ; ce sont elles que nous désignerons plus particulièrement sous le titre de classes dangereuses ; car, lors même que le vice n’est pas accompagné de la perversité, par cela qu’il s’allie avec la pauvreté dans le même individu, il est un juste sujet de crainte pour la société, il est dangereux. »
Frégier, chef de bureau à la préfecture de la Seine.
Les prolétaires « campent au sein de la société occidentale sans y être casés » (26), ce sont « d’autres barbares, aussi en dehors de la civilisation que les peuplades sauvages si bien peintes par Cooper. Seulement, les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous… » (27) Le point de vue de l’ennemi certes. Mais est-il différent aujourd’hui où la banlieue voit errer des « bêtes sauvages » (Raufer), des « racailles », etc. Et le prolétariat de l’époque se considère en effet de cette manière, il ne lui vient pas encore à l’idée de renverser la critique bourgeoise pour se proclamer comme la classe paisible et honnête, on ne rougit pas de l’illégalisme organisé qui est un des moyens principaux de subsistance. Chevalier montre que « l’opinion populaire elle-même accepte ces termes et ratifie ces jugements » (28), le prolétariat se pense encore comme une autre race, en guerre au sens propre contre la bourgeoisie.
Le pouvoir craint bien plus les sales banlieusards que vos communautés à la con. Ou alors vous voulez dire qu’elles ne sont pas révolutionnaires leurs émeutes ? Mais je vous rappelle que vous êtes réformistes, ne reprochez pas aux autres de ne pas faire ce que vous ne faites pas et que vous déclarez impossible. La politique des antitechnologie est une politique de la condamnation : pas de tactiques, juste l’information, la conscientisation et le recrutement. Simplement montrer l’exemple et donner des leçons. L’action directe n’en est que la forme radicale, dans une perspective commune avec les anarchistes : elle a le double mérite d’être bonne en soi, de prouver sa valeur d’activiste, et de faire la fameuse propagande par le fait :
« Voyez, nous en sommes capables, vous en êtes capables et si vous ne le faites pas, honte à vous. » Certes, certains groupes antitechnologie entendent mener des luttes concrètes et efficaces. Mais, même en fermant une centrale nucléaire, en quoi cela change quoi que ce soit au système de leur propre point de vue ? En quoi cela permet-il aux gens libérés de cette menace d’avoir des vrais rapports humains et de vrais besoins satisfaits ?
Il est d’ailleurs étrange de voir que pour des gens qui ont sans cesse le mot communauté (ou « Commune » dans l’Appel) à la bouche cela se traduise dans les faits par des magouilles dans les couloirs et l’appropriation des luttes dans des recyclages privés et le recrutement.
Un simple exemple, l’occupation de l’EHESS pendant le mouvement contre le CPE. L’assemblée générale, la communauté de lutte réunie à cette occasion donc, décide que tous les textes devront être discutés collectivement. La nuit même, les antitechnologie qui ne s’y sont même pas opposés verbalement signent un texte à propos de leurs lubies et le signent de manière à ce que tout le monde pense qu’il émane des occupants (ils l’intitulent « Appel de Raspail », d’après le nom de la rue du lieu occupé : dès lors, dans le journal La Décroissance par exemple, l’occupation est pratiquement attribuée aux signataires de ce texte).
Merci pour l’autonomie, la responsabilité et les valeurs humaines.
—
(1). Mathieu Amiech, Julien Mattern, Le Cauchemar de Don Quichotte. Nous simplifierons la citation en écrivant CDQ dans le reste du texte.
(2). Cédric Biagini, Guillaume Carnino, Celia Izoard, Pièces et main-d’œuvre, La Tyrannie technologique, TT dans la suite du texte.
(3). Ainsi la redoutable question du « bon vieux temps » ne se pose pas également pour les auteurs du CDQ, tout à leur fascination pour les paysans du Doubs au XIXe siècle, qui précisent bien qu’ils ne critiquent pas toutes les machines, ce qui ferait vomir un Zerzan pour lequel tout est foutu depuis que l’homo habilis a disparu, et se lancent dans une défense de la petite propriété privée bien plus droitière que les gauchistes anarchistes tenants du primitivisme. Les auteurs de La Tyrannie technologique quant à eux dressent le catalogue des méchantes technologies, en disant qu’il faut critiquer toutes les technologies, « anciennes » comme « nouvelles », et en défendant parfois les disquaires. Néanmoins, malgré ce différend, tous parlent de responsabilité à peu près dans les mêmes termes. Nous montrerons aussi, si nous en avons l’occasion, qu’entre le micro-libéralisme des uns et l’anarcho-individualisme des autres peuvent se tisser d’étranges liens.
(4). Nous empruntons cette méthode aux auteurs du CDQ qui montrent habilement dans une note de bas de page qu’on peut relier Durkheim, Nietzsche, Hannah Arendt, Heidegger ou Carl Schmitt puisqu’ils se sont lus les uns les autres par exemple. Nous tenterons quant à nous d’éclaircir le bouillon, comme nous venons de le préciser, si nécessaire.
(5). Quant à nous, nous assumons : nous porterons bien ici des jugements de « valeur » puisqu’elles sont si importantes pour tous nos Critiques. Encore une fois, nous entendons les prendre au mot : quelle éthique doit-on se donner dans ce monde et quel monde idéal nous décrit-on ?
(6). Nos deux critiques ont beau par ailleurs représenter l’aile droite de la mouvance antitechnologique, cette condamnation de la collaboration est plus coutumière chez les anarchistes qui eux pensent cependant que le segment vol/squat, adossé à une bonne dose de mythologie canaille et d’esthétique du bris de vitrine, les placent de fait hors et contre le monde de la domination. Quand cela ne se réduit pas à une apologie, simple mais radicale (« chuis pas comme tout le monde moi » ), de « l’alternative » que nous examinerons plus loin dans le paragraphe sur la communauté, il s’agit souvent d’affecter de croire que l’illégalisme est immédiatement révolutionnaire, que brûler une poubelle et « baiser l’État » sont synonymes (comme notre ami Rhoff, le rappeur qui baise l’État depuis tout petit, notamment en ne voulant pas payer de taxes). Que, contrairement à ce qu’affirment les politiciens, le capitalisme supporte une dose d’illégalisme, est inaudible. Il ne s’agit pas ici de dire cependant que l’existence d’un délinquant ou celle d’un policier ont la même valeur, mais d’affirmer que les postures individuelles ou pseudo-collectives à quatre qui se connaissent ne portent rien de dangereux pour le système. Certains anarchistes quant à eux sont simplement « contre la révolution » parce que « c’est un truc de stal autoritaire », et posent donc comme « rebelles » ou « révoltés », mais là n’est pas notre propos.
(7). Je me permets de rétablir l’orthographe et la grammaire de ce résistant au système technique qui écrit pourtant en novlangue SMS.
(8). Le Téléphone portable, gadget de destruction massive, PMO.
(9). Même les soi-disant « militants » (c’est-à-dire ceux qui militent contre autre chose que les machines), quand bien même ils se sentent apaisés sous le prétexte qu’ils empêchent l’expulsion de sans-papiers où qu’ils participent à une lutte « économique » contre une nouvelle dégradation des conditions de l’exploitation, sont coupables au même titre que les autres : « Comment peut-on prétendre s’opposer au capitalisme, lorsqu’on s’accommode, jusqu’à la fascination du genre d’existence qu’il procure et de ce qu’il fait accomplir aux hommes ?» (p.47). CDQ montre ainsi les aspects « schizophréniques » de la contestation : consommer sur Internet et militer contre le capitalisme (parfois avec un portable en poche) sont contradictoires. On trouvera le même type de critique dans l’Appel : il existerait donc quelque part la possibilité de vivre en toute pureté sans collaborer à ce monde. Cette question sera examinée dans la partie sur la communauté.
(10). Le Téléphone portable, gadget de destruction massive, PMO.
(11). Bien loin d’eux l’idée de pouvoir dire « nous sommes tous des ouvrières du Honduras », pour reprendre un exemple de CDQ : d’abord parce que s’identifier à un salaud d’ouvrier qui veut toujours plus de confort est une hérésie, ensuite parce qu’ils récusent que les vieux camps du capital et du prolétariat existent.
(12). On notera cependant un lexique fort méprisant pour désigner les « technophiles » dans l’ensemble de cette littérature. La Tyrannie technologique décroche à notre sens le pompon de l’inventivité en les qualifiant de « troupeau de zombies », associant ainsi et le mouton et le mort-vivant, deux figures parmi les plus amicales.
(13). Nietzsche, Crépuscule des idoles, §7.
(14). Il serait amusant de faire le recensement dans CDQ du mot « impuissance » et de son corollaire « débandade »… On retrouve cette thématique de l’impuissance dans La Tyrannie technologique, pp. 6, 95-97, 112, 115, etc. De même, le Groupe Oblomoff, in Le futur triomphe mais nous n’avons pas d’avenir.
(15). On trouvera aussi des pages hilarantes sur le sujet dans La Tyrannie technologique, pp. 127-131.
(16). Pour qui a envie de chercher, il est facile de trouver sur Internet les dispositifs de police du langage et des comportements prônés par les militants de l’alternative dont les opposants à l’industrie sont ici idéologiquement proches. Sous prétexte de luttes « anti-autoritaires », il s’agit de parodier les instituteurs de la Troisième République en édictant des règles de conduite contre tout ce qui n’est pas pacifié ni neutralisé. Dans certains squats, c’est comme à l’Assemblée nationale, il ne faut pas parler trop fort…
(17). Amiech et Mattern ont ceci de particulier qu’ils en profitent carrément pour réhabiliter les professions libérales : « L’idée de travailler à son compte apparaît comme le comble de l’égoïsme, de la réaction, ou comme une adhésion implicite à l’idéologie néo-libérale. » Or, le « producteur indépendant, maître de son outil de travail, petit propriétaire » était « l’idéal politique » de la démocratie américaine au dix-neuvième siècle (et de sa version consumériste des années 1950, ce qu’ils oublient) et de la République française jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Vive la Convention et la Troisième République, la bonne valeur travail comme meilleure discipline… Ici, ils sont évidemment en désaccord avec les primitivistes par exemple, pour qui le seul « travail » qui vaille est celui
de chasseur-cueilleur.
(18). De même, le problème du contrôle social à l’école vient du fait que les profs sont payés pour le faire, ils ne peuvent donc pas être responsables : la responsabilité c’est le contrôle exercé gratuitement !
(19). Le passé mythique comme « souvenir de l’enfance magnifié » qui « permet à l’individu de grandir » (CDQ 62-63).
(20). L’Homme est en effet une invention purement moderne, une problématique âgée de deux siècles : dans les interstices de la transformation du savoir à cette époque se glisse la question de l’homme, à la fois objet de savoir et condition de possibilité de tout savoir. Et c’est cette invention de l’Homme qui va permettre aux sciences humaines dont ils sont, quoi qu’ils en disent, les tenants plus ou moins critiques, de proliférer. Les « vraies valeurs humaines » c’est le repérage et le contrôle des normes par le pouvoir, l’individu c’est l’objet du savoir et du pouvoir des médecins, des flics, des psys et de la pénitentiaire. Cf. Foucault,
Les Mots et les Choses, et Surveiller et punir, notamment.
(21). Que seuls les individus puissent être dits autonomes n’est pas évident dans l’histoire du mouvement révolutionnaire. L’anarchisme-individualisme rejoint ici l’idéalisme qui pense les individus « moralement libres » sans tenir compte du contexte. Que l’autonomie individuelle règle la pratique collective est une conception exsangue : une insurrection ne peut pas se réduire à ce que font les individus qui y participent. La réduction de la politique à la question éthique, quand elle n’est pas une posture, est un aveu d’impuissance : l’illusion qu’il est possible de changer le monde dans son coin, l’illusion qu’il est possible de vivre à côté, au-dessus, au-delà du monde. L’autonomie dans les luttes a toujours été un problème collectif : affirmation de la puissance distincte du prolétariat, de sa place centrale dans la contradiction du capitalisme et, partant, de sa capacité à se débarrasser du capital ; autonomie comme auto-organisation, à distance des syndicats, des partis et des organisations permanentes – c’est-à-dire organisation dans et pour la lutte, où la lutte elle-même est centrale, pas l’organisation.
(22). Il n’y a bien sûr rien à dire sur le contrôle social communal, sur le rôle du prêtre, de l’épicier et des vieux qui surveillent tout le monde. Si ça leur manque tellement qu’ils viennent vivre dans un village algérien ou corse. Le bonheur d’être fliqué par la famille et les vieux, nous leur conseillons d’essayer : il est vrai que quand la rumeur marche plus vite que les gens, cela garantit de bons rapports humains.
(23). Parce que si les intérêts individuels ne sont pas « momentanés » c’est bon ? Vive les communautés durables…
(24). Et que dire de la perte de la famille ? Il n’y a pas d’interdépendance dans la famille ? Est-ce qu’il y a des rapports sociaux indépendants, qui laissent l’individu intègre
et pur ? On retrouve ici l’angoisse de la perte de maîtrise ; même l’amitié et l’amour doivent n’engager à rien, il ne faut pas que le noyau individuel puisse être envahi par quelque lien que ce soit. La communauté, au sens strict, c’est pourtant une mise en commun où chacun abandonne quelque chose au groupe. Étymologiquement, nos Critiques prônent donc plutôt l’immunité : ne me touchez pas, que rien ne me touche !
(25). Mais quel est le rapport avec la technologie ? L’absence des populations de l’espace public est organisé dès le dix-huitième siècle par la police, pas par la machine… Les rues ne sont pas vidées parce que les gens sont devant leurs machines, c’est pour les mettre devant leurs machines qu’on vide les rues : ce sont des lois qui organisent le quadrillage des villes, l’interdiction de poursuivre les activités domestiques dans la rue, qui les organisent comme un espace de circulation. Aux dernières nouvelles, c’est bien la police et les architectes qui ont commencé à restructurer l’espace urbain. Les caméras par exemple ne sont qu’une poursuite d’une logique policière et pas le principe même du contrôle. Elles sont installées dans une volonté panoptique typique du dix-huitième siècle dont le critère n’est pas une valeur technologique au sens strict mais bien celui de l’efficacité, valeur policière s’il en est. C’est un peu comme si l’on prenait les concepts foucaldiens de « technologies de pouvoir » et de « machines » de contrôle pour les retranscrire au premier degré en les confondant avec tout ce qui est vaguement mécanique et électronique…
(26). Auguste Comte, Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la religion de l’humanité, 4 volumes, Paris, 1852-1854, p. 411.
(27). Eugène Sue, Les Mystères de Paris.
(28). Louis Chevalier, Classes laborieuses et Classes dangereuses, Paris, Plon, 1958, réédition Perrin, 2002, p. 497.